Les traditions constantinoises des différentes communautés étaient souvent très proches. C'est donc Claude S. qui m'a proposé ses souvenirs évoquant la vie à Constantine et dans la communauté juive. Je la remercie chaleureusement pour ses très beaux textes qui nous font entrer dans l'intimité d'une famille constantinoise.
SOMMAIRE
I. Préambule : L’Algérie une longue étape : Oujda, Oran, Constantine, Tlemcen, Alger.
II. Mon Ecole au pluriel : L’abrogation du décret Crémieux, le numerus clausus, et le débarquement américain à Oran. Retour à l’école.
III : A Oran, sous Pétain : L’époque de l’épicerie : petits souvenirs en pointillé :
L’eau douce à Oran, le coup de soleil, Verdu. etc…
IV : Constantine : Chez mes grands-parents Melki :
- 1 : Kar Chara : Le quartier juif
Au 44 rue Thiers
Le hammam.
Joseph, Hocine
5 Août 1934, la trappe sous le toit.
- 2 : Grand- père : un régime patriarcal, un homme d’étude, etc…
- 3 : Grand’mère Clara :
Le costume judéo arabe
La journée rose.
La cuisine
Le four banal
- 4 : Paul : notre enfance.
- 5 : La terrasse et nos jeux au rythme des saisons : Printemps : La grande lessive, le toit, la « carriole » de Paul, le mouton de Pessah, ETE : le matelassier, la piscine de Sidi M’cid, les « booms » et Suzette. Automne : La souccah, Hiver : la neige.
- 6 : Les pratiques superstitieuses.
- 7 : La jeune fille et le mariage juif : tania et tevilah
V : Tlemcen : ma famille paternelle.
VI : Alger
et l’exode (à venir)
|
• • •
I - Préambule
L’Algérie : une longue étape • • •

1936 : un peu berbère ?
Malgré les racines berbères probables d’une partie de notre famille l’Algérie ne fut qu’une longue étape dans l’errance d’une communauté du peuple juif auquel nous appartenons.
L’histoire a fait de nous en France des « pieds noirs » mais nous ne sommes pas arrivés en Afrique du Nord avec la colonisation française.
Depuis le décret Crémieux en 1870, nous n’étions plus des « juifs indigènes » ou des « indigènes israélites » (tampon apposé sur les livrets militaires des juifs avant le rétablissement du décret Crémieux, en Octobre 1943) mais des citoyens français.
Les lois de Vichy ne nous ont rendus, qu’ un temps, à notre premier statut et nous nous sommes réfugiés en « Métropole »dans la débandade de 1961-1962.
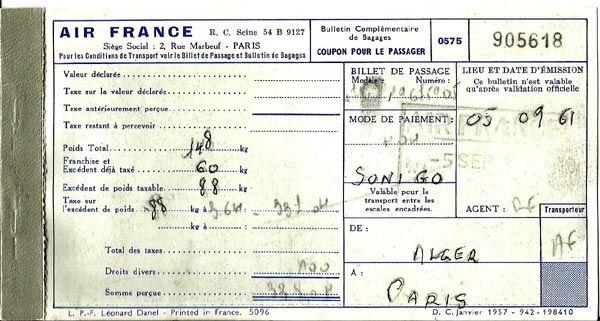
Le 5 Septembre 1961, Jacques, les 2 enfants et moi prenions une Caravelle d’Air France pour Paris avec quelques valises comme pour des vacances… L’O.A.S. menaçait les candidats au départ. C’est persiennes fermées, que nous avons entassé l’indispensable* pour n’alerter personne : poussette, biberons etc... Pierre n’avait pas 3 ans, Pascale avait 7 mois !
Quelle sera la prochaine étape ?
La « bête immonde » se réveillant, nous voilà, nous juifs, à nouveau incertains et inquiets de l’avenir de nos enfants.
Sur cette terre là-bas je suis née et j’ai vécu jusqu’à 27 ans. J’ai traversé l’époque de la Seconde Guerre Mondiale loin de la tragédie des juifs de France, j’ai connu l’humiliation des lois de Vichy et la détresse de mes parents, le débarquement libérateur des Alliés en Novembre 1942, la guerre d’Algérie que nous appelions les « événements » avec ses tragédies, l’exode enfin.
Je me souviens sans regret, sans nostalgie aucune.
Je me retourne sur mon passé pour témoigner un peu à mon humble niveau, pour mes 9 petits-enfants, encouragée à continuer par mes petites Clara et Alice, mes fidèles lectrices, à qui je dédie « mes écritures ».
L’Algérie est une étape capitale de ma vie, mais déjà lointaine, estompée par grands pans dans mon souvenir.
*148 kg de bagages dont 88 kg d’excédent de poids taxable. Au moment de la panique de l’été 1962,10 kg par personne seulement étaient autorisés.
Le judaïsme magrebin
De l’étonnante diversité du judaïsme magrébin j’ai été témoin, toujours à mon humble niveau, depuis ma prime enfance, dans les turbulences de la seconde guerre mondiale puis de la guerre d’Algérie.
J’ai vécu à Oujda (1933-1939), Taza (1940), Oran (1941-1944), Constantine (1944-1948), Tlemcen (1948-1952), et Alger de 1952 jusqu’au départ définitif en Septembre 1961 pour Paris.
Oujda : 1933-1939 : un clivage : les « sujets marocains »et les « citoyens français ».
A Oujda, ville frontière du Maroc, sous protectorat français, à 15 km de l’Algérie, je suis née française le 10-12-1933 parce que mon père, né à Tlemcen, en Algérie, colonie française, y était fonctionnaire français.
Les enfants des juifs indigènes des mellah marocains apprenaient le français dans les « écoles juives », à « l’Alliance » : écoles de l’ « Alliance Israélite Universelle » fondée en 1860, pour lutter contre l’inculture et le sous-développement des communautés juives. Les enfants de nationalité française fréquentaient l’école communale française où j’ai fait mes premiers apprentissages. Nous avions rarement l’occasion de côtoyer à l’école les enfants juifs de nationalité marocaine.
Avec la pauvreté, le manque de soins et la surpopulation, les fléaux de l’époque touchaient les juifs des mellah marocains plus que les autres couches de la population : trachome, cécité, tuberculose, épidémies. Pas d’antibiotiques, contre les insectes nuisibles (moustiques, poux, punaises, puces, blattes etc.) nous étions tous démunis. Et la Sécurité Sociale n’existait pas.
Je me souviens avoir souffert, dans ma petite enfance, de terribles conjonctivites fréquentes au Maroc qui m’empêchaient d’ouvrir les yeux au réveil. Il fallait de l’eau tiède salée et beaucoup de patience à ma mère pour que je puisse les entrouvrir.
La population entassée dans les mellah marocains vivait en majorité dans la pauvreté. Les têtes des enfants étaient souvent rasées à cause de la teigne et des terribles épidémies de typhus. Des vieillards loqueteux, maigres, malades, aveugles souvent, ou mutilés, juifs ou arabes mendiaient dans les rues. La misère marginalise et exclut.
Le royaume chérifien du Maroc était un protectorat français depuis le traité du 30 Mars 1912, signé à Fès entre la 3ème République Française et le Sultan Moulay Hafid, protectorat qui perdura jusqu’en 1956, mais les juifs indigènes ne bénéficiaient pas de la nationalité française. En Algérie, le décret Crémieux avait, en 1870, enrichi la population française de 37.000 nouveaux citoyens. Leur émancipation avait été très rapide et l’assimilation à la France et à la culture européenne totale. Eux qu’au 19ème siècle on appelait encore les « Yaoud al arab » : les juifs des arabes.
Mon père, français parce que né en 1903 en Algérie de père français, avait un diplôme d’instituteur, mais avait choisi de travailler à la Poste. Il avait la passion de la langue et de la littérature françaises, des belles éditions reliées. Il dessinait, jouait du violon en professionnel. Jusqu’à la crise de 1929, il était violoniste à Tanger dans un orchestre classique.
Ma sœur Josiane et moi sommes nées à Oujda dans une petite maison avec jardinet où des violettes poussaient partout. Terrorisées nous voyions souvent passer, suivi d’une meute de gamins gesticulant et poussant des cris perçants, Galoufa, l’attrapeur municipal de chiens errants avec son lasso, un nerf de bœuf terminé par une chaîne en fer et un anneau coulissant, et sa fourrière, une charrette cage tirée par un âne, avec grillage et barreaux de fer et 2 ou 3 malheureux klebs prostrés ou hurlant à la mort. Terreur aussi le boussadia, sorte de sorcier noir, griot ou derviche tourneur, effrayant avec ses queues de bête et ses breloques autour de la taille et toute la ferraille hétéroclite qui tintinnabulait sur lui quand il dansait au rythme frénétique de ses karbakas, sorte de crotales, grosses castagnettes en métal à très longs manches, en roulant des yeux blancs. Il était parfois accompagné d’un singe assis sur son épaule, de un ou deux tambourineurs ou d’un enfant saltimbanque qui exécutait des sauts périlleux. Nous les entendions arriver de loin, les cris, les aboiements, le rythme fou des instruments. Nous étions affolées.
« Attention à Galoufa ! » « Continue et je t’envoie à la fourrière » ! était la pire menace des adultes et la plus cruelle aussi. D’ailleurs je n’ai rencontré ces pittoresques personnages nulle part ailleurs qu’à Oujda, à travers la grille du jardin.
Je me souviens aussi avoir, à travers la grille de ce jardin, troqué la fine chaîne d’identité en or que je portais au poignet contre une boîte de conserve qu’un petit yaouled faisait rouler au bout d’une ficelle. J’étais si fière de mon acquisition ! Ma mère a beaucoup couru pour rattraper l’enfant.
Nous avons ensuite habité dans un immeuble bourgeois avec des escaliers en marbre blanc que la propriétaire, une vieille avare, nous empêchait de fouler, par crainte de l’usure, en criant : « Balek ! Balek!» quand elle nous apercevait, ma sœur et moi, avec notre petite bonne arabe dans l’escalier où nous ne faisions que passer. Au moindre bruit, elle pointait un nez inquisiteur dans l’entrebâillement de la porte. Nos appartements s’ouvraient sur le même palier. C’était, je crois, rue d’Alger. La dame un peu dérangée qui récupérait, par économie, pour la boire, l’eau des artichauts que ma mère faisait bouillir, s’appelait Mme Icare !
Ma mère avait une amie, Jeannette K., que j’ai revue plus tard, pendant la guerre, dans le quartier juif d’Oran. A Oujda, J’ai dû accompagner ma mère une ou deux fois quand elle lui rendait visite dans le mellah, à l’insu de mon père qui redoutait les épidémies, le typhus surtout. Jeannette habitait avec sa nombreuse progéniture dans une rue qui exhalait une odeur de misère, mélange indéfinissable d’égout et d’immondices dans la touffeur de l'été. J’étais frappée par les murs nus badigeonnés à la chaux. A l’époque, partout des papiers peints très colorés décoraient les murs. Un pauvre mobilier aussi, nul objet décoratif, ni miroir, ni horloge, ni vase et pas de livres. 
Le 7 Juin 1948, 3 semaines après la déclaration de l’Etat d’Israël, des émeutes antijuives firent, en 3 heures, à Oujda, où mon père vivait encore, et à Djerada, 43 morts et 155 blessés. Habitations et biens furent détruits. Le mellah d’Oujda fut reconstruit après ce « pogrom ».
J’ai l’amertume de constater que deux villes où j’ai vécu, celle de ma naissance et celle où j’ai passé une grande partie de mon enfance, ont vu déferler dans les quartiers juifs des hordes barbares d’émeutiers arabes: Constantine en Août 1934, avec la montée de l’antisémitisme nazi et Oujda, en juin 1948, avec l’antisionisme. Qui parle de coexistence pacifique ?
Il faut beaucoup d’idéalisme et d’optimisme pour espérer que des prétextes cesseront d’alimenter la haine à toutes les époques contre les minorités juives.

1939. Oujda : Cours préparatoire
Le mellah à Oujda
Au Maroc, Tanger et Larache n’ont jamais eu de mellah

La Casa d’España où j’ai appris à entonner l’Internationale,
en levant mon petit poing aux meetings de la S.F.I.O.
Oran 1941-1944. Le quartier juif sous Pétain : ségrégation et rejet.
Les premières constructions du quartier juif à Oran datent du début du XIXème siècle. L’Espagne, restée en Oranie pendant 3 siècles en avait été chassée en 1790 par un tremblement de terre : « Oran fut conquise, Allah la rendit aux Musulmans » disait une inscription arabe pour commémorer cet événement. Lors de la reprise de la ville aux Espagnols, le bey Mohamed el Kebir, décidant de repeupler Oran dévastée et dépeuplée, fit appel aux habitants israélites de différentes villes d’Oranie. Pour relancer le commerce, il vendit à bas prix des terrains situés entre le Château Neuf et le Fort Saint-André à des juifs de Nedroma, Mostaganem, Tlemcen et Mascara avec la seule condition d’y construire sur des alignements donnés. 40ans après le départ des Espagnols, les français firent leur entrée dans Oran, sans tirer un coup de feu.
La toponymie du quartier juif se réfère aux victoires de l’épopée impériale de Bonaparte à Napoléon III : rue de la Révolution, appelée « rue des juifs », rue d’Austerlitz, rue de Wagram, rue de Magenta, du Mont Thabor.
A Oran au début des années 1940, j’ai vraiment connu le phénomène de ségrégation et de rejet du « quartier juif ».
C’était la guerre, l’antisémitisme était virulent et actif. Nous avions quitté Taza où nous n’étions restés qu’un an parce que mon père avait été chassé de la Poste. Nous étions en Algérie, colonie française, département d’Oran, mais pendant les années 41-43 où nous avons vécu à Oran, le statut des juifs avait été promulgué sous le régime pétainiste de Vichy, le décret Crémieux aboli, les juifs chassés de leurs emplois, réduits au dénuement, les enfants exclus des écoles. Les rues du quartier juif, abandonnées des services de nettoiement et d’hygiène étaient nauséabondes. On y marchait au milieu de montagnes d’ordures. Je l’ai vu.
Après un long séjour à l’hôtel, notre famille a habité 21 rue d’Arzew mais je rendais visite à ma grand’mère Nouna qui vivait chez sa fille Berthe au 22 rue de Wagram, face à un bain maure, au-dessus d’une laiterie dans le « quartier juif ».
Là on parlait certes français, on s’habillait à l’européenne, mais la misère était palpable. Le mari de ma tante Berthe, Gaston S., facteur financier à la Poste, privé désormais d’emploi, colportait, en car, de village en douar, deux valises de petite mercerie pour nourrir sa nombreuse famille. Huguette, ma petite cousine orpheline de mère, née en 1934, d’un précédent mariage de son père, deux fois veuf, se souvient avoir eu faim et souffert des privations. Le pain, obtenu contre des tickets, était rationné.
A Oran, j’ai compris que j’étais juive.
Mon père, né en 1903, était athée, laïc. Il pensait que pour saisir cette chance immense que nous offrait la France, pays des droits de l’homme et de la liberté, il fallait se débarrasser de tout ce qui avait fait de nous des judéo-arabes, soumis au statut de dhimitude, pendant tant de siècles. Cf. Coran verset IX, 29, qui sert de base scripturaire à toute la législation sur les Dhimmis, gens du Livre, Juifs et Chrétiens.
En 1940, la France l’a trahi, mais il n’est jamais revenu à la religion.
Quand, en Octobre 1941, j’ai été renvoyée de l’école, j’avais 7 ans, bientôt 8. Après mon renvoi de l’Ecole Publique, ma mère avait fait une vaine tentative pour m’inscrire chez les Sœurs. C’était la conversion et l’école ou le judaïsme et… «l’échoppe » (cf. déclaration de Giraud) ! Après tant de siècles de résistance de ce peuple entêté ? Je sais gré à ma mère de son choix ! Les antisémites m’ont renvoyée à mon identité !
Après l’abolition du statut des juifs et le rétablissement du décret Crémieux, officiellement par De Gaulle le 23 Octobre 1943, soit presque 1 an après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en Novembre 1942, après bien des tergiversations des autorités, les enfants juifs de la République française fréquentèrent à nouveau l’Ecole Publique. L’assimilation à la France était déjà complète. En 1947, le décret Crémieux fut inscrit dans la Constitution.
La fascination pour la culture et la civilisation occidentales et l’extraordinaire volonté et faculté d’adaptation des Juifs avaient contribué à leur émancipation et beaucoup « avaient fait un bond en deux ou trois générations, du Moyen Age arabe aux XIXème et XXème siècles européens».( Selon la formule de Chouraqui : la Saga des juifs en Afrique du Nord).
C’est le cas des membres de ma famille paternelle à Tlemcen et maternelle à Constantine.
Constantine : 1941 puis 1944-1948 : Kar Chara. Un clivage d’une autre nature
« Kar Chara » c’était le petit peuple, rue Grand, rue Vieux, rue de France, rue Thiers. Certaines rues du quartier débaptisées, prirent ensuite les noms de soldats juifs morts pour la France mais l’Histoire ne leur laissa pas le temps de s’imposer : rue du Sergent Atlan, ex rue de France (Paul Atlan, professeur de philosophie, engagé dans les Corps Francs mort pour la France en Tunisie), rue des frères Lévy, rue du sergent Sultan … « Sic transit… »
J’ai évoqué longuement la vie du quartier juif dans le texte intitulé KAR CHARA et publié dans « Souvenirs de Claude ». (Sur le site Constantine d’hier et d’aujourd’hui). A Constantine le clivage était d’une autre nature. Tous les habitants juifs étaient citoyens français mais le mode de vie des plus âgés était au confluent de deux cultures, deux civilisations.
J’ai vécu à Constantine en 1941-42, puis de 1944 à 1948. Pendant la guerre et tout de suite après.
A Constantine, la ville aux dix synagogues, la Jérusalem de l’Est, l’autre étant Tlemcen, les juifs nombreux avaient été parqués au XVIIIème siècle dans le quartier au bord du gouffre dit « Kar Chara » « le bas » ou « le cul » de la ville par le Bey Salah (1771-1792), le plus aimé des Beys constantinois sous la période turque, mort assassiné, celui-là même dont les Constantinoises musulmanes continuaient de porter le deuil avec leur haïk noir –ailleurs il était blanc- sûrement sans le savoir. Le quartier constitué de maisons mauresques avait été agrandi au début du XXème siècle d’immeubles de style européen, rue Thiers et rue de France.
Dans les années 1940, les juifs vivaient toujours en grand nombre à « Kar Chara », près de leurs synagogues. La petite bourgeoisie juive avait déjà essaimé vers les faubourgs. Les plus âgés, souvent vêtus à l’orientale, parlaient arabe. C’est la seule ville de celles où j’ai vécu où des femmes âgées conservaient leur costume judéo-arabe traditionnel dans les années 1940-50. Dans certaines provinces françaises aussi, à cette époque, les costumes folkloriques bretons, alsaciens, normands etc… ainsi d’ailleurs que les patois n’avaient pas disparu.
. La population juive conservait des vestiges du long passé judéo-arabo-berbère. Des femmes âgées gardaient de l’époque ottomane le costume, la langue, les rituels partagés, les .habitudes alimentaires, les croyances superstitieuses, le goût oriental des riches étoffes, des bijoux, des broderies en fil d’or. A la même époque, les habitants juifs des grandes villes côtières comme Alger et Oran, par exemple, étaient européanisés complètement.
A Constantine cependant, dès les années 1920- 1930, après la première guerre mondiale, les jeunes générations qui avaient fréquenté l’Ecole Publique ne parlaient qu’en français, avaient adopté le costume européen et le mode de vie occidental. Nombreux partaient faire des études supérieures à l’Université d’Alger et, après la seconde guerre mondiale, à Paris.
Outre la langue et les vêtements, un élément de cette fulgurante évolution est le choix des prénoms. On abandonne très vite Messaouda, Meleha, Radia, Zerda, Guenouna dite Nouna (ma grand’mère paternelle), Said (mon arrière-grand-père paternel), qui figurent dans nos arbres généalogiques, et on voit brusquement apparaître des prénoms Second Empire : Clara, Valentine, ma grand’mère maternelle, Augustine, Eugénie, ses sœurs nées à la fin du XIXème siècle. Puis Berthe, Germaine, Léa etc. Souvent les femmes âgées avaient des prénoms français mais des surnoms arabes comme les sœurs de ma grand’mère : Loueino, Zeiro.
Les générations de transition utilisaient encore la langue arabe ou un sabir franco-arabe en truffant le français de mots arabes ou judéo-arabes ou l’inverse.
A Constantine, j’ai vraiment vécu, à une époque charnière, la totale métamorphose de la population du quartier juif avec le contraste entre la vieille génération encore ancrée dans son passé et les nouvelles, instruites à l’école de Jules Ferry. (« Nos ancêtres les Gaulois » !) assimilées à la France et à la civilisation occidentale. Un clivage existait aussi entre le petit peuple de Kar Chara et une certaine bourgeoisie juive aisée, évoluée, parfois française par senatus consulte avant le décret Crémieux, et qui s’était éloignée du vieux rocher.
Tlemsen : 1948-1952. En pension
Un répit. « Harmonie illusoire ? ».

A Tlemcen, « la perle du Maghreb », « Sources » des Berbères (l’antique « Tilimsen » en tamazigh) et « Vergers » des Romains (« Pomaria » en latin), la nature invitait à la paix. L’air était très pur, partout des sources, des ruisseaux, une végétation luxuriante, des oliviers à Mansourah, grenadiers, mûriers. En Mars, les amandiers se couvraient de fleurs roses, les noyers fleurissaient autour du Grand Bassin. J’adorais me joindre au groupe de pensionnaires qui partait en promenade le Jeudi et le Dimanche après-midi. J’ai des  photos du jeudi 10 novembre 1949 de paysages, de cascades, de sites exceptionnels. Située à 800m d’altitude, accrochée sur les contreforts très arrosés de l’Atlas, Tlemcen est une ancienne capitale religieuse, intellectuelle, en même temps que le centre spirituel du Maghreb. Avec ses 7 lieux de culte, elle a toujours été considérée par les juifs comme sainte. Ils y venaient en pèlerinage sur « le tombeau du Rab » (photo de 1936 avec ma mère) et comparaient la ville à Jérusalem. Beaucoup de mosquées aussi, dont certaines magnifiques, spécialement la grande mosquée Djema El Kebir bâtie au XIIème siècle et située en pleine ville. photos du jeudi 10 novembre 1949 de paysages, de cascades, de sites exceptionnels. Située à 800m d’altitude, accrochée sur les contreforts très arrosés de l’Atlas, Tlemcen est une ancienne capitale religieuse, intellectuelle, en même temps que le centre spirituel du Maghreb. Avec ses 7 lieux de culte, elle a toujours été considérée par les juifs comme sainte. Ils y venaient en pèlerinage sur « le tombeau du Rab » (photo de 1936 avec ma mère) et comparaient la ville à Jérusalem. Beaucoup de mosquées aussi, dont certaines magnifiques, spécialement la grande mosquée Djema El Kebir bâtie au XIIème siècle et située en pleine ville.
La ville arabe, très concentrée, avec ses ruelles étroites, était entourée de quartiers européens. Mais dans ma classe mixte, au Collège de Slane, les trois communautés : juive, arabo-berbère et européenne étaient mêlées. Les Musulmans, des garçons, étaient nombreux dans ma classe de la 3ème à la Terminale. Les filles qui n’étudiaient pas de langues anciennes étaient scolarisées au Collège de Filles dit E.P.S. En terminale, elles nous rejoignaient au Collège de Slane. Cette section n’existait pas à l’E.P.S. Quelques rares jeunes filles musulmanes arrivaient en pension parfois voilées de leur haïk blanc mais elles l’ôtaient devant le Collège. Nous avions aussi de nombreux professeurs arabes, surtout en Maths (Adam), physique(Allal) Sciences. Harmonie illusoire ? En tout cas, je n’ai jamais perçu de phénomènes de rejet ou d’exclusion, pas même de cloisonnements, de clivages dans la population juive malgré les différences de niveau de vie. Pas de quartier ghettoïsé, de ségrégation comme à Oujda, Oran, Constantine où le terme « Kar Chara », avait une connotation péjorative et suscitait au moins la condescendance chez les autres citadins des grandes villes.
A Tlemcen, Le quartier juif d’origine occupait, selon l’histoire ou la légende, un espace près du Méchouar offert par gratitude au Rab pour sa communauté à l’intérieur des murs de la cité à la fin du XIVème Siècle. Avec le temps, ce quartier avait perdu son homogénéité et continuité avec, en particulier, le percement de la rue de France en 1846 par les soldats du Génie. Cette rue qui devint avec la place d’Alger et la Place de la Mairie le cœur de la ville, contribua à me donner l’impression que les juifs étaient certes très nombreux dans les rues adjacentes mais pas coupés des autres communautés. La toponymie est révélatrice : les rues Bensidoun, du Rab et de la Synagogue, étaient probablement au cœur du quartier juif d’origine. Les autres noms attribués par l’administration coloniale ne manquent pas de sel pour un quartier juif depuis des siècles : St Cyprien, 1er évêque africain catholique martyr, Clauzel, conquérant français, Charles Quint et Ximénès, l’archevêque de Tolède à l’époque de l’Inquisition, qui s’était emparé avec sa flotte de Mers El Kebir, le 19 Mai 1505, glorieux conquérant espagnol, pas spécialement philosémite ! Une façon pour les nouveaux maîtres de prendre possession des lieux ? « Ense, Cruce » ?
En outre, à Tlemcen, après la guerre, la bête immonde du racisme et de l’antisémitisme, repue de 6.000.000 de victimes juives somnolait.
Et nous étions inconscients du désir de justice et d’égalité ou d’indépendance qui travaillait les élites musulmanes et des événements qui se préparaient. Pourtant les émeutes de Sétif en 1945, si durement réprimées auraient dû nous ouvrir les yeux. « Je vous donne la paix pour 10 ans ! À vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés !»avait dit le général Duval. Neuf ans après, la Toussaint 1954 !
A peine 2 ans après mon départ de Tlemcen, se sont constitués des réseaux terroristes, communistes essentiellement, où ont été impliquées deux camarades de pension dont j’ai partagé la vie : Keira Aziz et Danielle Minne. Keira a été tuée. Une infirmière assure avoir reconnu son corps à l’hôpital. Elle vint me voir en 1953-54 à Alger où j’étais étudiante. Je ne m’expliquerai que bien plus tard sa présence dans la capitale, à cette date-là où s’organisait le terrorisme urbain. Je raconterai ses questions, ses silences, ses réponses évasives, sa méfiance probable.
L’époque de l’innocence : Keira et Danièle.

Danièle. Photo de 1952 |

Keira
|
Danièle Minne, la fille de notre nonchalant professeur de philo, à qui, nous « les grandes » du «dortoir des grandes » en pension, faisions les tresses tous les matins, est née en 1939. Elle prit le maquis à 18 ans en 1957 après l’arrestation de sa mère, ex Mme Minne, professeur de Lettres, devenue Mme Guerroudj, condamnée à mort puis graciée le 8 mars 1962. J’en reparlerai aussi.
Danièle libérée en avril 1962 « rebaptisée » Djemila, mariée, et sa mère vivent en Algérie. Je les ai vues dans un reportage à la télévision. La vieille dame a parlé de sa condamnation à mort, mais pas des crimes terroristes lâches contre des civils innocents dont elle s’est rendue au moins complice.
Mais je pleure encore toujours ma délicieuse et si jolie, limpide compagne de dortoir, Colette Cohen, au sourire et aux joues d’enfant, dont le lit était, pendant 4 ans, juste à la droite du mien sous une grande fenêtre. Nous chuchotions après l’extinction des feux. De quoi parlions-nous ? De choses insignifiantes ! Nous ne refaisions pas le monde ! Colette était sereine, douce, discrète, une adolescente tranquille, à l’aise dans la vie, comme ignorant le mal.
Elle est morte en Juillet 1962, victime d’une barbarie aveugle et surtout absurde à cette date où tout était joué, après les accords d’Evian et la grâce accordée aux militants F.L.N.
Pas de grâce pour elle ! Elle est morte, disparue, sans laisser aucune trace avec son mari Jean-Jacques Sicsic, ses deux parents, deux amis et leurs deux autos sur la route Beni-Saf –Oran. Le jeune couple était instituteurs à Beni-Saf et se préparait à partir après l’année scolaire. Jean- Jacques et un ami étaient partis pour expédier leur auto au port d’Oran. Inquiets de ne pas les voir revenir, Colette et ses parents sont partis à leur recherche sur cette même route. Tous ont disparu. Et aucune trace des deux autos ! Le jeune couple a laissé deux très jeunes enfants orphelins et une famille désespérée.
Voir le très émouvant film de Hélène Cohen, sa nièce, en quête de vérité (été 2012). Algérie 1962. L’été où ma famille a disparu.
L’époque de l’innocence
 |
Photo de février 1952 dans la cour du Collège : un groupe de pensionnaires.
Colette .En haut : 2ème en partant de la droite.
Keira. En bas : 3ème En partant de la gauche
Claude. En bas : 1ère en partant de la gauche |
Photo de 1950 : Dans la cour :
Colette est la 1ère en bas à gauche.
Je suis juste au-dessus.
|
 |

Collège de Slane : année 1950-51 Classe de 1ère
En Classe avec Mr. Forado (histoire) Belle jeunesse mêlée, chrétiens, musulmans et juifs !

En promenade avec J.P. Millecam philosophe
et écrivain. Magnifique paysage de Tlemcen !
Photos de la distribution des prix de 1952
|
Madame Martin me remet un prix. |
Deux « Justes » :
Mme Martin Directrice de L’EPS et de notre pension à qui je rends hommage parce qu’elle a donné des cours d’Anglais aux élèves juifs exclus et qu’elle a même tenu à assister à leur distribution des prix dans une « école juive ». Elle a répondu affectueusement à une de mes lettres d’Alger en signant : votre « Alma mater ».
Son mari Mr Martin, professeur d’histoire géographie« Fou Tchéou* pour des générations de potaches, manifestait son refus de Vichy en restant ostensiblement dans sa classe au moment du lever des couleurs instauré par Pétain. Il mérite notre reconnaissance pour son courage. Peu ont osé.
*Fou-tchéou ou futzu ou foochow à l’origine du sobriquet est le nom d’une bataille navale (23 août 1884) qui marqua le début de la guerre franco-chinoise qui dura 16 mois.
Alger : 1952-1961. « Les événements» et l’exode.
A Alger, enfin, j’ai vécu ce que nous appelions «les événements» et l’exode. Beaucoup de juifs, surtout modestes ont milité activement et quelques-uns même dans l’O.A.S, surtout à Alger et Oran, dans le désespoir, en 1962, de la perte de l’Algérie, la terre de leurs racines depuis des siècles.
Mais nous sentions bien que le vent de l’Histoire ne soufflait pas dans un sens favorable pour nous. Les plus lucides ont vite compris qu’il leur faudrait partir, certains même dès le milieu des années 1950, surtout dans le Constantinois où l’on n’oubliait pas 1934 et 1945, (c’est le cas de ma famille maternelle qui prit la décision de partir après les bombes du 20 Août 1955, rue Caraman et au cinéma A.B.C. et la mort du neveu de Ferhat Abbas dans sa pharmacie) mais nous n’avions jamais imaginé la tragédie finale.
Je ferai le récit de ce que nous avons vécu.
A partir de 1952, j’étais étudiante en hypokhâgne, puis en khâgne, au Lycée Bugeaud à Alger.
Alger est une capitale superbe, ouverte partout sur la mer. De la fenêtre de notre classe, au Lycée Bugeaud, nous surveillions l’état de la mer et dès le 1er Avril nous étions dans l’eau. Dans le quartier populaire de Bab-el-Oued, près du Lycée, j’habitais d’abord chez une vieille dame, Mme B., 2 Place Wuillermoz, au rez- de- chaussée, sur une cour intérieure où couraient des rats d’égout. Dans la cuisine, nous avions la visite presque quotidienne de petites souris intelligentes et peu méfiantes. J’ai pleuré quand l’une d’entre elles, minuscule, s’est laissé piéger par une souricière. Puis, nous avons loué, très cher,- une grave pénurie de logements sévissait-, un deux pièces, sans grand confort pourtant, dans un immeuble rénové, au 13 rue Fourchault, pas loin de la Place des Trois Horloges, juste en face d’une usine de tabac qui faisait un bruit infernal et dégageait une odeur âcre, irritante.
A Bab-el-oued vivait le petit peuple. Les origines juives, espagnoles, italiennes, maltaises, mahonnaises etc… se différenciaient de moins en moins. De tout ce « melting-pot » s’était forgé au fil des générations, dans le giron de la France, un type nouveau, avec son langage, son accent, ses mœurs, sa cuisine, représenté de façon pittoresque dans « La Famille Hernandez » de Geneviève Baïlac.
C’est seulement en 1962, après l’exode en France, que nous avons découvert, surpris, que nous étions des « pieds noirs ». Nous n’avions jamais entendu cette expression dont l’origine garde son mystère.
Conclusion du préambule.
Avec l’indépendance de l’Algérie en Juillet 1962, le pays s’est vidé de toute sa population juive qui pourtant vivait là depuis des siècles sinon des millénaires. Les juifs étaient présents sur cette terre avant la destruction du Second Temple par les Romains en 70, en même temps que les Phéniciens qui pratiquaient le commerce. Des vagues successives de persécutés sont arrivés au Moyen-Age de France, d’Angleterre et de toute l’Europe. En 1390, après les émeutes anti juives, et surtout après 1492 et l’Edit d’expulsion d’Isabelle La catholique qui visait aussi les Musulmans, pendant la «Reconquista», les juifs affluèrent nombreux d’Espagne en Afrique du Nord.
Cette population indigène, ce peuple qui avait subi, sans perdre son identité juive, successivement les invasions romaine, vandale, byzantine, arabe, turque et toutes les humiliations, persécutions et massacres et accueilli la France « pays des droits de l’homme et de la liberté »en 1830, a été entièrement balayée par cette dernière tempête de l’Histoire.
Tous les juifs ont quitté cette terre définitivement pour une nouvelle « Diaspora ».
130.000 arrivés en France, citoyens français déracinés.
En octobre 1962, il ne restait que 25.000 juifs en Algérie dont 6000 à Alger. En 1971 ils n’étaient plus que 1000. En 1982, 200. En 1990, pratiquement plus.
A Constantine, le vieux Kar chara, avec ses très vieilles maisons mauresques dont celle où est née ma mère, 79 rue Vieux, tombe en ruines. La Synagogue de mon grand-père place Négrier dite « Temple algérois » la plus récente pourtant, a été rasée pour laisser place à un parking. A Tlemcen, la vieille maison où ont vécu mes grands-parents Sicsic, 31 rue de France, n’a pas résisté aux travaux d’aménagement et s’est effondrée. Où sont nos tombes ? Même si elles n’ont pas été détruites par le temps ou les hommes ou profanées, je ne saurais les retrouver. Je n’envisage vraiment pas de pèlerinage. « lè fet met », comme disaient nos grands-mères. C’est dans nos mémoires que nous devons chercher la trace de nos ancêtres.
J’ai trouvé dans le FIGARO du 26 Janvier 2010 l’avis de décès du « dernier juif de l’Oranais », Messaoud Prosper Chétrit originaire du Maroc. Il était conservateur du cimetière israélite d’Oran. Il a été inhumé dans le lieu de mémoire dont il avait la garde.
L’Algérie a connu :
654ans d’influence phénicienne.
576ans de paix romaine.
104ans de destructions vandales.
113ans de vaine reconstruction byzantine
872ans d’occupation arabe avec les différentes invasions des Hillaliens, des Almoravides et des Almohades.
311ans d’arbitraire turc.
132ans de colonisation française.
II - Mon école au pluriel
Abrogation du décret Crémieux
• • •

La France de Vichy : la « Révolution Nationale ».
Oujda, Taza, Oran, Constantine 1939-1941
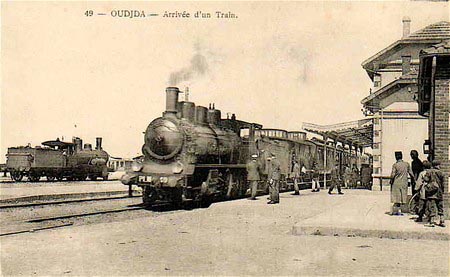 J’ai l’impression d’avoir toujours vécu en dehors de l’Histoire, mais lors de la Seconde guerre mondiale et surtout lors de la Guerre d’Algérie, elle a fait irruption avec violence dans notre quotidien. J’ai l’impression d’avoir toujours vécu en dehors de l’Histoire, mais lors de la Seconde guerre mondiale et surtout lors de la Guerre d’Algérie, elle a fait irruption avec violence dans notre quotidien.
Je n’avais pas 6 ans lors de la déclaration de guerre en Septembre 1939. Nous vivions encore au Maroc, à Oujda où je suis née, puis à Taza, une trouée dans les montagnes du Moyen Atlas. Je me souviens du voyage en train d’Oujda à Taza. En abordant la trouée de Taza, entre le Rif et l’Atlas, la pente devenait plus escarpée, le train ralentissait et nous traversions une série de tunnels, dont nous sortions nauséeux, enfumés, noirs de charbon, les cheveux pleins d’escarbilles. J’en ai définitivement perdu le goût des voyages en train même électrifié.
Mobilisation ! Guerre ! Ces mots qui affolaient les adultes n’avaient aucune signification pour moi.
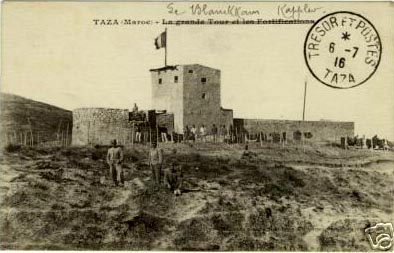 Mais j’ai vu mon père, amusé de ma perplexité, entortiller ses mollets dans de curieuses bandes molletières et, dans un costume de zouave, avec une chéchia rouge sur la tête, partir pour le « dépôt de Zouaves » no 21, un fort à Taza. Nous avons beaucoup grimpé sur des sentiers de l’Atlas, pour lui rendre visite à mi-chemin de cette caserne, puis dormi dans un abri de fortune, une sorte de dépendance de ferme ou d’écurie, Josiane sur deux sièges assemblés. Mais j’ai vu mon père, amusé de ma perplexité, entortiller ses mollets dans de curieuses bandes molletières et, dans un costume de zouave, avec une chéchia rouge sur la tête, partir pour le « dépôt de Zouaves » no 21, un fort à Taza. Nous avons beaucoup grimpé sur des sentiers de l’Atlas, pour lui rendre visite à mi-chemin de cette caserne, puis dormi dans un abri de fortune, une sorte de dépendance de ferme ou d’écurie, Josiane sur deux sièges assemblés.
A Casablanca, où mon père avait été muté du 10 juin 1940 au 27 juillet 1940, nous sommes aussi allées le voir. Le 17 juin 1940 Pétain demandait l’armistice.
Il faisait très chaud. Mon père, toujours en tenue de zouave, avec une chéchia rouge sur la tête, nous a rejointes dans un jardin public. Sur la photo qui a fixé ce moment, nous sommes assis tous les quatre sur une pelouse, Josiane et moi en maillots de bain avec de grands chapeaux. Mon père nous a apporté le chocolat de sa ration militaire. Ce gros chocolat noir m’a rendue si malade que pendant des décades, je n’ai plus mangé aucun chocolat. Sur la photo qui a fixé ce moment, nous sommes assis tous les quatre sur une pelouse, Josiane et moi en maillots de bain avec de grands chapeaux. Mon père nous a apporté le chocolat de sa ration militaire. Ce gros chocolat noir m’a rendue si malade que pendant des décades, je n’ai plus mangé aucun chocolat.
Le soir, nous avons déambulé dans la ville, ma mère trainant ses deux petites filles à la recherche d’un hôtel. En vain. La réquisition, l’afflux et la débandade après l’effondrement du 18 Juin !
La nuit tombait quand une femme âgée qui vivait avec sa fille, remarqua notre manège de son balcon, nous envoya chercher et nous invita à dormir chez elle avec une telle gentillesse que j’en garde encore un souvenir ému. J’étais si fatiguée de marcher !
De « l’Internationale » à « Maréchal nous voilà ! » en attendant le « Chant des partisans ».
Après la défaite et l’armistice de Juin 1940, j’ai vu mon père démobilisé brûler des papiers dans le haut poêle à bois de la salle de bains de notre maison de village à Taza. Il militait à la S.F.I.O (Section Française de l’Internationale Ouvrière), m’emmenait, le Dimanche, à Oujda, aux meetings à la « Casa d’España », probablement salle de réunion des Républicains espagnols exilés, où j’ai appris à entonner l’Internationale en levant mon petit poing.
Avec la tournure que prenait la « Révolution Nationale » de Vichy et le train de mesures dont allaient être victimes les juifs d’Algérie, mon père jugeait à juste titre ses documents compromettants pour un juif militant de gauche de surcroît.
L’idéologie du nouveau régime fit adopter, dès 1940, le vieux slogan : « la France aux Français » et commença dès lors la chasse à « l’Anti-France ». Furent exclus de la « Vraie France » tous les « ennemis intérieurs », les communistes, les « forces judéo-maçonniques » excellents boucs émissaires pour expliquer la défaite.
Les parents chuchotaient. Ils taisaient les souffrances morales et matérielles que leur imposaient le « statut des juifs » du 3 octobre 1940 qui excluait les juifs du corps de la nation et l’abolition du décret Crémieux le 8 octobre1940.
Une loi du 7 octobre signée Maréchal Pétain et Raphael Alibert, garde des Sceaux, abrogeait ce décret qui avait fait de nous, juifs indigènes d’Algérie, des Français, 70 ans plus tôt. Nous n’étions plus citoyens français et mon père fut rayé des cadres de la Fonction Publique.
Oran. Constantine.
Nous avons alors quitté Taza pour Oran, sans que j’aie bien compris pourquoi mon père abandonnait son guichet à la Poste pour cette boutique où il vendait, avec ma mère, du lait et du son contre des tickets de rationnement.
Pourquoi nous avions quitté notre appartement chez Mme Icare à Oujda, puis notre maison de village à Taza, pour une chambre d’hôtel à Oran où le piano de ma mère n’avait pas sa place ni les livres de la bibliothèque de mon père.
Mon père ne s’occupait plus de sa collection de timbres et surtout, il ne jouait plus du violon, accompagné de maman au piano, le soir, après son travail.
Ma sœur Josiane, trop petite, avait été confiée à mes grands-parents maternels à Constantine où les privations se faisaient moins sentir.
A partir de la défaite de 1940, l’Algérie, largement tributaire de la Métropole pour la plupart des produits, s’enfonça, en effet, peu à peu dans la pénurie.
J’avais des robes trop courtes et des pulls tricotés « maison » trop petits. Cela est visible sur la dernière photo de classe datée 1941 avant le renvoi en Octobre 1941, mais cela ne me gênait pas outre mesure.
Le bouleversement de notre vie ne me rendait pas malheureuse puisque j’étais avec mon père et ma mère. Les enfants ont une incroyable faculté d’adaptation. J’étais juste triste d’être séparée de ma petite sœur et jalouse de son costume marin avec une jupe plissée que ma grand’mère Clara lui avait acheté à Constantine. Costume marin indémodable depuis la reine Victoria qui s’était piqué, afin d’exalter la puissance de sa nation, de vêtir ses enfants de costumes marins miniatures. Nous avions reçu une photo de Josiane avec ce costume. Elle était vraiment mignonne et j’aurais bien échangé, parfois, ma place contre la sienne. Elle pouvait manger les poivrons et tomates séchés au soleil sur la terrasse à Constantine et conservés dans l’huile pour l’hiver. Et le beurre ! Il y avait donc du beurre à Constantine ! Je ne saurai que plus tard que c’était du « smen » !
Mais ma nouvelle vie m’offrait des moments excitants aussi. J’étais beaucoup livrée à moi-même.
Je traînais devant la boutique de mes parents et découvrais la rue et de nouveaux amis. Mon rêve aurait été d’avoir des patins à roulettes, ces magnifiques patins en bois, à défaut d’un vélo. Et j’allais encore à l’école !
J’ai eu juste le temps, à Oran, de boire de l’huile de foie de morue à la cuillère, et d’assister, le matin, en silence, au « lever des couleurs », puis d’entonner la Marseillaise et « Maréchal, nous voilà ! », puis minute de silence, avant qu’on ne me signifie que je n’étais pas assez française et que je n’avais aucune légitimité à rester à l’Ecole de la République.

Le « numerus clausus » : « C’est le renvoi ! ».
La loi du 21 juin1941, promulguée en Algérie le 23 Août, exclut 19.484 élèves juifs des écoles publiques. Elle interdit aux élèves juifs des écoles privées de se présenter aux concours et examens d’un niveau supérieur au Certificat d’Etudes.
Quand, en Octobre 1941, on m’a renvoyée de l’école, j’ai entendu que c’était parce que j’étais juive. Je ne savais pas exactement ce que juif signifiait, ou en avais une très confuse idée. Mon père était athée et refusait de se plier au rituel des fêtes juives. Il voulait « dépouiller le vieil homme ». Je savais juste que je ne ferais pas une communion solennelle, en robe de petite mariée, à l’église, comme mes camarades de classe. Dommage !
 J’ai compris alors qu’il n’était pas bon « être juif » et qu’il valait mieux ne pas en parler. J’ai compris alors qu’il n’était pas bon « être juif » et qu’il valait mieux ne pas en parler.
Je n’éprouvais aucune humiliation, mais peu à peu, parfois un fugitif sentiment diffus de culpabilité ! C’était peut-être un grave défaut, une tare même, puisque nous étions rejetés, réduits à une vie de parias !
Ma mère pleurait.
A Constantine, c’est la jeune institutrice du Jardin d’enfants, payant, du Lycée Laveran qui, prenant Josiane, 5 ans, désormais exclue, dans ses bras, pleurait en lui rendant son petit tablier et le panier d’osier tressé brodé de fils de laine multicolores dans lequel elle transportait d’ordinaire son goûter. Josiane, me raconte-t-elle, ne comprenait pas pourquoi sa « maitresse » pleurait.
Georges, 20 ans, renvoyé de la Faculté de Médecine d’Alger, voulait aller crier son mépris et son indignation au Lycée Laveran. Grand-père ne l’a pas convaincu mais a réussi à le retenir. J’ai vu Georges furieux, mais je l’ai vu pleurer aussi ! Une scène reste gravée dans ma mémoire. Dans la salle à manger, chez mes grands- parents, à Constantine, 4 étudiants juifs en médecine et pharmacie exclus de la faculté d’Alger, en plein désarroi, réunis. Ils ont pleuré, bu, et tout à coup, se sont mis à entonner à tue-tête en arabe sur l’air de la prière finale de Kippour, accompagnés au piano par le cousin Eugène S., étudiant en pharmacie, « ils ne nous aiment pas, et ne nous aimeront jamais, nous, les juifs ! » :
« Me habonech, ihoudiyim, me habonech abedem ».
 Ses compagnons d’infortune partis, Georges passa la fin de la journée à vomir ! Ce fut une vraie catharsis ! Immédiatement après, il se remit à travailler, apprit la comptabilité en trois mois et « quickness » (son nom de scout), recommença à foncer, comme il le fera plus tard sur le champ de bataille, confiant dans la vie. Ses compagnons d’infortune partis, Georges passa la fin de la journée à vomir ! Ce fut une vraie catharsis ! Immédiatement après, il se remit à travailler, apprit la comptabilité en trois mois et « quickness » (son nom de scout), recommença à foncer, comme il le fera plus tard sur le champ de bataille, confiant dans la vie.
On raconte qu’à Alger, un étudiant en pharmacie à l’appel de son nom, s’est levé en criant : « Alors, Jésus Christ aussi vous l’auriez mis dehors ! ».
Ma mère, à Oran, avait fait une vaine tentative pour m’inscrire dans une école privée dirigée par des Religieuses. Bien sûr, ces dames acceptaient d’accueillir cette petite mignonne. Il suffisait de me convertir au christianisme !
On pouvait donc ne plus être juif ? Ma mère pleurait toujours, sur le trottoir, rue d’Arzew, devant l’école d’où on venait de nous éconduire. Tout cela me paraissait trop compliqué ! Au fond je n’étais pas mécontente d’être mise en vacances, sine die…
Comme avec mon désœuvrement, je devenais sûrement encombrante, on m’a expédiée à Constantine, en attendant des jours meilleurs.
Nous nous sommes retrouvées, ma petite sœur et moi avec une telle joie chez mes grands-parents que nous avons failli tomber dans l’escalier en nous jetant dans les bras l’une de l’autre.
Certains de mes amis d’enfance de Constantine ont échappé à l’exclusion parce que leur père était un blessé de la guerre 1914, décoré. A l’école Diderot, où ils n’étaient que trois juifs, Mr M.., le Directeur et instituteur de Jean –Pierre A. qui venait d’obtenir 10/10 en rédaction, s’adressant à la classe, s’exclama : « Si ce n’est pas malheureux ! Un juif qui vous apprend à parler et écrire en Français ! ». Le même, plus tard, s’adressant à un enfant juif qui se dandinait en récitant, comme le font souvent les petits écoliers : « Eh ! tu te crois à la synagogue ! ». La parole antisémite était vraiment libérée mais les enfants blessés et humiliés s’en souviennent encore pour le raconter plus de 70 ans après. Et mon oncle Paul se souvient qu’au moment où on le faisait sortir au milieu d’un troupeau d’enfants juifs, exclus de l’école Diderot, regroupés après l’appel dans chaque classe, la cloche se mit à sonner sur l’air de : « ce n’est qu’un au revoir ! ». Compassion ? « Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour ? » ou ironie ?cynisme ?
« La révolution Nationale »

Philippe Pétain maître d’école
Périgny (Allier), octobre 1941.
Maréchal nous voilà !
1er couplet
Une flamme sacrée
Monte du sol natal
Et la France enivrée
Te salue, Maréchal !
Tous les enfants qui t’aiment
Et vénèrent tes ans (85 ans)
A ton appel suprême
Ont répondu : “«présents ! »
Refrain
Maréchal nous voilà
Devant toi, le sauveur de la France,
Nous jurons, nous tes gars,
De servir et de suivre tes pas,
Maréchal nous voilà !
Tu nous as redonné l’espérance :
La patrie renaîtra.
Maréchal, Maréchal, nous voilà !
L’auteur, André Montagnard, avait déjà connu le succès avec « un pastis bien frais ». Chanté par Jean Dasary.
En Octobre 1941, la cérémonie du lever des couleurs fut instaurée par le Maréchal Pétain. On hissait le drapeau tricolore. Puis le chant : « Maréchal, nous voilà ! » Puis minute de silence.
Mon amie de pension à Tlemcen, M.D. qui fréquentait l’unique école primaire du petit village D’Ain-Kial (1500 h environ) n’avait pas été exclue, bien que juive, parce que son père, combattant blessé de la guerre 1914, était décoré. Un matin, alors qu’elle s’avançait pour hisser le drapeau, elle fut arrêtée dans son élan par un brusque : « Ah ! Non! Surtout pas toi ! ».
Elle dit son mal - être, rejetée de ses ex-camarades exclues et des autres aussi. Ce « surtout pas toi ! » m’a poursuivie toute ma vie, dit-elle.
Pour faire contrepoint, j’ai le témoignage de mon amie Danièle G. scolarisée à Alger, à l’école de la rue de la Liberté, près de l’Hôtel Aletti. Elle raconte que Melle Ganté, la Directrice qui avait lu elle-même dans chaque classe la liste des élèves exclues, était en larmes en accueillant les parents à la sortie. Danièle parle « d’un épisode douloureux de sa jeunesse » qui a fait encore l’objet d’un rêve récent : habillée d’un tailleur jaune (jaune comme la rouelle du Concile de Latran ou l’étoile jaune !) elle est l’objet du mépris d’une camarade de classe qui lui tourne le dos. J’en ai gardé, dit-elle, un sentiment d’injustice et d’humiliation car j’ignorais le motif de cette discrimination.
La plupart du temps la liste des élèves exclues était apportée par le « chaouch » souvent un musulman : l’huissier, l’appariteur, le préposé aux registres d’absences qui passait chaque jour dans les classes. C’est le cas de mon amie de pension Evelyne D. qui, à Beni-Saf, convoquée ensuite chez la Directrice avec les autres élèves exclues, a gardé le souvenir d’avoir été poussée vers la sortie sans ménagement. Elle s’adressa ensuite au rabbin pour suivre les cours d’Hébreu, mais le rabbin n’acceptait que les garçons. Devant son insistance il finit par céder. C’était trop de discrimination ! Vraiment !
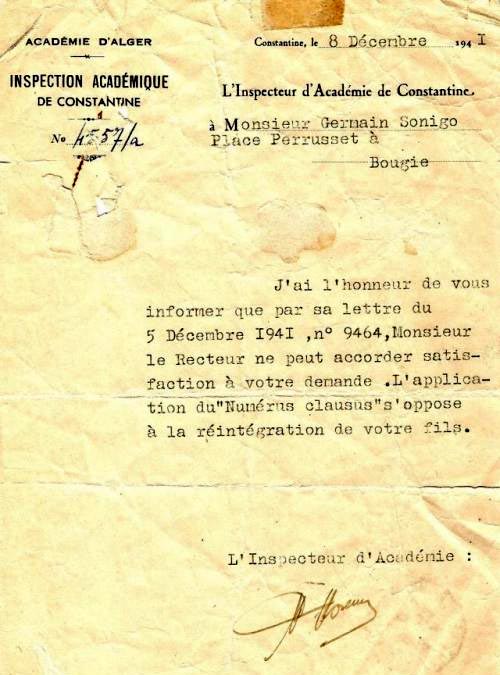
Lettre de l'Inspection Académique de Constantine
refusant la réintegration de Jean Sonigo,
beau-frère de l'auteur, au titre du numérus clausus
A Constantine.1941. « L’école juive »
A Constantine, la ville aux 10 synagogues, J’ai oublié que j’étais juive parce que presque tout le monde l’était autour de nous, dans notre quartier et même à l’école. J’ai le vague souvenir d’avoir fréquenté, de façon éphémère, une « école juive », peut-être le cours mis en place dans une grande villa située dans le quartier excentré du plateau du Mansourah offerte par Mr E. Tenoudji.
Le 19. 12. 1940, 465 professeurs et instituteurs juifs avaient été révoqués. Des professeurs éminents comme Robert Brunschvicg ou André Lévi valensi ont dû abandonner leurs fonctions à l’Université d’Alger.
Le tour des élèves allait suivre en Algérie.
Fin 1941-42, 70 écoles juives primaires et 6 secondaires réparties sur l’ensemble du territoire algérien fonctionnaient difficilement. Et contrairement au Maroc, le réseau de l’Alliance israélite Universelle n’existait pas. Classes ou petits cours improvisés la première année, mieux organisés la deuxième année dans des locaux privés, appartements, villas où les cours étaient dispensés par des maîtres en blouse grise, étudiants volontaires, souvent bénévoles, juifs chassés de leurs emplois, interdits d’enseignement. Ces malheureux faisaient de leur mieux avec des classes ou petits groupes le plus souvent mixtes, des horaires très abrégés, aménagés pour accueillir tous les enfants et des écoliers de milieu, d’âge et de niveau si disparates. Max M. raconte que, ne sachant plus comment occuper ses élèves, tous garçons, le maître les a emmenés, un jour, visiter une usine de tabac. Tous les élèves juifs n’ont pas eu la chance de suivre les leçons de français que Camus a données à Oran, à la demande de son ami le philosophe André Bénichou qui avait ouvert une école privée baptisée Cours Descartes. A la même époque Camus écrivait La Peste, métaphore aussi de la peste brune.
De ce passé englouti, surnage un instantané. Josiane et moi, assises côte à côte, dans une grande pièce pleine d’enfants, un jour de rentrée dans une « école juive »à Constantine et moi lui chuchotant : « tu as un mouchoir dans ta poche, mouche toi, sinon on va encore nous renvoyer ». Ce motif, en tout cas n’aurait pas été moins absurde.
Scolarité en pointillé qui ne semble pas m’avoir été d’un grand profit. Je m’installais au fond de la classe pour être tranquille. J’avais pris l’habitude de ne rien faire.
C’est seulement le 22 Octobre 1943, presque un an après le débarquement des Américains en Afrique du Nord, après des tergiversations sans fin des autorités que le décret Crémieux a été rétabli. Redevenus Français, nous avons pu réintégrer l’Ecole Publique après deux ans de vacance.
ORAN : le débarquement des Américains en A.F.N. Novembre 1942.
Nom de code : « Opération Torch » : Flambeau de la liberté

L’opération« Torch » ce flambeau de la liberté nous a sauvés.
Josiane et moi sommes revenues de Constantine à Oran au cours de l’année 1941-42. Mes parents avaient quitté la chambre d’hôtel où notre famille avait échoué à Oran, et loué un appartement où le piano et les livres avaient retrouvé une place. Du long balcon, en étage, qui donnait sur la rue d’Arzew, belle artère d’Oran, nous avons assisté au défilé des Américains après 3 jours de combats acharnés, de bombardements et le débarquement dans le port.« L’opération Torch »engageait 107.000 hommes sur 200 bâtiments de guerre et 110 navires de transport.

Elle se divisait en 3 groupes ayant pour mission d’établir 9 têtes de pont sur près de 1500 km de la côte du Maroc et de l’Algérie. (Pas de Tunisie : les troupes nazies et fascistes italiennes étaient à la porte, Pétain la leur ouvrira dès le 9 Novembre).
Maroc à l’ouest.
Oran au centre. Celui qui nous concernait directement.
Alger à l’est.
A ALGER, le débarquement du 8 Novembre 1942 avait été soigneusement préparé dans une villa près de Cherchell, par une poignée de résistants dont José Aboulker, alors étudiant en médecine de 22 ans, sous les ordres du général Mark Clarck débarqué clandestinement d’un sous-marin de l’U.S. Navy.
Le signal de l’action fut donné sur la fréquence de la radio de Londres : «Allo Robert ! Franklin arrive ! »
Robert Murphy était le consul des Etats Unis à Alger et Franklin Roosevelt, bien entendu le Président des Etats Unis.
Grâce aux résistants, il n’y eut, à Alger même, aucune opposition armée contre les troupes américaines. Les dirigeants du régime de Vichy comme le gouverneur général Chatel furent neutralisés. En moins de 15 heures la capitale militaire de l’Algérie tomba aux mains des Alliés. Ce succès fut le résultat de l’action conjointe des forces américaines et anglaises et de 400 résistants français qui se sont emparé avec de faux ordres de mission, par ruse, avant le débarquement, des points stratégiques.
Parmi les résistants les pertes ont été minimes mais tragiques et leurs circonstances misérables. Bd Baudin, devant le Commissariat Central, un Colonel a tiré à bout portant, du fond de sa voiture, sur le Capitaine Alfred Pillafort, un glorieux baroudeur, qui lui avait simplement fait signe de s’arrêter, en levant sa badine. Blessé au foie, le Capitaine Pillafort (37 ans) mourra à la clinique Solal, 4 jours plus tard. Et à la Grande Poste, le Lieutenant Jean Dreyfus diplômé d’H.E.C.28 ans (dont le frère cadet, Roger, engagé dans les forces françaises Libres, en 1940, avait déjà été tué en Février 1942 au Tchad) n’était même pas armé quand un adjudant l’a abattu d’une balle dans le dos. Deux héros lâchement assassinés ! Je leur rends hommage !

Capitaine A. Pillafort
|

Lieutenant J. Dreyfus
|
Mais, autour d’Alger, les pertes alliées ont été lourdes : accrochages avec les troupes vichystes tout le long de la baie, à Sidi Ferruch et aux approches de la ville, noyades au long de la falaise de Cap Matifou, un destroyer en feu, un autre et un gros commando coincé sur les quais sous les tirs de l’Amirauté.
Le pire cependant s’est passé au Maroc et à Oran où la tuerie n’a cessé que le Mardi 10 Novembre vers le soir. Des milliers de morts de part et d’autre. A Casablanca, dans le port, devenu un cimetière marin, la totalité de la flotte française fut détruite.
A ORAN, où nous vivions, la résistance a échoué et l’armée vichyste a engagé et poursuivi des batailles meurtrières le 8, le 9, et le 10 novembre contre les Alliés. Le 8 novembre 1942, la ville d’Oran ne fut pas prise de l’intérieur comme prévu. La résistance fut paralysée. Les résistants, 1500 environ, étaient en contact avec un chef militaire, le général Tostain, mais son supérieur hiérarchique informé le fit mettre aux arrêts. A leur arrivée, les Américains durent se battre contre les troupes de Boisseau et sur mer contre des batteries côtières dirigées contre eux. Les G.I. furent âprement combattus par l’armée française renforcée par les milices pétainistes des S.O.L. de Darnand (Service d’Ordre Légionnaire) fascistes.
De jeunes soldats américains furent tués et enterrés au cimetière de Del Monte spécialement créé. Dans le port d’Oran 17 navires français ont été coulés.
Ce débarquement fit dans l’ensemble de l’A.F.N. environ 4000 morts et blessés, pertes cumulées des Alliés et des troupes françaises.
Mais pour nous, enfants, inconscients de la tragédie qui se déroulait et des enjeux, le débarquement américain à Oran fut surtout un grand événement ludique.
Les forces du centre, celles d’Oran, qui nous concernaient, dont l’effectif était de 39.000 américains, sous les ordres du général de division le Major Général Lloyd Fredendall, avaient été réparties en trois zones : zone X à l’ouest, zone Y face à la ville, et zone Z à l’est.
Pendant trois jours, la sirène d’alerte stridente, les canonnades et les explosions furent incessantes, mais je ne me souviens pas avoir eu peur. Nous ignorions le danger. Dans notre candeur, il nous semblait que la bataille se jouait ailleurs, très loin au port, au large d’Oran. Nous ne nous sentions ni visés ni directement concernés. C’était l’affaire des soldats et les adultes nous rassuraient. Pourtant de cette zone Y face à la ville pouvaient pleuvoir des projectiles sur les façades d’immeubles. Et rue d’Arzew, près de chez nous, nous avons vu un immeuble endommagé.
Les hommes de la « défense passive », avec leurs sifflets rageurs patrouillaient et veillaient au strict camouflage des fenêtres. Toutes lumières éteintes, pendant les alertes nocturnes, à tâtons, nous nous préparions à descendre aux abris.
Une nuit, ma mère, affolée par la violence de la canonnade et des explosions qui ébranlaient nos murs, s’est précipitée dans la chambre que je partageais avec Josiane, a heurté, dans l’obscurité, un battant de fenêtre et a gardé, pendant plusieurs jours, une énorme bosse jaune violacée au front.
Après quelques tentatives pour nous réfugier à la cave qui décidément sentait trop mauvais, nous nous sommes réfugiés, avec nos voisins, au rez- de- chaussée, sous l’escalier, avec coussins et couvertures, en attendant la sirène qui hurlait la fin de l’alerte.
Josiane et moi étions soulagées que les adultes aient renoncé à la cave. Un horrible fait divers récent dont à Oran circulait la rumeur- les oreilles des enfants captent tout- nous avait vivement impressionnées. Une demoiselle T. avait tué sa sœur en lui lançant un fer à repasser à la tête puis dissimulé le cadavre à la cave. L’odeur avait donné l’alerte. Les caves sombres, humides et malodorantes restaient associées dans notre imagination à ce crime. Peut-être même, qui sait ?, des fantômes, lémures malheureux ou vengeurs, rôdaient-ils par ici, avec les rats.
Nous nous sommes aussi réfugiés chez une voisine, Mme Ch., parce que son appartement, sur la cour intérieure, loin de la façade de l’immeuble exposée aux « dégâts collatéraux » éventuels de la zone Y du port, nous paraissait, avec ses murs porteurs, pouvoir résister à tous les cataclysmes. Ma sœur Josiane a gardé un vif souvenir d’une brochette de petits voisins alignés, assis sur un canapé, à qui les adultes racontaient des histoires pour dissiper leur peur du « noir » imposé par le « blackout ». Nous chantions aussi, à tue-tête, dans la nuit, pour couvrir le vacarme des armes.
Elles ne se sont tues que le 11 Novembre 1942. A 2 h.30 du matin, le général Noguès avait ordonné la cessation des hostilités au Maroc et en Oranie conformément aux instructions transmises d’Alger. C’est dans ces deux secteurs qu’avaient eu lieu les combats les plus meurtriers.
Pétain, prévenu dès le 8 Novembre, avait ordonné de rejeter les Alliés. Pétain, ses ministres, son armée ont tiré sur les Alliés le 8, accueilli les Allemands en Tunisie le 9, et, sans tirer un coup de feu, les ont laissés envahir, en Métropole, la zone Sud non occupée, dite «zone libre ». Finalement, c’est avec l’Amiral Darlan, présent à Alger, appelé au chevet de son fils, atteint de poliomyélite, que le Commandant en chef américain a négocié un armistice général. Et le général Noguès, nommé par Pétain son seul représentant en A.F.N. a rallié Darlan.


Défilé des Américains à Oran.
Et c’est ainsi que du balcon du 21 rue d’Arzew, à Oran, nous avons vu défiler les Américains. Nous avions assisté, auparavant, dans cette même rue, à d’autres défilés et manifestations en l’honneur de je ne sais qui, au milieu d’une foule enthousiaste qui s’époumonait en agitant de petits drapeaux tricolores et en chantant : « Maréchal, nous voilà ! ».
Je me souviens juste, un lendemain de liesse populaire, de la rue d’Arzew jonchée de confettis et de petites cocardes bleu- blanc- rouge.
« La Révolution Nationale » de Vichy avait connu à Oran bien des « matins qui chantent ».
Maintenant, à leur tour, les Américains, dans la poussière, la fumée, dans un roulement infernal de véhicules occupèrent le pavé d’Oran avec leurs chars, leurs « G.M.C. », leurs jeeps, leurs treillis, leurs casques, leurs rangers et leur peau tannée par la traversée de tant de mers et des « Colonnes d’Hercule ».
Les patrouilles au brassard M.P. la Military Police investirent les rues, des colosses de 1m90 au moins, armés de matraques, chargés de faire respecter les interdictions « Off limit » qui fleurissaient à l’entrée de certaines rues ou bars. Le vin d’Algérie à 14° était mal supporté par les G.I. !
A Oran, les Anglais furent privés de débarquement à cause de la terrible tragédie de Mers El Kébir, le 3 juillet 1940,11 jours après l’armistice.
En mâchant nonchalamment leur chewing-gum à la cannelle, les G.I. américains lançaient de joyeux « hello » fraternels et des friandises aux badauds massés sur les trottoirs. Ma mère nous interdit d’y toucher. Des bruits couraient sur les diaboliques projets criminels d’empoisonneurs. Certes les Alliés n’avaient pas que des amis parmi les Oranais qui, outre Ste Jeanne D’Arc dont la statue devant la grande cathédrale était l’objet d’un culte, n’ont jamais pardonné aux Anglais l’horrible carnage du 3 juillet 1940, la flotte détruite et les 1300 marins et officiers français tués par les Anglais dans le port de Mers-El –Kébir, après l’armistice de la France avec l’Allemagne. Les témoins, les bénévoles (dont le père de mon amie de pension J. P.) chargés de recueillir les corps racontent l’horreur, la mer rougie, l’effroyable apocalypse !
Certes les rancunes étaient justifiées et tenaces, mais de là à instiller de la strychnine dans les bonbons, comme acte de vengeance ou de résistance pour déconsidérer les Alliés !
En observant de notre balcon du 2ème étage, ces tout jeunes soldats américains casqués, le visage rouge, brûlé de soleil : « Eh oui ! Me suis-je dit, ce sont des Peaux Rouges ! » Mais j’ai gardé cette réflexion pour moi.
J’allais fréquemment au cinéma avec notre voisine, ouvreuse au Régent et je ne triais pas trop les images des westerns !
Les Americains à Oran. (1): « welcome to you! »
Welcome to you! A hurlé Jacques de son balcon Place Pérusset à Bougie dans le silence figé ou hostile de ses voisins, quand, arrivés au son de leurs cornemuses, le Mercredi 11 Novembre, 18 Ecossais en 2 rangées avec leurs kilts et leurs chaussettes à pompons s’arrêtèrent sous ses fenêtres. Certains ont souri. Ils venaient, avec leur chef, négocier l’arrêt des hostilités avec le commandant de la Place de Bougie, Thery. Le matin, Jacques et son père, avaient découvert, de leur balcon, émerveillés comme des enfants devant le miracle d’une cheminée de Noel, une quarantaine de navires de toutes les tailles qui couvraient la baie de Bougie.
Le Dimanche 8 Novembre vers 20 heures, des miliciens qui connaissaient pourtant son père depuis l’enfance, étaient venus, sans ordre de mission, confisquer à sa famille leur poste de radio, « les juifs n’avaient plus le droit d’écouter la radio ! » une vexation de plus !
Par contre Jacques (19 ans) et son père (39ans) ont, un peu plus tard, avec une grande joie, répondu à la demande du Lieutenant Loti, un résistant, de servir avec leur auto de chauffeurs et de guides aux officiers alliés. Et c’est ainsi que jacques qui avait retenu un peu de l’anglais appris au Lycée devint « interpreter during the war ». (A prononcer avec l’accent bônois !) Jusqu’à sa mobilisation le 5 Mars 1943. Puis ce fut la campagne d’Italie, le débarquement en Provence et le détachement précurseur en Allemagne jusqu’à Sigmaringen.
Quel bouleversement dans nos vies que ce débarquement !
A Oran, mes parents abandonnèrent la boutique, 4 rue du Citoyen Bézy. Mon père fut remobilisé et, comme «indigène israélite », envoyé, avec interdiction de porter des armes, sous bonne garde de la Légion étrangère, dans un camp du Sud ramasser de l’alfa ou trier des munitions probablement, dernière humiliation avant le rétablissement du décret Crémieux et des droits des juifs d’Algérie comme citoyens français, presque un an plus tard.
Ma mère passa un concours et travailla aux écritures dans des bureaux de l’armée désertés par les hommes envoyés sur le front tunisien.
Avec les Américains, nous avons retrouvé du savon et même des savonnettes parfumées, découvert le chewing gum, les œufs et le lait en poudre, le corned beef, le beurre de cacahuète, les bonbons irisés comme des billes agate et le beurre salé dans de grosses boîtes métalliques.
J’aime le beurre par-dessus tout, mais entre le beurre des Arabes qui flottait dans l’eau de cuvettes émaillées, un peu rance, et ce beurre salé des Américains en grosses boîtes cylindriques, au goût ferrugineux, je sentais bien que la guerre n’était pas finie !
Par contre, le pain de mie blanc et moelleux comme des brioches des Américains, gratuit et obtenu sans ticket de rationnement, a redonné à Josiane le goût de manger.
Les « Liberty’s ships » transportaient aussi des pièges à rats, des moustiquaires et de la D.D.T. Guerre ouverte contre les nuisibles, anophèles femelles, punaises, puces, cafards, poux ! Le paludisme et les épidémies de typhus faisaient de terribles ravages, sans parler de la tuberculose, de la poliomyélite et des autres fléaux. La pénicilline découverte en 1929 en laboratoire n’était pas encore exploitée.
Nous étions partout infestés. Aussi tous les matins, notre literie entièrement « mise à l’air », nous débusquions les punaises hémophages qui colonisaient tous les recoins de nos lits en bois verni et nos matelas et sommiers à ressorts métalliques pour nous vampiriser à leur aise, la nuit, avec les moustiques. Nous répugnions à écraser les punaises à cause de l’odeur. On promenait une flamme sur les parties métalliques pour en finir avec elles. Ma mère se chargeait du saupoudrage jaune. Mais l’issue de la bataille était toujours incertaine et le combat à recommencer ! Les puces et poux capturés d’un geste vif entre le pouce et l’index étaient noyés dans un verre.
Apollinaire en fait un matériau poétique dans Alcools : L’émigrant de Landor Road v. 45 et suiv. : « Mais pour noyer changées en poux
Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent. . » Le D.D.T. : dichlorodiphényl-trichlorétane, insecticide puissant, fut d’un grand secours avant qu’on en découvre plus tard la nocivité pour l’homme aussi et qu’on le retire du marché.
Les Américains à Oran(2) : Les trafics.
« Au quartier Juif » : deux adolescents.
Deux témoignages : Maurice B., mari d’Huguette S., né le 21-12-1929 : « J’étais un voyou des rues »
Henri S., frère d’Huguette, né le 5-10-1928 : « Moi j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça. »
I. Maurice : « J’étais un voyou des rues »
Avec l’arrivée des Américains à Oran, se développa toute une économie parallèle de petits et gros trafics, sans parler des magouilles et du marché noir déjà existants. Le quartier juif, replié sur sa misère, rejeté, abandonné des services de nettoiement, déversa une nuée de gamins chassés de l’Ecole Publique en 1941, désœuvrés, livrés à eux-mêmes qui aussitôt se mirent à baragouiner suffisamment de « slang » pour se livrer à toutes sortes d’activités.
Les guides : La bande d’une dizaine de copains de Maurice, 13 – 14 ans, composée de Juifs et de 2 Arabes, servit de guide aux Américains pour des repérages et hissés sur des tanks par 2 ou 3, les gamins devenus « indicateurs », contribuaient à débusquer les miliciens pétainistes planqués, armés. Ils grandissaient dans les rues d’Oran et en connaissaient tout : l’enchevêtrement des venelles et terrasses, les impasses, les passages pour initiés, les doubles issues. Ils pointaient leur doigt : « This way ! This way ! ».
Un jour, d’un tank, des soldats américains tirèrent vers les étages supérieurs de« l’immeuble S..» (La pharmacie S.. se trouvait au rez de chaussée) un obus qui le traversa de part en part. Au coup de canon, les gamins, pris de panique, sautèrent du tank et décampèrent. Les prisonniers, mains au-dessus de la tête, furent emmenés « rampe Valès », vers le port.
Le troc : Le troc avec les Américains devint une activité rentable. Contre des bouteilles de vin, les gamins obtenaient des piles et toute sorte de marchandises qu’ils revendaient rue de la Révolution, rue de tous les commerces. Il arriva aussi que postés devant un immeuble à double issue, rue de l’Aqueduc, en quête d’un coup à faire, ils voient arriver des Américains éméchés : « You want wine ? One dollar ! ». Les pigeons paient, les garnements pénètrent dans l’immeuble, disparaissent par la seconde issue et se partagent le butin.La rue de l’Aqueduc était en contrebas de la rue d’Ulm et on passait d’une rue à l’autre par les maisons qui communiquaient entre elles.
Le mess : Maurice allait rôder boulevard Gallieni où se trouvait le « mess » d’une base américaine, aménagé dans un ancien garage, avec, à l’arrière, un champ dit « Chez Haldin ». Le « Petit Vichy », magnifique jardin public où nous passions des après-midi avec notre mère, Josiane et moi, n’était pas loin.
Maurice aidait à charger sur un Dodge tous les reliefs des repas et superflus dont les Américains repus se débarrassaient et au lieu de les déverser dans des déchetteries sauvages improvisées, il les vendait à un éleveur de cochons à Eckmühl. Parfois, il emportait des boites métalliques énormes de lait en poudre dont il faisait profiter son immeuble.
[A cet instant du récit, Huguette intervient : « Dommage que tu ne connaissais pas mon père à cette époque, avec le lait rationné et tous les petits dans la maison ! »]
La cordonnerie : A 5h du matin, Maurice se présentait Place d’Armes, la « Place aux Lions » qui jouxtait le « quartier Juif » : rue de Wagram, d’Austerlitz et de la Révolution, où les Américains embarquaient des travailleurs pour une usine installée avec des baraquements dans la forêt de Sidi Chami, une cordonnerie géante qui employait 200 ouvriers au moins.
Tri de chaussures, ressemelage, raccommodage et en bout de chaine 6 ou 7 gamins qui présentaient pour finition, les godasses à des rouleaux de brosses mécaniques préalablement enduites de cire d’abeille en blocs. A la sortie, fouille en règle, examen des pieds car certains n’auraient pas hésité à échanger leurs sandales. Aussi il ne restait que les lacets à chaparder, ce dont les garnements ne se privaient pas. Ils en attachaient autour de leur taille, puis il les revendait.
Ils ajoutaient ainsi quelques sous à ceux qu’ils avaient légitimement gagnés. Ils mangeaient à leur faim et la morale était à peine égratignée. .
Jusqu’au jour où Maurice, las de marcher pieds nus en tenant à la main ses sandales fatiguées pour les épargner, quitta son travail avec, aux pieds, des chaussures qu’il venait de briquer.
L’officier contrôleur s’en avise, l’envoie à la caisse chercher ses sous et le met « out for ever », dehors définitivement de la cordonnerie américaine. Il eut l’élégance, toutefois de lui abandonner les chaussures.
Les chapardages : Maurice raconte aussi tous les chapardages auxquels il se livrait avec ses petits copains, dans ces années de guerre et de privations. La faim, le dénuement, le désœuvrement mais aussi le goût du jeu à risque, de la provocation, le plaisir de transgresser les interdits, de s’inventer des règles sont de puissants moteurs pour développer chez les jeunes l’inventivité, l’ingéniosité, la débrouillardise. Les gamins rôdaient sur les quais du port d’Oran en quête de chargements accessibles. A défaut de proie, ils se baignaient dans l’eau douce de source toujours renouvelée des abreuvoirs destinés aux bêtes de somme, ânes et mulets, qui remontaient, lourdement chargés, les escaliers qui menaient au port. Le plaisir était d’autant plus vif que les plages à Oran étaient difficiles d’accès et l’eau du robinet saumâtre jusqu’en 1952 et rare. Avec des « cutters » improvisés à partir de morceaux de cerclages métalliques, patiemment affûtés sur le bord des trottoirs, ils entaillaient les sacs de jute et recueillaient dans des chapeaux, les dattes et les figues sèches qui se déversaient par la déchirure.
Juchés à califourchon sur les épaules d’un copain, ils suivaient le malheureux porteur marocain qui, ployant sous l’énorme charge de paquets de galettes de Pâque qu’il livrait, montait, courbé, péniblement en ahanant, la côte de la rue de Wagram et, au moment opportun, ils happaient des paquets qu’ils distribuaient ensuite autour d’eux.
Ici, Henri intervient : « moi, j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça ! »
L’épicier : Avec des crochets de fil de fer tressé, les gamins piquaient des olives et des variantes dans les jarres de l’épicier soupçonneux qui se plantait devant sa boutique, armé de sa louche perforée, dès qu’il les voyait approcher. C’est de cette même louche qu’il tapait sur les doigts des enfants qui plongeaient leurs mains dans ses tonneaux de saumure.
Les pastèques : Un marchand de légumes eut la malencontreuse idée de planquer un chargement de pastèques sur une terrasse, au 3eme étage, avant de les présenter au chaland, dans sa boutique. D’un balcon mitoyen, après escalade et acrobaties entre deux gros câbles électriques, avec le fils du commerçant, Simon B., complice de la bande, ils s’approvisionnaient en pastèques qu’ils consommaient aussitôt, sur place, en balançant les peaux par-dessus bord. C’est ainsi que le « père légumier », alerté par les pelures qui jonchaient la rue au petit matin, comprit le pillage et mit un terme aux agapes.
Maurice passait parfois la nuit dans le four de la boulangerie Ben A. qui appartenait au père d’un copain. Il assistait à la fabrication des fougasses, dormait sur des planches à même le sol et se régalait le matin des fournées chaudes et parfumées. « Mais, dit-il, je n’ai jamais fumé ni bu ! ».
II. Henri : « Moi, j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça ! »
Henri, mon cousin, qui vivait aussi dans ce quartier juif déshérité, au 22 rue de Wagram, exclu de l’Ecole Publique par les lois raciales de Vichy, aidait parfois mon père dans sa boutique ou accompagnait le sien, en car, chargé de valises dans ses tournées de colportage.
Trois victimes du « statut des juifs » un écolier : Henri et deux fonctionnaires des PTT : mon père Marcel S. et le père d’Henri : Gaston S.
Aux Américains, Henri se mit à vendre… des chapelets, de très fins chapelets si bien casés dans de petits dés métalliques qu’aucun croyant ne pouvait y résister.
Pour leurs « girls friends » restées au pays, il proposait de petites pochettes en soie rouges et noires imprimées de lèvres et d’yeux, faciles à glisser dans des enveloppes pour l’Amérique : « for the eyes and the lips » disait-il.
Il était accompagné dans ses démarchages par un de ses cousins du côté paternel : Roger, si petit et fluet qu’on le surnommait « Moustique ».
Henri changeait de trottoir quand il apercevait Maurice, tant il en avait peur : « Il avait l’air méchant, agressif, querelleur. C’était un bagarreur ! » Dit-il encore aujourd’hui, plus de 65 ans après, de celui qui est devenu le mari de sa sœur Huguette en 1954. Et en sa présence !
Henri, plutôt petit et menu, était un placide « éclaireur » qui patiemment chez lui sculptait son bâton de scout ou brodait avec minutie les fanions de son équipe d’éclaireurs juifs, au milieu des criailleries et du désordre de ses demi- frères et sœurs du 3ème lit de son père, 2 fois veuf.
C’est d’ailleurs dans son uniforme de scout, avec son sac à dos pour tout bagage qu’en 1948, il quitta Oran pour la France, passager clandestin sur un navire de guerre aux énormes cheminées : « le Georges Leygues », un croiseur qui transportait un camp scout pour un jamboree en France.
Henri s’est glissé sans titre de transport et sans argent au milieu de ses camarades E.I. qui pendant la journée et la nuit que durait la traversée pour Marseille, l’ont caché, nourri d’œufs durs et soutenu. Personne ne l’attendait en France. Il allait, seul, tenter sa chance à Paris, prêt à travailler dur pour réussir. Ce qu’il fit.

Le Georges Leygues
III. La trahison de « Zouzou »
Mais, pour Maurice, les événements prirent une tournure tragique quand son père, qui se livrait à des trafics moins anodins avec les Américains, se trouva impliqué dans une sombre affaire et finit en prison pour plusieurs années, en laissant femme et enfants, 4, dans une extrême précarité.
Maurice se souvient lui avoir apporté ses repas de midi, en alternance avec sa mère, à la prison du « Village Nègre ». Vers 1943, en cheville avec des soldats américains véreux le père fut complice d’un vol d’un camion GMC rempli de chemises de l’armée qu’il acheta pour les revendre.
Il en assura le recel dans une écurie située rue de l’Aqueduc, louche endroit, quartier de bordels qui se prêtait bien à des trafics scabreux. Mais « Zouzou » un épicier fromager, très connu dans le quartier juif, qui voulait sa part du gâteau, exigea une association et furieux d’avoir été évincé, s’adressa aux gendarmes.
Sur dénonciation de « Zouzou » donc, les gendarmes débarquèrent inopinément dans l’écurie et embarquèrent le tout.
Après une garde à vue, le père de Maurice, relâché, ruminant une féroce vengeance, s’arma d’un 6.35 et alla planter une balle dans le ventre de Zouzou.
Verdict : 5 ans de prison pour le père.
A sa sortie de prison, après remise de peine, il exigea de « Zouzou » rescapé, un dédommagement en deniers sonnants et trébuchants pour le prix de la marchandise payée et perdue, confisquée par la police.
« Zouzou » s’exécuta et la réconciliation se fit naturellement. C’est à Noël 1948 que la mère de Maurice, usée par les épreuves, mourut d’une douloureuse maladie, un cancer probablement. Elle n’avait que 38 ans. Dès lors, le père quitta l’appartement familial pour fonder un autre foyer, emmenant avec lui ses trois plus jeunes enfants. Maurice se trouva livré à lui-même, sa grand-mère maternelle restant le seul refuge. Il avait aussi un oncle, rue d’Isly à Alger : David L. Maurice vécut de petits boulots, tenta de fuir Oran sur un bateau en partance pour Marseille mais il n’était pas encore majeur (majorité : 21 ans à l’époque) et son père intervint pour qu’on le débarquât manu militari.
Ces récits Maurice et Henri, les ont faits, sur une terrasse de Juan Les Pins, par une magnifique journée d’été ensoleillée, 65ans après la guerre.
Ils ont eu une enfance à Oran et des débuts à Paris, difficiles. Ils ont fui l’Algérie et la misère du « quartier Juif » d’Oran bien avant l’exode qui a suivi la guerre d’Algérie, en quête d’un avenir meilleur.
Et Maurice rit aujourd’hui de ce « petit voyou des rues » que les circonstances de la guerre et les fréquentations avaient fait de lui jadis, dans ce quartier déshérité.
Les Américains à Oran(3) : Hollywood ! Hollywood !
A l’arrivée des Américains, les jeunes femmes en mal de mâles, hissées sur les semelles compensées en liège, en bois ou en raphia de leurs chaussures en peau de lézard ou de crocodile arrivée en contrebande d’Afrique Noire –le cuir était très rare-, les cheveux ramassés en deux coques gonflées de postiches au sommet du crâne, se mirent bientôt à danser le « cheek to cheek » avec les jeunes Américains au milieu des volutes parfumées de cigarettes blondes.
.On découvre aussi les bas nylons.
Blues, jazz, swings et slows apparaissent sans détrôner pour autant la comparcita, castagnettes, fandangos et tangos à Oran, ville espagnole, comme chacun sait.
Les langueurs sucrées des crooners américains, Bing Crosby, Frank Sinatra etc… ont supplanté Reda Caire et même Tino Rossi.
Enfants, nous découvrions, émerveillés, les toniques comédies américaines d’Hollywood.
Leurs stars entraient dans tous nos jeux. Nous rêvions de faire des claquettes et de danser comme Shirley temple, Ginger Rogers (Mais sans Fred Astaire que nous trouvions laid) ou Cyd Charisse, de chanter comme Janet Mac Donald, Deana Durbin ou Judy Garland, de nager comme Esther Williams, de plonger comme la Jane de Tarzan, de patiner comme Sonja Heini.
Les féeriques ballets de « Barbies » avant la lettre, avec leurs décors à paillettes, aux couleurs de guimauve et de gâteaux d’anniversaire, nous fascinaient.
Et avec le Happy End assuré, nous ne redoutions plus les méchants. Nous savions que le Bien l’emporterait.
Mais le réel est entêté. Tragique et incompréhensible quand le destin absurde se mêle à la folie des hommes :
Le maçon italien :
La chambre que je partageais avec Josiane et la cuisine s’ouvraient sur une vaste cour intérieure. Des passerelles réunissaient deux corps de bâtiments. En face de nous, sur cette cour, vivait une famille cosmopolite : deux sœurs françaises mariées l’une avec un Allemand, l’autre avec un Italien et un adolescent blond et bâti qui faisait rêver les petites filles : notre camarade Jean Golénia.
Après le débarquement américain, les deux maris furent jetés en prison, comme étrangers de « nations ennemies ». Peu après sa libération, l’Italien, un honnête maçon, mourut au travail, en tombant d’un échafaudage.
Je vis le désespoir de sa jeune femme, ouvreuse au cinéma le Régent. C’est elle qui m’installait sur son strapontin, au fond de la salle, aux séances de l’après-midi où elle m’emmenait.
« Darlan est mort ! Il a été assassiné ! »
Un visage si jeune presque un enfant !
Et c’est dans un climat de désordre, de tension et d’incertitude que le 24 Décembre1942, l’Amiral Darlan, « l’expédient  provisoire » pour Churchill, qui avait signé l’armistice avec les Alliés fut assassiné par un jeune homme de 20 ans : Fernand Bonnier de la Chapelle qui avait été condisciple de Jacques, en « philo » au Grand Lycée d’Alger (futur Lycée Bugeaud, puis Abd El Kader). Darlan symbolisait à ses yeux la trahison de Vichy. Le jeune meurtrier fut tiré au sort par les membres du complot. Ils avaient été quatre à tirer à la courte paille, à la ferme Demangeat où ils attendaient leur départ pour le front tunisien : Bonnier, Gross, Ragueneau et Tournier. provisoire » pour Churchill, qui avait signé l’armistice avec les Alliés fut assassiné par un jeune homme de 20 ans : Fernand Bonnier de la Chapelle qui avait été condisciple de Jacques, en « philo » au Grand Lycée d’Alger (futur Lycée Bugeaud, puis Abd El Kader). Darlan symbolisait à ses yeux la trahison de Vichy. Le jeune meurtrier fut tiré au sort par les membres du complot. Ils avaient été quatre à tirer à la courte paille, à la ferme Demangeat où ils attendaient leur départ pour le front tunisien : Bonnier, Gross, Ragueneau et Tournier.
Il n’y a pas eu de trêve de Noel. Le tribunal militaire a délibéré d’urgence et prononcé la mort de Fernand Bonnier de La Chapelle.
Giraud a refusé la grâce pour ne pas se compromettre et Bonnier a été fusillé à la hâte le lendemain 26 Décembre à l’aube, quelques heures avant l’enterrement de Darlan.
Presque tous ceux qui avaient été mêlés à cette triste affaire se sont longtemps demandé si la mort de Darlan avait valu celle de « ce pauvre gosse ».
Bonnier fut réhabilité en 1945 et 10 ans plus tard Vincent Auriol lui décerna la médaille militaire, la Croix de guerre et la médaille de la résistance.
Et Giraud succéda à Darlan devant lequel il s’était effacé auparavant.
Qu’est-ce qu’elle connaît cette gamine ?
Cet assassinat avait fait les gros titres des journaux et je me souviens que chargée par mon père, pas encore remobilisé, d’acheter le quotidien, l’écho d’Oran, j’étais remontée en criant : « Darlan est mort, il a été assassiné ! ». Et mon père, surpris et amusé : « Mais qu’est-ce qu’elle connaît, cette gamine ? ».
Je venais juste d’avoir 9 ans et je captais des bribes de conversations ou d’émissions à la radio, des allusions mystérieuses, des évocations de tractations confuses où surnageaient des noms : Roosevelt, Churchill, Pétain, Noguès, Giraud, de Gaulle, Darlan et bien sûr Hitler. Mais je ne comprenais rien. Je savais juste que nous devions nous réjouir de l’arrivée des Alliés et qu’Hitler était le nouvel Aman. Bientôt, à Pourim, on ajouterait ses oreilles à celles des autres bourreaux du peuple juif. N’avait-il pas déclaré : « les juifs ne connaîtront pas un second pourim » ?
En Tunisie
Mais d’autres combats âpres et décisifs pour notre avenir et celui du monde se déroulaient ailleurs. Et d’abord en Tunisie où les Allemands avaient pénétré dès le 9 Novembre.
L’armée d’Afrique fut reconstituée, tous les hommes valides de 18 à 40 ans mobilisés. Les Juifs appelés en qualité d’indigènes et non de citoyens français, le décret Crémieux abrogé n’ayant pas été rétabli. Lire, à ce sujet, le récit de Jacques qui a vécu cette mobilisation.
L’oncle Gilbert S., décoré de la croix de guerre pendant la campagne de France, avait, à ce titre, conservé la nationalité française. On l’avait retirée aux juifs, mais lui ne fut apparemment pas repéré comme juif, à cause de son nom, et il fit la campagne de Tunisie lancée contre l’Afrika Korps et l’armée italienne, chassée de Lybie par la 8ème armée britannique.
Et le décret Crémieux ?
Mes parents évoquaient à voix basse le statut des juifs, l’abrogation du décret Crémieux et les discussions en haut lieu pour son rétablissement.
Le maintien de l’abrogation représentait pour Giraud un progrès (!) qui rétablissait l’égalité raciale ( ?) entre le juif et l’Arabe : « celui-ci travaillant à l’échoppe, celui-là dans le bled à la charrue, sans que l’un ait le pas sur l’autre, la France assurant à l’un et à l’autre sa sécurité et sa tranquillité ».
En juillet 1943 seulement, avec de Gaulle jusqu’ici tenu à l’écart par les Anglais et les Américains, le statut des juifs fut enfin abrogé. Le décret Crémieux ne sera rétabli que le 23 Octobre 1943 et en Octobre 1943 je repris avec les écoliers juifs le chemin de l’école. Non ! Pas de l’échoppe !
« Après Pétain, c’était encore Pétain ! »
Déjà Achiary, Brunel, Aboulker père et fils et bien d’autres avaient été arrêtés après la mort de Darlan et emprisonnés ou déportés vers les camps du Sud. Des résistants au régime de Vichy avaient été internés et des camps de concentration ouverts dans le Sud oranais. On a retrouvé des étoiles jaunes toutes prêtes dans les mairies. En Métropole, Pétain avait laissé les Allemands pénétrer en zone Sud dite « libre » jusque-là, et les arrestations de civils juifs par les Nazis se multipliaient. En Tunisie également, occupée par les troupes de la Wehrmacht de la mi-novembre 1942 au 7 Mai 1943, on recensait les juifs et on confisquait leur or. 64 jeunes hommes juifs de 17 à 25 ans sont morts déportés ou dans les camps de travail (47 dans les camps de travail et 17 déportés ne sont jamais revenus).Le 8 Nov. 1942 nous a épargné les atrocités de la déportation.
Sans les Américains et les Alliés, c’est sans doute un autre chemin que celui de l’Ecole que nous aurions pris, nous, enfants juifs.
Fin du « numerus clausus » :
Oran : 1943-1944 : L’hygiène d’abord !
Mon retour à l’école eut lieu en 1943, à Oran, où revenues chez nos parents, enfin correctement logés, nous avions vécu le débarquement américain, en novembre 1942.
J’avais à Oran en classe du cours moyen, une institutrice très petite, avec un chignon de cheveux déjà grisonnants, laineux et crépelus, qui avait deux petites filles de notre âge, mais qui me paraissait plutôt vieille et sans grâce.
Elle était sûrement une bonne enseignante, mais mon cerveau était resté trop longtemps en friche et, sans bases scolaires solides, j’avais une peur panique de la grammaire et des dictées quotidiennes.
Cette institutrice, très attachée à l’hygiène, nous exhortait à laver nous-mêmes, tous les soirs, les fonds de nos petites culottes. Les classes n’étaient pas mixtes, alors, ni les Ecoles : nous étions entre filles.
Tous les matins, une règle dans chaque main, juste avant la leçon de morale, suivie par l’exercice de calcul mental sur nos ardoises cassables en vraie pierre de schiste, la « maîtresse » partait en guerre contre la crasse, les poux, le typhus et la gale.
De table en table, elle nous inspectait, une à une, les mains et les ongles recto-verso, et, avec ses deux règles, elle trifouillait nos cheveux pour s’assurer que nous n’avions ni poux ni lentes. Sinon, c’était la Marie Rose ! En cas de récidive, les têtes étaient rasées pour plus d’efficacité du produit. Honte aux têtes rasées sous les carrés de coton qui dissimulaient parfois de vilaines croûtes de teigne !
Là, ma scolarité, déjà perturbée par des changements multiples, a un peu piétiné.
Constantine 1944-1945 : Enfin au travail !
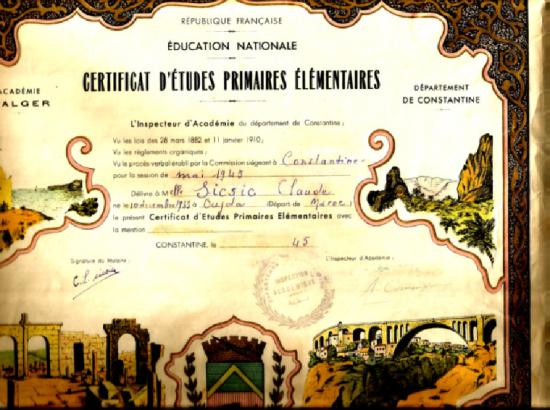
C’est à Constantine que j’ai pris à cœur de réussir à l’école. La Directrice de l’Ecole Primaire Ampère, rue Nationale, avait consenti à me réintégrer, en Octobre 1944, faute de place ailleurs, dans la classe du Cours Supérieur, réservée d’ordinaire aux élèves destinées à un cycle scolaire court. Mon oncle Maurice, reconnaissant, lui a offert un coupon de plusieurs mètres de percale blanche qui a peut-être fini de la convaincre que j’avais le niveau requis. Une rareté ! La guerre n’était pas finie et nous manquions de tout.
L’ambiance chez mes grands- parents était sécurisante, notre vie bien réglée, aussi ai-je réussi coup sur coup, à l’examen de 6ème, à la Bourse et au Certificat d’Etudes, en Juin 1945. Au Printemps 1945, je rabâchais, assise sur le bord du petit balcon qui surplombait le Rhumel, 44 rue Thiers, tous les départements français avec leurs chefs-lieux, toutes les colonies et comptoirs français d’Outre-Mer : Chandernagor, Karikal et Mahé, etc. etc. Chandernagor, Karikal et Mahé étaient des comptoirs français de l’Inde jusqu’en 1951 pour Chandernagor et 1954 pour les deux autres. Et toutes les colonies nombreuses encore sur tous les continents en 1945 et toutes les dates de l’histoire de France qu’il fallait savoir par cœur pour le Certificat d’Etudes. Je m’amusais avec les ludiques problèmes de robinets qui fuient et de trains décalés en retard mais j’avais toujours une peur panique de l’orthographe. Je redoutais ce couperet-là : 5 fautes= 0 ! Elimination !
On n’entrait en 6ème au Lycée qu’après avoir passé un examen exigeant ! Autre temps !
De cette année-là, j’ai gardé le souvenir d’une salle enfumée par le feu de bois d’un grand poêle que nous allumions nous-mêmes, d’engelures qui m’empêchaient d’écrire en arrivant de l’extérieur les jours de grand froid, d’une institutrice presque toujours assise qui gardait , le plus souvent, son chapeau sur la tête, du crissement insupportable de la craie sur le tableau noir, des plumes sergent Major avec leurs pleins et leurs déliés sur les cahiers quadrillés, des buvards maculés, de l’odeur sèche persistante de la craie, de celle âcre de l’encre violette dans les petits encriers de faïence blanche et les bouteilles à bec verseur, de la délectable odeur douceâtre d’amande amère des petits pots métalliques de colle blanche avec leurs pinceaux et des bouts de bougie avec lesquels nous cirions et lustrions avec énergie nos pupitres noirs tous les samedis après-midi consacrés à des activités libres. Rangement de nos casiers, nettoyage de la classe, tricotage, couture, lecture, essentiellement. Peu de dessins. Nous manquions de crayons de couleurs.

Nous apprenions à compter avec des allumettes que nous gardions une à une après usage.
Puis ce fut le Lycée Laveran à Constantine de 1945 à 1948.Que dire ? J’y ai très bien travaillé et très bien réussi, avant le Collège de Slane à Tlemcen, de 1948 à 1952, et l’obtention du bac, puis le Lycée Bugeaud en Khagne et la Faculté d’Alger, puis la Sorbonne et l’Agrégation de Lettres Classiques… Et à nouveau des Lycées !
III - A Oran, sous Pétain
L’époque de l’épicerie
1941-1943.
Petits souvenirs en pointillé
• • •
L’époque de l’épicerie 1 : L’eau douce à Oran.
Les marchands d’eau douce, le marchand d’ « oublies », l’eau douce du pot à lait.
Après l’exode des « pieds noirs » d’Oran, qui ne sont pas restés longtemps parqués dans le « camp de réfugiés » de sainte Marthe à Marseille, ancien camp militaire de la 1ère armée française en 1944, où les autorités avaient entassé les plus malheureux Français d’Algérie en Juillet 1962, certains Oranais, dit-on, poussèrent la nostalgie jusqu’à ajouter du sel dans leur café pour garder le goût de « là-bas ».
A Oran, l’eau du robinet était saumâtre jusqu’en 1952.
En Septembre 1952*, la construction du barrage de Beni Badel près de Tlemcen achevé, les Oranais purent, enfin, grâce à cette station de filtrage, recevoir l’eau douce courante du robinet. Le 27 juillet 1952** ce fut une grande fête à la Place d’Armes. La municipalité réunit, pour une anisette géante « à l’eau douce » accompagnée de « kémia » (tramousses, « longanisse », soubressades, olives, « bliblis » (pois chiches grillés), « pépites » graines sèches salées de courge, melon et pastèques etc…) toute la population oranaise autour d’immenses tables.
Jusque-là, on s’accommodait de l’eau salée au robinet, on achetait l’eau douce ou on allait la chercher à la source.
« Jeune fille à la source » mais sans la grâce mystique de Rebecca au puits, sa cruche sur l’épaule, Huguette, ma petite  cousine, allait, en bas de la rue de Wagram, à 500m environ, chargée d’un seau, d’un bidon ou d’un pot à lait en aluminium, puiser de l’eau à une fontaine alimentée par une source d’eau douce, rue du Mont Thabor, la bien nommée « Crève-Cœur », tant étaient rudes les escaliers au retour. Malheureuse enfant, elle fut chargée de cette corvée. Et aucun Jean Valjean pour soulever le seau à sa place ! cousine, allait, en bas de la rue de Wagram, à 500m environ, chargée d’un seau, d’un bidon ou d’un pot à lait en aluminium, puiser de l’eau à une fontaine alimentée par une source d’eau douce, rue du Mont Thabor, la bien nommée « Crève-Cœur », tant étaient rudes les escaliers au retour. Malheureuse enfant, elle fut chargée de cette corvée. Et aucun Jean Valjean pour soulever le seau à sa place !
Des marchands d’eau douce de la source Bredeah livraient, maison après maison, dans des charrettes tirées par un ou deux bourricots ou mulets, des bonbonnes de 5 ou 10 litres en verre épais recouvert de raphia ou d’osier.
D’autres transportaient à dos d’âne de grandes bonbonnes paillées ou de petits tonnelets. « Agua ! Agua ! » criaient-ils en espagnol
Aussitôt accouraient femmes, enfants. L’eau était aussi vendue au détail, versée directement avec un gros entonnoir cabossé dans les récipients hétéroclites que tendaient les acheteurs.
 Des marchands arabes d’eau douce, sangle de cuir terminée par deux crochets sur les épaules, un cerceau autour de la taille, livraient l’eau puisée à la source dans deux seaux dont l’anse était suspendue aux crochets. Des marchands arabes d’eau douce, sangle de cuir terminée par deux crochets sur les épaules, un cerceau autour de la taille, livraient l’eau puisée à la source dans deux seaux dont l’anse était suspendue aux crochets.
Dans la journée, des marchands d’eau arabes, agitant une petite clochette, une outre en peau de chèvre avec un bec verseur ou un robinet en cuivre sur l’épaule, proposaient à boire en arabe : « l’mé khlo ! ». Pour quelques sous, ils servaient l’eau dans des timbales semi sphériques en cuivre jaune étincelant, plus rarement en fer blanc, qui pendaient à leur épaule et à leur ceinture. Pour l’étanchéité, du goudron tapissait l’intérieur de l’outre et donnait à l’eau une odeur et un goût singuliers, comme légèrement anisés.
Même à Oujda où l’eau du robinet était  douce, on trouvait, dans la chaleur torride de l’été, ces marchands d’eau « gerrabes» plus pittoresques avec leurs grands chapeaux de paille multicolores, à côté des marchands « d’oublies », gaufres minces et légères, très friables, roulées en cylindres creux, transportées par le marchand ambulant sur le dos, dans de grands cylindres en tôle de fer et cuivre. douce, on trouvait, dans la chaleur torride de l’été, ces marchands d’eau « gerrabes» plus pittoresques avec leurs grands chapeaux de paille multicolores, à côté des marchands « d’oublies », gaufres minces et légères, très friables, roulées en cylindres creux, transportées par le marchand ambulant sur le dos, dans de grands cylindres en tôle de fer et cuivre.
La seule vue des outres gonflées d’eau déclenchait chez nous, enfants, une soif irrépressible. Mais ma mère ne consentit jamais à nous laisser boire de cette eau-là. Par contre, elle cédait parfois à l’appel de l’espèce de crécelle (une planchette avec une poignée) au claquement sec avec laquelle le marchand d’oublies rameutait les enfants. Et quelle joie si nous avions la chance de gagner un « oublie » supplémentaire en jouant à la « roulette » cette petite roue de loterie qui se trouvait sur le couvercle et dont la flèche désignait le nombre d’oublies auxquels le client avait droit : 1, 2 ou 3 !

Une boîte à oublies de 84 cm du XIXème siècle identique à celles de mon enfance qui étaient parfois bleues avec ou sans décors (Musée de l’Ile De France. Domaine de Sceaux.) L’« oublieur » marchand ambulant « d’oublies » est décrit dès le XIIIème siècle.
Aujourd’hui les « oublieurs » et leurs « oublies » (du grec obolies gâteaux vendus pour une obole et du latin oblata : choses offertes,) ont disparu et sont remplacés par les gaufres chaudes cuites à la demande. *1948 ou 1952 ?
**la date de cette festivité diverge selon les témoins. Qui donnera la date exacte ? 1948 ? 1952 ?
Ma mère et l’eau douce du pot à lait.
A Oran, nos ressources étant maigres, ma mère achetait l’eau douce au détail, avec parcimonie.
Un jour où elle cheminait, rue de la Bastille, de la petite boutique, 4 rue du Citoyen Bézy, où mes parents ont vendu de 1941 à 1943 du lait et du son contre des tickets de rationnement, pour se rendre chez nous, 21 rue d’Arzew, elle a été interpelée méchamment par une harengère. Ma mère avait acheté 2 litres d’eau douce qu’elle transportait dans un pot à lait en aluminium. A la vue du pot à lait, la mégère de vociférer : « Ah ! pour vous, vous en avez du lait ! ».
Ma mère, aussitôt, tranquillement balance à ses pieds le contenu du pot, et calmement :
« Voilà ! Je vous le donne ! ».
Je garde, de cette scène, un souvenir très vif, parce que j’étais choquée et blessée. Ma mère, était impulsive. Elle a, certes, perdu son eau douce mais cloué le bec de la femme, hargneuse et sûrement antisémite, dans cette Oran pétainiste où il était de bon ton d’être « antijuif ».
Mes parents n’étaient pas faits, dans le climat de l’époque, sous Vichy, pour ce genre d’activité.
Mon père était un musicien, passionné d’art et de littérature, un homme dont les talents sont finalement restés en marge d’une vie de fonctionnaire des Postes. Sa droiture ne pouvait s’accommoder des magouilles et du marché noir de l’époque ni sa nature réservée de la vulgarité à laquelle il se trouvait forcément confronté.
Par chance, après le débarquement des Alliés en Novembre 1942, mon père a été remobilisé le 1er Février 1943 et « dirigé » sur le C.O.33 des F.T.A A410 ( ?! ) à Marrakech, certes dans des conditions humiliantes en tant qu’ « indigène israélite » soumis à des travaux dégradants avec interdiction de porter des armes. Cette appellation figurait sur son livret militaire. Les « indigènes israélites » ne devaient pas combattre pour qu’ils n’aient pas à s’en prévaloir plus tard. On les envoyait sous bonne garde de légionnaires dans les camps du sud, Bedeau, Telergma, en Algérie, par exemple.
Ma mère a passé un concours pour travailler aux écritures dans les bureaux de l’armée désertés par les hommes envoyés sur le front tunisien. Elle a commencé un travail de bureau qu’elle a exercé jusqu’à sa mort en 1974.
L’époque de l’épicerie 2 :
Invasion de sauterelles à Oran.
 A la même époque, un nuage noir de sauterelles survola la ville. Une éclipse de soleil! Les plus fatiguées s’abattirent sur nous. Cette « manne » du désert nous envahit. Il y en avait partout. Certains adultes les grillaient en brochettes et les consommaient comme en Afrique ou comme les Romains de l’Antiquité qui en faisaient de la farine et des pâtisseries au miel. Aujourd’hui certains font la promotion des insectes, larves de scarabées ou nymphes de cigale, comme substituts intéressants aux protéines animales ordinairement consommées en Occident. Certes les insectes occupent moins de place que les vaches dans les prés normands sans parler des gaz à effet de serre mais la chasse est improbable, trop d’insecticides, de désherbants! (presque plus de papillons tachetés voletant par deux ni de chenilles dans les jardins, ni scarabées dorés ni bousiers, ni mantes religieuses ni abeilles butineuses comme dans mon enfance) et l’élevage des insectes après celui des ovins, bovins, caprins, équins, porcins, autruches, volailles et poissons est encore aléatoire* ! Attendons ! A la même époque, un nuage noir de sauterelles survola la ville. Une éclipse de soleil! Les plus fatiguées s’abattirent sur nous. Cette « manne » du désert nous envahit. Il y en avait partout. Certains adultes les grillaient en brochettes et les consommaient comme en Afrique ou comme les Romains de l’Antiquité qui en faisaient de la farine et des pâtisseries au miel. Aujourd’hui certains font la promotion des insectes, larves de scarabées ou nymphes de cigale, comme substituts intéressants aux protéines animales ordinairement consommées en Occident. Certes les insectes occupent moins de place que les vaches dans les prés normands sans parler des gaz à effet de serre mais la chasse est improbable, trop d’insecticides, de désherbants! (presque plus de papillons tachetés voletant par deux ni de chenilles dans les jardins, ni scarabées dorés ni bousiers, ni mantes religieuses ni abeilles butineuses comme dans mon enfance) et l’élevage des insectes après celui des ovins, bovins, caprins, équins, porcins, autruches, volailles et poissons est encore aléatoire* ! Attendons !
Les sauterelles étaient de tous nos jeux d’enfants et l’occasion de cours de sciences naturelles approfondis pour ceux qui n’avaient pas été chassés de l’école.
Surmontant notre appréhension, nous essayions de lire et d’interpréter les chiffres inscrits sur leurs élytres. Un fil à la patte, nous les attachions sur les grilles des balcons, convaincus de pouvoir les apprivoiser et prolonger leur vie. Nous cherchions à nourrir ces moribondes, à leur donner à boire cette eau saumâtre qui coulait du robinet. Au bout de quelques jours, faute de sauterelles, nous passions à d’autres distractions.
Clara me raconte (Février 2010) que, lors de son camp de scouts de l’été dernier, certains, ne trouvant aucune contre-indication dans le Lévitique, ont décidé de consommer, par jeu ou provocation, des criquets. Maigre pitance !
*L’élevage des coccinelles semble réussir mais c’est pour qu’elles nous débarrassent des pucerons ! L’époque de l’épicerie 3
Le coup de soleil. Oran 1943.après la remobilisation.
 |
 |
Contrairement à Alger, largement ouverte sur la mer, Oran est une ville qui lui « tourne le dos » selon l’expression de Camus.
Les plages n’étaient pas faciles d’accès. Mon père reculait. La pente rocheuse lui donnait le vertige. Ma mère ne se mettait pas en maillot et n’a jamais pris un seul bain de mer de sa vie.
Aussi mon oncle Georges profita d’une permission à Oran, avant le départ avec le C.E.F (corps expéditionnaire français) pour l’Italie et le débarquement en Provence, et nous emmena, Josiane et moi, à la plage, avec son ami, Robert Munnich, qu’il avait connu chez les scouts à Constantine. Sans parasol, nous avons grillé toute la journée au soleil d’Afrique.
Un coup de soleil dont je me souviens encore nous empêcha de dormir sur le dos pendant plusieurs jours. En outre, Josiane et moi, avions cédé notre chambre et nos lits jumeaux à Georges et à son ami et nous avions dormi à la dure, par terre, dans la chambre de notre mère. Double peine !
A sa décharge, mon oncle Georges, futur brillant médecin dermatologue, ne se souciait pas encore des peaux fragiles ni des U.V. ni des mélanomes !
J’ai vu sur la plage, en 2010, pour la première fois, plusieurs petits, pas spécialement photosensibles, je me suis renseignée, bouche clouée avec des sucettes- ils se rattraperont plus tard pour parler avec leurs portables- avec des couches culottes qui boursouflaient leur derrière, entièrement couverts de combinaisons anti UV « flashy » avec lunettes noires de plongeurs …Incrédule, J’ai d’abord imaginé qu’on les entraînait à la pêche sous-marine ! Et j’ai vu aussi d’autres petits rouges comme des crevettes cuites, sans aucune protection ! Le bon sens n’est-il donc plus la chose la mieux partagée ? Oui ! Mais « le principal étant de l’appliquer bien »selon Descartes, la difficulté vient de là !
Janvier 2011 : je viens d’apprendre dans le Figaro la mort de Robert Munnich à 95 ans. Plus âgé que mon oncle Il avait donc environ 26-27 ans à l’époque, à Oran. Je dois un hommage à cet homme remarquable qui partagea aussi avec mon oncle la passion du scoutisme.
Polytechnicien, Ingénieur Général de l’armée de l’air, il était Président de différentes associations de l’Armée de l’Air.
Homme inspiré : « Dieu est présent dans tout ce qui vit, disait-il, il est présent dans mon prochain quand je le regarde et en moi quand il me regarde », il a mené un important combat au sein de l’Amitié Judéo-Chrétienne, de la Fraternité d’Abraham et des artisans de la paix.

Robert Munnich « écureuil industrieux » chez les scouts.
Le 2ème en partant de la droite.
L’époque de l’épicerie 4
La petite malade
Mes parents avaient loué à Oran un appartement au 21 rue d’Arzew et quitté la chambre d’hôtel. Quand nous habitions encore à l’hôtel, je retrouvais souvent chez elle une petite fille maladive, chétive, au cheveu rare et aux doigts diaphanes, dans le décor cossu de ce que l’on peut considérer comme un hôtel particulier, une noble demeure, avec un immense hall couvert d’une verrière et à l’étage, une galerie sur laquelle s’ouvraient de multiples pièces.
Cette enfant avait des jouets étonnants et du linge de poupée avec des draps magnifiquement brodés, comme ceux du trousseau de ma mère.
J’étais éblouie. Elle avait aussi une nurse européenne. Comment a débuté cette relation ?
Peut-être la nurse ou la mère, une femme mûre et plutôt massive,- je n’ai jamais vu d’homme dans cette demeure- m’avait-elle vue, sur le trottoir, rôder devant l’épicerie de mes parents, 4 rue du Citoyen Bézy, admirant avec envie les évolutions d’enfants sur des patins à roulettes en bois, des trottinettes ou des bicyclettes.
Cette relation a été éphémère. Pendant cette période troublée où je n’ai jamais eu le temps de me fixer et d’entretenir des amitiés durables, mes amis ont défilé au même rythme que le décor de ma vie.
La petite malade s’appelait Colette, je crois. On a dû penser que je pouvais la distraire.
L’époque de l’épicerie 5
L’oisiveté mère de... Le papier crépon
 Au 21 rue d’Arzew, je me suis liée d’amitié avec une petite voisine, Odile C. Le désœuvrement de l’été nous avait amenées toutes les deux à traîner dans l’appartement déserté par mes parents dès l’aurore. Au 21 rue d’Arzew, je me suis liée d’amitié avec une petite voisine, Odile C. Le désœuvrement de l’été nous avait amenées toutes les deux à traîner dans l’appartement déserté par mes parents dès l’aurore.
Nous y faisions n’importe quoi. La mère, veuve, sur la cour intérieure, en face, derrière sa fenêtre, penchée toute la journée sur son difficile ouvrage de « stoppeuse- remailleuse », était chargée de nous surveiller.
Sur le balcon de notre appartement, 21 rue d’Arzew, s’ouvraient trois fenêtres. Deux correspondaient à la chambre de mes parents et à la salle à manger. La troisième à une pièce dont deux vieilles demoiselles avaient fait leur atelier pour fabriquer des fleurs en papier. On y avait accès par le palier extérieur mais aussi par le balcon.
Un jour où elles s’étaient absentées pour aller déjeuner, confiantes, sans fermer leur fenêtre, nous avons pénétré dans l’atelier, regardé, admiré, tâté et enfin emporté des petits morceaux déjà découpés, donc prêts pour l’emploi, de ce magnifique papier crépon de toutes les couleurs. Une rareté pendant la guerre !
Les demoiselles reviennent, constatent et viennent en hurlant nous menacer de je ne sais plus quoi, au retour de nos parents.
Effrayées, nous nions le larcin, puis avons passé l’après-midi à faire  disparaître le précieux papier, en petits morceaux dans la cuvette des W.C. disparaître le précieux papier, en petits morceaux dans la cuvette des W.C.
Ma mère rentre enfin, les deux ouvrières se précipitent, ma mère les invite à fouiller tout l’appartement, convaincue par nos affirmations et l’air angélique de nos presque 7 ans que nous étions étrangères à cette disparition.
Je n’ai jamais osé avouer la vérité à ma mère, même des années après. Ensuite, cet épisode de ma petite enfance est sorti de ma mémoire.
Et si, au lieu de cette fureur, les demoiselles nous avaient expliqué que ce papier transformé en magnifiques roses était leur gagne-pain, il n’aurait pas fini dans les égouts, certainement. Aussi aujourd’hui, j’ai un peu honte et adresse mes excuses à ces deux malheureuses ouvrières qui ont sûrement rejoint le paradis des humbles.
L’époque de l’épicerie 6
Claude et Jacqueline Bano
Je me souviens aussi de Jacqueline Bano, un peu plus âgée que moi et dont le frère Claude, un adolescent passionné de photographie, développait chez lui, dans une chambre noire, avec une lumière rouge des clichés aux images brouillardeuses, pris avec un appareil à soufflet. Quand il consentait à nous laisser pénétrer dans son antre, nous étions fascinées par ses manipulations dont nous suivions les étapes, les plaques de verre, les sels d’argent pour les révélateurs, les bains dans des bacs qui fixaient puis rinçaient les images et la corde sur laquelle séchaient les photos avec des pinces à linge. Nous étions plus impressionnées par cette magie avec révélateur et fixateur que par les tours du magicien du cirque Amar.
Nous nous déguisions avec n’importe quoi. Nous étions les modèles. J’ai conservé quelques photos. On devine les contours d’une enfant qui pourrait être moi. Une princesse, un voyou en béret, une victime d’un gangster armé, en lunettes noires. Les accessoires et le décor étaient limités, peut-être l’imagination aussi. C’était en 1941. Jacqueline était un peu rondelette, mais gracieuse et très souriante. Je devais prendre mes rôles très au sérieux parce que je ne souris jamais comme les mannequins des magazines.

L’époque de l’épicerie 7
Verdu.
Je me souviens aussi de Marinette ou Conchita- je ne sais plus- une jeune adolescente espagnole d’un milieu très modeste. Toute la famille vivait dans une seule grande pièce sombre, enfumée de rez- de- chaussée. Peut-être des concierges. Tous les jours, en toute saison, dans une grande cheminée noire de suie, cuisait à petit feu, suspendue à une crémaillère, une grosse marmite de lentilles au lard : « lentejas ».
C’était l’été. J’avais 8 ans environ et Conchita était chargée de me surveiller et de me promener. Elle lavait sa robe du dimanche en calicot à fleurs dans un évier, la remettait aussitôt sur elle, toute mouillée pour la faire sécher dehors, et nous sortions. Nous déambulions toutes les deux rue d’Arzew et rue de la Bastille, rue marchande très animée et bruyante.
Oran est une ville espagnole. Des fenêtres, des échos de musique andalouse parvenaient jusqu’à nous. Les cours de danse espagnole déversaient parfois dans la rue des jeunes femmes, à la magnifique chevelure en chignon noire et brillante, dans leurs somptueux, rutilants costumes de danse, castagnettes à la main.
 On vendait partout, sur de longs plateaux de fonte noire de la moelleuse « calentica » à base de farine de pois chiches. Nous la consommions sur place, encore toute chaude, nature, sur des morceaux de papier. Sans pain, c’était la guerre, le pain n’était délivré que contre des tickets de rationnement. Pas de cumin, non plus. Nous regardions les vendeurs de «godipala», (déformation oranaise de higos de pala ?) les figues de Barbarie, extraire la pulpe orangée de sa gangue épineuse. Nous rôdions devant les marchands de « tayos », les beignets. Nous nous aventurions aussi jusqu’à la Place d’Armes. Dans l’Allée des promeneurs, le marchand d’oublies et sa boîte cylindrique. Les marchands de glace ambulants transportaient sur leur dos une glacière ronde cylindrique en aluminium maintenue par des bretelles. Tous ces petits métiers de marchands ambulants à la criée aujourd’hui disparus. On vendait partout, sur de longs plateaux de fonte noire de la moelleuse « calentica » à base de farine de pois chiches. Nous la consommions sur place, encore toute chaude, nature, sur des morceaux de papier. Sans pain, c’était la guerre, le pain n’était délivré que contre des tickets de rationnement. Pas de cumin, non plus. Nous regardions les vendeurs de «godipala», (déformation oranaise de higos de pala ?) les figues de Barbarie, extraire la pulpe orangée de sa gangue épineuse. Nous rôdions devant les marchands de « tayos », les beignets. Nous nous aventurions aussi jusqu’à la Place d’Armes. Dans l’Allée des promeneurs, le marchand d’oublies et sa boîte cylindrique. Les marchands de glace ambulants transportaient sur leur dos une glacière ronde cylindrique en aluminium maintenue par des bretelles. Tous ces petits métiers de marchands ambulants à la criée aujourd’hui disparus.
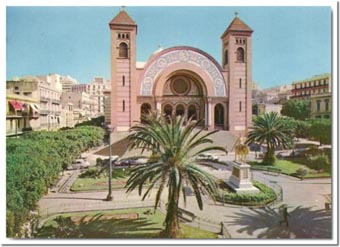 Il m’est arrivé, une ou deux fois, le Dimanche matin de suivre Conchita à la grande cathédrale d’Oran devant laquelle, sur le parvis, brûlaient des cierges. Ma sœur Josiane, imitant d’autres enfants, récupérait, en passant, de la cire fondante et la mâchait comme du chewing–gum. Il m’est arrivé, une ou deux fois, le Dimanche matin de suivre Conchita à la grande cathédrale d’Oran devant laquelle, sur le parvis, brûlaient des cierges. Ma sœur Josiane, imitant d’autres enfants, récupérait, en passant, de la cire fondante et la mâchait comme du chewing–gum.
Conchita s’agenouillait et se signait. Je m’agenouillais et me signais. Conchita marmonnait, tête baissée, yeux mi-clos, mains jointes, de pieuses prières en latin. Je regardais les statues, les vitraux, le fermail des missels…
Je la suivais ensuite dans une grande pâtisserie, envahie à la sortie de la messe, où tranquillement elle mangeait deux ou même trois gâteaux si elle avait pu les avaler, en n’en payant qu’un seul. Je m’arrêtais à 1 non par honnêteté mais par satiété. Je me demande aujourd’hui si les vendeuses ne fermaient pas un peu les yeux. Puis nous errions dans la rue marchande où elle espérait apercevoir Verdu –c’était son prénom- un superbe adolescent espagnol, brun aux yeux verts, raffiné, tout de blanc vêtu qui déambulait avec sa petite amie. Il ne nous a jamais adressé ni une parole ni un regard. Je crois même qu’il ignorait que nous existions. Elle en était amoureuse, et moi aussi comme elle.
Oran : La Synagogue style byzantin et la Cathédrale style romano-byzantin.
Deux tourelles, deux clochers et maintenant une mosquée à deux minarets (il y en a 7 à la Mecque)
et une bibliothèque à deux clochers carrés.
L’époque de l’épicerie 8
Les sœurs Touati. Mes débuts au piano.
A Oran, après mon exclusion de l’école, en Octobre 1941, ma mère a tenu à parfaire mon initiation à la musique.
Nous avions, à la maison, un piano Pleyel, cadeau de mon père à ma mère pour ses 20 ans. Elle en avait aussi reçu un à Constantine, cadeau de grand- père pour ses 15 ans.
Ma mère m’a confiée à une jeune fille amie, Melle Touati, je crois, voisine de la boutique. Ma mère jouait elle-même du piano, honnêtement, comme toutes les jeunes filles bien élevées de son époque qui pianotaient au moins la Marche Turque de Mozart.
J’ai appris sans difficulté et même avec plaisir les notes, les gammes et quelques morceaux simples que nous jouions à 4 mains.
Je revois cette jeune fille, condamnée au désœuvrement par les lois de Vichy, dessinant avec application sur mon « cahier de musique » une portée, une clé de sol,- c’est si joli une clé de sol qui fait danser la main, j’en aurais rempli des pages !- puis de fa, puis des notes rondes, blanches, noires, sans ou avec croches simples, doubles, triples. Elle transpirait beaucoup et je regardais curieuse et perplexe des cercles de transpiration s’inscrire sur son chemisier de soie, (les synthétiques n’existaient pas) en s’élargissant sous les aisselles.
 Cette maison pleine de jeunes filles gaies me plaisait. J’étais accueillie avec chaleur. Elles adoraient Danielle Darrieux, cette future si grande comédienne à la carrière d’une longévité exceptionnelle. Née en 1917, elle était, en 1941, déjà célèbre. A 93 ans, toujours très active, elle est à l’affiche de 3 films, cette année 2010. Et elle vient de recevoir le Globe d’honneur, lors de la cérémonie des Globes de cristal 2010, récompense décernée par un Collège de 5000 journalistes pour les Arts et la Culture. Cette maison pleine de jeunes filles gaies me plaisait. J’étais accueillie avec chaleur. Elles adoraient Danielle Darrieux, cette future si grande comédienne à la carrière d’une longévité exceptionnelle. Née en 1917, elle était, en 1941, déjà célèbre. A 93 ans, toujours très active, elle est à l’affiche de 3 films, cette année 2010. Et elle vient de recevoir le Globe d’honneur, lors de la cérémonie des Globes de cristal 2010, récompense décernée par un Collège de 5000 journalistes pour les Arts et la Culture.
 En 1941, elle était si fraîche, si charmante, elle avait un si joli brin de voix. Sur le mur de la chambre de ces jeunes filles, un irrésistible portrait de leur idole. En 1941, elle était si fraîche, si charmante, elle avait un si joli brin de voix. Sur le mur de la chambre de ces jeunes filles, un irrésistible portrait de leur idole.
Sur un phonographe « La voix de son Maître »elles écoutaient un disque 78 tours de Danielle Darrieux qui chantait au ravissement de toute la France, fleur bleue « ah ! Qu’il doit être doux et troublant l’instant du premier rendez-vous ! » Et aussi, un brin canaille : « c’est un mauvais garçon, qui a des façons pas très catholiques, on a peur de lui. » Avec Henri Garat, je crois.
Plus sérieusement, certaines parmi les sœurs qui m’avaient adoptée, avaient décidé de me faire travailler puisque l’Ecole publique de Vichy ne voulait plus de moi.
Mon départ pour Constantine où je retrouvais, chez mes grands-parents maternels, avec joie, ma petite sœur, mit un terme à cette généreuse entreprise.
IV - Constantine
Chez mes grands-parents Melki
• • •
1 - Constantine « Kar Chara », le quartier juif, années 40-50.
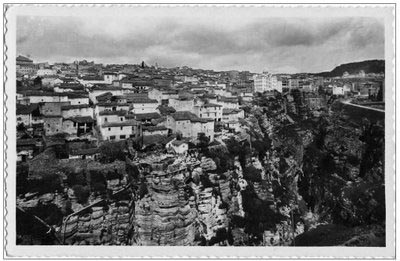 A Constantine, la « Jérusalem de l’Est », l’autre étant Tlemcen, les Juifs, évacués de la place Sidi El-kitani, par souci d’urbanisme, avaient été rassemblés et parqués, au XVIIIème siècle, dans un espace qui venait buter contre le ravin sur la rive gauche du Rhumel par ordre du bey Salah (1771-1792) : le quartier au bord du gouffre dit « Kar Chara » le bas ou le cul de la ville. A Constantine, la « Jérusalem de l’Est », l’autre étant Tlemcen, les Juifs, évacués de la place Sidi El-kitani, par souci d’urbanisme, avaient été rassemblés et parqués, au XVIIIème siècle, dans un espace qui venait buter contre le ravin sur la rive gauche du Rhumel par ordre du bey Salah (1771-1792) : le quartier au bord du gouffre dit « Kar Chara » le bas ou le cul de la ville.
Dans les années 1940-1950, les Juifs vivaient encore en très grand nombre à « Kar Chara ». Tous ont quitté la ville pour un exode définitif.
Dans la boucle du Rhumel entre le Pont de Sidi Rached et le Pont de Sidi M’Cid, vivaient trois communautés distinctes, les Juifs, les Arabes, et les Européens. Mais les frontières n’étaient ni nettes, ni étanches au XXème siècle.
Du quartier Juif on entendait les Cloches de la Cathédrale, les appels à la prière des muezzins sur leurs minarets blancs, le canon du Ramadan et même les cigognes qui claquettaient sur les toits aux tuiles rouges des maisons du quartier arabe.
Dès les années 1920, la population européenne et une large frange de la population juive quittaient la vieille ville sur son piton rocheux enserré, sur trois côtés, dans une boucle du Rhumel pour essaimer vers les faubourgs qui se développèrent : au sud-ouest, la butte du Koudiat-aty arasée, le quartier St Jean, plus à l’ouest Bellevue, au nord El Kantara, au nord-est, le faubourg Lamy et deux quartiers de Sidi Mabrouk vers le plateau du Mansourah.
 La vieille ville juive formait un enchevêtrement de petites rues étroites avec des maisons à encorbellements qui rétrécissaient et assombrissaient encore l’espace, et de places : « Place des Galettes » « Place Négrier ».. La vieille ville juive formait un enchevêtrement de petites rues étroites avec des maisons à encorbellements qui rétrécissaient et assombrissaient encore l’espace, et de places : « Place des Galettes » « Place Négrier »..
Les rues Vieux et Grand, aux noms d’une graphie ancienne au charme désuet, étaient au centre du quartier juif d’origine. La rue Vieux semble en avoir été l’artère principale avant d’avoir été en partie débaptisée. Elle apparaît sur les plans de 1888, 1895 etc. et pas encore la rue Grand.
Le quartier fut agrandi, au début du XXème siècle. Des maisons d’habitation de type occidental, avec plusieurs étages et fenêtres ouvertes sur des balcons aux garde-fous en fer forgé, furent construites rue
Thiers, sur les contreforts du Rhumel, et rue de France. Nous
habitions dans la partie très pentue de la rue Thiers qui surplombait le Rhumel et les gorges, sous des arcades, au 4e étage du 44 rue Thiers qui communiqua avec le 2ème étage du 36 rue Thiers, une fois des cloisons abattues, après la guerre.
La rue de France menait à la ville européenne par la rue Caraman et la Place de la Brèche.
En 1941, après l’abrogation du décret Crémieux, les Juifs n’appartenant plus à la « Nation Française », les zélés antisémites et anglophobes sectateurs de la « Révolution Nationale » de Vichy poussèrent leur mesquinerie haineuse jusqu’à débaptiser la rue de France qui devint pour un temps « rue d’Angleterre », ce pays étant, bien entendu, l’ennemi de Mers-el-Kebir et le refuge de « l’Anti- France » après l’appel du 18 juin 1940. Mais, peut-être, le sens du ridicule retrouvé – outre qu’il existait déjà un boulevard d’Angleterre et que tout cela était bien confus- le consensus se fit sur « rue du Lycée » moins « connoté » comme on aime  dire aujourd’hui. Pour les habitants, la rue resta « de France », du pays France dont on voulait les exclure, mais le vent de l’Histoire faisant tourner la grande roue du temps plus vite qu’une girouette, la rue s’appelle maintenant « rue du 19 juin 1965 » (coup d’Etat de Boumediene) après avoir été appelée, un temps aussi, rue du Sergent Atlan, soldat juif « mort pour la France ». Mais le vent de l’Histoire... ! dire aujourd’hui. Pour les habitants, la rue resta « de France », du pays France dont on voulait les exclure, mais le vent de l’Histoire faisant tourner la grande roue du temps plus vite qu’une girouette, la rue s’appelle maintenant « rue du 19 juin 1965 » (coup d’Etat de Boumediene) après avoir été appelée, un temps aussi, rue du Sergent Atlan, soldat juif « mort pour la France ». Mais le vent de l’Histoire... !
Depuis des siècles, selon le caprice du Prince et la veulerie des hommes, les juifs vivaient dans une paix toujours bien relative ou étaient méprisés, spoliés, humiliés, pourchassés et persécutés comme lors du Pogrom du 5 aout 1934 qui outre les saccages et pillages, fit 25 victimes juives dont 6 femmes et 5 enfants, ou lors des campagnes antisémites haineuses des Max Régis, Morinaud (maire de Constantine à partir de 1901, pendant l’affaire Dreyfus) et consorts qui défilaient dans le quartier juif durant les élections en hurlant : « mort aux juifs ! » ou « voter Bourceret , c’est voter juif ! » candidat représenté sur les affiches avec une chéchia rouge sur la tête.
Ma tante Yolande, née le 1er mai 1919 se souvient, enfant, avoir été terrorisée par leurs cris, s’être recroquevillée dans un coin du balcon au 3e étage, 2 rue Thiers, agrippée au garde-fou, le regard fixé sur la porte du Lycée, apeurée, sûre de « voir arriver la mort » (sic) par là.
 Ma mère est née le 8 Mars 1913 au 79 rue Vieux, en plein quartier juif. La rue Vieux qui traversait à cette époque-là tout le quartier, était une rue étroite et sombre, mais moins que d’autres ruelles en réseaux, un vrai coupe gorge, la nuit, sans éclairage dans les années 1900-1910… Grand-père racontait comment, un soir, alors qu’il revenait d’une réunion d’études talmudiques, pris de panique, dans une obscurité d’encre, il a tiré en l’air. Il sortait donc armé d’un révolver. Son père, Haï Melki, était sergent de police, récompensé d’une médaille de bronze pour son dévouement lors d’une épidémie de typhus en 1893. « Actes de courage et de dévouement » dit le Livre d’or du dévouement. (J’en détiens une photocopie). Ma mère est née le 8 Mars 1913 au 79 rue Vieux, en plein quartier juif. La rue Vieux qui traversait à cette époque-là tout le quartier, était une rue étroite et sombre, mais moins que d’autres ruelles en réseaux, un vrai coupe gorge, la nuit, sans éclairage dans les années 1900-1910… Grand-père racontait comment, un soir, alors qu’il revenait d’une réunion d’études talmudiques, pris de panique, dans une obscurité d’encre, il a tiré en l’air. Il sortait donc armé d’un révolver. Son père, Haï Melki, était sergent de police, récompensé d’une médaille de bronze pour son dévouement lors d’une épidémie de typhus en 1893. « Actes de courage et de dévouement » dit le Livre d’or du dévouement. (J’en détiens une photocopie).
La vie, outre l’extrême pauvreté, la promiscuité, l’insalubrité et la situation sanitaire, ne devait pas être sereine dans ces misérables venelles, au début du siècle. Le jeune couple partageait la vie des parents de mon grand-père, selon l’usage de l’époque, et mon grand-père empruntait, peut-être, un pistolet à son père lors de ses sorties nocturnes.
Au 79 rue Vieux naquirent aussi mes oncles Maurice le 14.2.1915, et Eugène le 2.6.1918 l’année de la mort du grand père Haï.
Puis la famille s’installa, avec la grand’mère, née Radia Toubiana, au 2 rue Thiers, au 3e étage, dans un appartement où sont nés Yolande le 1.5.1919, puis Georges le 10.5.1921, Mireille 28.9.1922 et Juliette 23.12.1923 qui décèdera le 31 mai 1928 après quelques jours de fièvre inexpliquée. A la naissance de Paul, le 11.10.1928 cet appartement fut cédé, avec tous ses meubles, à la jeune sœur de grand père Bellara, épouse de Simon Zemmour, quand la famille acheta une petite villa « Les Glycines » au 2 avenue Guynemer, au faubourg d’El Kantara où habitait déjà un frère de ma grand-mère : Abraham Sultan.
Deux grands pas dans la promotion sociale : de la maison mauresque des vieux quartiers à un appartement aéré et salubre de style européen puis à la villa hors de Ka Chara. Hélas ! La crise de 1929 mit un terme provisoire à cette prospérité. La famille quitta Constantine pour Tlemcen, et ne revint qu’en 1935. 
Les juifs n’étaient plus depuis 1870 des Judéo-arabes « Youd al Arab », les juifs des arabes, jadis dhimmis, mais des citoyens français libres et ils en étaient fiers. Beaucoup renoncèrent aux prénoms arabes et adoptèrent des prénoms Second Empire. Ma grand’mère, Clara Valentine, née en 1890, avait le Certificat d’Etudes et abandonnait dès 1919 la tenue traditionnelle des juives de Constantine. Le désir d’assimilation des juifs était parfois poussé jusqu’à l’absurde. Ils ne disaient pas « Brit mila » ni même « Circoncision » mais « Baptême » ( !), la « Bar-mitsva »
littéralement « Fils de la loi » qui consacre la majorité religieuse à 13 ans devenait « Communion » !
« Kar Chara » était, quand je l’ai connu, dans les années 1940, compte tenu des écarts de fortune et de condition chez les Juifs, un quartier de petites gens, souvent très pauvres. Beaucoup vivaient dans le dénuement surtout après la Promulgation du Statut des juifs, sous Pétain. Des familles entières dans une ou deux pièces comme celle du malheureux Joseph, l’employé du magasin de tissus de mon grand-père.
On trouvait encore, dans les vieilles ruelles, des maisons mauresques presque aveugles, ouvertes sur des « patios ». La cour intérieure était parfois, chez les plus pauvres, un lieu de vie collective. Des hangars avec chevaux subsistaient au milieu des habitations. A côté de notre immeuble au 44 rue Thiers un grand hangar blanc avec une carriole pour transporter des marchandises, mais aussi en face du 21 rue Grand une écurie avec une calèche à 2 places. D’où la carte postale que j’ai retenue pour ce texte avec charrette et foin pour les chevaux. C’était encore parfois la réalité et pas une image d’archives.
Souvent des hommes traînaient leur misère et désœuvrement sur les trottoirs devant les cafés de la rue de France. Il y avait, rue de France, 28 débits de boisson sur 127 à Constantine !
Les petits trafics ne soulageaient pas la misère mais contribuaient à en envoyer certains sous les verrous comme, peut-être, l’aimable boiteux qu’on voyait reparaitre à son poste, appuyé au mur devant un café de la rue de France.
A la belle saison, sur le pas des maisons, de vieilles femmes en costume traditionnel, assises sur des chaises basses, sur des tabourets paillés, ou accroupies sur leurs talons, triaient des lentilles, des pois chiches, faisaient des « kawas », un tamis sur les genoux, bavardaient dans un arabe émaillé de mots français- ou l’inverse – ou écoutaient passer le temps en balançant nonchalamment leurs éventails multicolores en goum. Elles se relevaient péniblement en tapotant les plis de leurs longs jupons et gandouras pour les remettre en ordre, elles rajustaient leurs « koufias » et en traînant leurs babouches, de leur pesante démarche chaloupée, elles regagnaient leurs réchauds et kanouns.
L’été, elles ressortaient après dîner pour fuir la touffeur insupportable des appartements exigus, avec toute la jeunesse juive très européanisée et ne parlant que français qui rejoignait « Caraman » et « La Brèche ».
D’un même geste machinal, elles épongeaient sans cesse leur visage encombré de quelques mèches rougies au henné avec un mouchoir largement déployé qu’elles tiraient du creux de leurs seins lourds.
Beaucoup d’hommes étaient au chômage ou vivaient d’artisanat et de petit commerce. Dans les vieilles rues étroites, les locaux étaient parfois si petits et chargés de sacs, bocaux, boîtes etc… que le commerçant recevait le chaland devant sa boutique. Comme, rue Grand, l’énorme vendeur d’épices Shlomo surnommé « Bof » qui partageait sa vie avec sa vieille mère Radia et son chien. Assis à califourchon sur sa chaise paillée, sur le trottoir, il vous accueillait indifféremment d’un « bonjour » ou « El Kher » (matin de bonheur !) puis enveloppait sa marchandise dont il connaissait surtout les noms arabes dans des cornets en papier journal : melh : le sel, gasbour : la coriandre, kerwija : le carvi, kemmoun : cumin, djeldjlâne : sésame, hbag : basilic etc.
Le marchand arabe de petit lait « l’ben » et de beurre salé fondu « smen », avait installé sa baratte devant sa porte et il l’activait sous nos yeux. Les clients attendaient la fin de l’opération, leur pot à lait en aluminium ou leurs bouteilles à capsule de porcelaine à la main. Encore un peu plus loin, on pénétrait complètement dans le quartier arabe.
 Chez les bouchers, des mouches bleues obstinées bourdonnaient autour des yeux des têtes de moutons alignées sur les étals, des tréteaux en bois en plein air, et sur les quartiers d’agneaux suspendus à des esses sous l’auvent. Partout une odeur âcre de sang séché et de caniveaux mal drainés. Chez les bouchers, des mouches bleues obstinées bourdonnaient autour des yeux des têtes de moutons alignées sur les étals, des tréteaux en bois en plein air, et sur les quartiers d’agneaux suspendus à des esses sous l’auvent. Partout une odeur âcre de sang séché et de caniveaux mal drainés.
On n’osait pas trop s’aventurer, seules, par là-bas, avec ma tante Yolande, surtout après les massacres de 1934 à Constantine et de 1945 à Sétif. Je m’y suis rendue, quelques rares fois, avec elle, pour acheter du petit lait et, dans la foulée, à l’insu de grand père et en infraction avec les règles de la « Cacherout », d’excellentes petites côtelettes d’agneau. (Hallal !)
Les rues, bruyantes, grouillaient de vie, sauf aux heures de grande chaleur, l’été, ou l’hiver, quand le froid très vif boursouflait d’engelures nos doigts gourds et rougis.
La population du quartier était essentiellement juive mais les Arabes nombreux y tenaient boutique, marchands de beignets, de « zlabias », de « calentica », le préposé au four banal, le vendeur et loueur de livres d’occasion au sous-sol d’un immeuble, rue de France, presque tous les vendeurs de légumes aux marchés, les employés de magasins et aussi les mauresques en haïk noir, les jeunes filles kabyles, une serviette sur la tête tenue entre les dents, les petits cireurs, porteurs ou coursiers, les yaouleds effrontés.
Le commerce, comme la vie dans le quartier, suivait le calendrier des fêtes juives.
Les marchands arabes arrivaient avec des grenades, jujubes dorés et pommettes pour Roch Hachana, des poulets pour Kippour, des palmes, des roseaux, des cédrats, des branches de saule et de myrte pour le « loulav » et la cabane de Soukkot et, pour Pessah, des moutons sur pieds et des salades romaines dont les feuilles jonchaient les rues au petit matin. Considérée avec le cèleri, persil etc. comme une « herbe amère » symbole de la misère des juifs en Egypte avant l’exode, la romaine était distribuée par l’officiant aux convives avec un morceau d’Harosset - délicieuse pâte de fruits, parfumée à la fleur d’oranger, constituée de dattes ou figues et fruits secs, symbole pourtant du mortier des carrières de pierre et des briqueteries de la souffrance – et quelques feuilles de romaine étaient balancées par la fenêtre au moment de la lecture de la Haggadah, « Le Récit », geste symbolique de liberté.
Sous nos fenêtres, toute l’année, déambulaient marchands à la criée, rémouleurs et rétameurs, (on réparait alors les casseroles trouées !), marchands de friperie, avec leur paquet de vieilles hardes sur l’épaule, psalmodiant « …chan d’bi », un i suraigu prolongé en point d’orgue mourait en échos dans les gorges du Rhumel. Ils achetaient et revendaient. J’ai vu, une fois, grand’mère, dans ces années de guerre, de gêne et de pénurie, marchander avec l’un d’entre eux et vendre des costumes.
Des paysans arrivaient de leurs douars avec des œufs et des poulets attachés par les pattes, la tête en bas, le bec ouvert, l’œil rond et l’aile découragée. Les pauvres bêtes pendaient au bout d’une corde par deux ou trois sur chaque épaule du marchand. Grand’mère, de son œil très myope, mirait les œufs que l’homme, en soulevant les pans de son burnous de laine rêche, sortait un à un, comme un prestidigitateur. Parfois, la couvaison était entamée et nous avons même, un jour, trouvé dans un œuf sur le point d’éclore, un poussin.
Grand-mère soupesait, tâtait, palpait les volailles courroucées et ébouriffées pour vérifier qu’elles n’étaient ni malades, ni blessées, selon les préceptes du Lévitique. Puis commençait le marchandage, Joseph emportait ensuite les bêtes chez le « Shohet » rabbi Sion Choukroun, le rabbin sacrificateur pour l’abattage rituel. Le plumage, fait à la maison, à sec, libérait plumes et poux de poulet dans toute la cuisine.
A « Kar Chara » beaucoup d’enfants dépenaillés, la casquette ou le béret enfoncé jusqu’aux yeux, fréquentaient le Talmud Torah dans les locaux de « l’Alliance Israélite Universelle » au rez-de-chaussée du 36 et 44 rue Thiers où nous habitions. On entendait, sous les arcades, les petits chanter à tue-tête leurs « parachot ». Braillements plus que Cantillation ! Ils préféraient, plutôt qu’ânonner Aleph… Beth… etc. faire « Talmud Torah buissonnière », jouer aux billes, aux noyaux, aux osselets, à la toupie, au « sou follet » le « s’follet » sur les trottoirs, dévaler la rue Thiers pentue, sous les arcades, sur leurs planches à roulettes bricolées ou s’égayer sur les pentes du ravin, une fois franchis les parapets. Mais le rabbin veillait et leur infligeait la « Falaka » coups de baguette sur la plante des pieds, en cas d’absences répétées et peu justifiées.
Le Jeudi et le Dimanche, jours où les enfants n’allaient pas à l’Ecole Publique obligatoire – sauf quand un décret les en a chassés pendant 2 ans- des Scouts Juifs leur distribuaient un plat chaud unique de lentilles ou de haricots aux merguez cuisiné par des bénévoles et un morceau de pain et du chocolat quand ils rentraient chez eux l’après-midi.
 Pour « Pourim » des grappes d’enfants déguisés, les petites filles fardées comme Esther, la favorite du harem du roi perse Assuérus, allaient et venaient les bras chargés de pâtisseries aux couleurs de sucre et de miel que les familles échangeaient. Pour « Pourim » des grappes d’enfants déguisés, les petites filles fardées comme Esther, la favorite du harem du roi perse Assuérus, allaient et venaient les bras chargés de pâtisseries aux couleurs de sucre et de miel que les familles échangeaient.
Ils glanaient ainsi quelques petits sous avec lesquels ils jouaient aux dés, le jeu traditionnel de Pourim.
Le mot « Pourim » « sorts » fait allusion aux dés lancés par Aman, le ministre du roi perse Assuérus, pour déterminer le jour du massacre, qu’il avait programmé, du peuple juif dispersé dans les cent vingt-sept provinces de l’empire perse, lors de l’exil de Babylone.
Je ne peux m’empêcher de rappeler la phrase prêtée à Hitler : « Les juifs ne connaîtront pas un second Pourim ! ». C’est le sort ou Dieu qui en a décidé !
Pour Kippour, les enfants paradaient dans tout le quartier, dans leurs vêtements neufs, avec, à la main, un coing piqué de clous de girofle ou un petit pain rond avec un œuf ou une noix retenus dessus par un croisillon de pâte. Dans un manège incessant, ils faisaient le tour des synagogues, où, toute la longue journée de 25 heures de jeûne, priaient leurs pères, en bas, pendant qu’à l’étage les femmes papotaient un peu en attendant le chofar et la bénédiction finale.
 C’était alors une joyeuse bousculade. Tous, jeunes et vieux, hommes et femmes, se retrouvaient sous le taleth, le châle de prière, du chef de famille déployé comme une aile protectrice au-dessus des têtes. Puis un silence recueilli, solennel, rompu par le son de cor répété du « Chofar », la corne de bélier, comme, venu du fond des âges, un appel codé à Dieu. Et, à nouveau, brouhaha des prières avant les embrassades générales et la dispersion des fidèles. Une fois « les portes de la grâce ouvertes », lavés de tous leurs péchés, l’âme en paix, ils étaient prêts à enfin boire et manger. C’était alors une joyeuse bousculade. Tous, jeunes et vieux, hommes et femmes, se retrouvaient sous le taleth, le châle de prière, du chef de famille déployé comme une aile protectrice au-dessus des têtes. Puis un silence recueilli, solennel, rompu par le son de cor répété du « Chofar », la corne de bélier, comme, venu du fond des âges, un appel codé à Dieu. Et, à nouveau, brouhaha des prières avant les embrassades générales et la dispersion des fidèles. Une fois « les portes de la grâce ouvertes », lavés de tous leurs péchés, l’âme en paix, ils étaient prêts à enfin boire et manger.
Toute la vie du quartier s’organisait au rythme des fêtes juives et autour de trois pôles : le four banal, le bain maure, et la synagogue. En outre, les jeunes juifs rejoignaient toute la jeunesse mêlée, juifs et non juifs, pour « faire Caraman » et l’été, manger des « créponnés » sur la Place de la Brèche, ou s’installer à la terrasse des cafés ou du Casino, surtout après la guerre.
Le rejet, l’exclusion, depuis tant de siècles, avaient généré un puissant sentiment communautaire fait de solidarité, d’hospitalité, de charité, renforcé par les mariages endogames : on était tous plus ou moins « cousins » et même dans la gêne on se devait de pratiquer les « mitsvot ».
J’ai raconté comment grand père avait, sans hésiter, renoncé à l’argent du vélo de course de Georges qu’il venait de vendre, pour aider au mariage de deux jeunes filles nécessiteuses.
Une vieille femme aveugle, Ma Hnina, très dévote, seule dans une pièce très sombre de rez-de–chaussée d’une maison mauresque était aidée par des bonnes âmes de l’immeuble voisin, 21 rue Grand. Henriette, la femme de Paul, se souvient avoir nettoyé, à son tour, sur injonction de sa mère, la chambre de la malheureuse, pavée de grosses pierres irrégulières, éclairée à la seule bougie, et encombrée de veilleuses à huile pour le culte de ses morts.
Tous les vendredis, un pauvre homme venait chercher, avec un grand sac de jute sur le dos, du pain de maison préparé par grand-mère et cuit au four banal, du « pain juif » disions-nous, et quelques pièces de monnaie.
Il faisait ainsi sa tournée du quartier.
Enfants, nous nous précipitions pour accomplir cette « mitsva » (acte charitable) : l’un donnait les pièces, l’autre le pain, à tour de rôle.
Pour les fêtes, l’homme recevait, en outre, de la farine, du sucre et de l’huile, pour lui, pour les pauvres, et pour les porte- veilleuses en argent de la synagogue.
Pour Kippour, un poulet, pour la Pâque un paquet de galettes sucrées, des pains azymes et une bouteille de vin.
Et partout dans les commerces, de petits troncs pour nous inciter à l’aumône et aux dons.

Aujourd’hui plus aucune trace de vie juive dans cette ville que mes coreligionnaires ont commencé à quitter dès le milieu des années 1950 pour la France ou Israël – c’est le cas de ma famille Melki, Sultan, Sarbib, Assoun – après des millénaires de présence au Maghreb. Les bombes du 20 Août 1955, rue Caraman, au cinéma A.B.C. et la mort du neveu de Ferhat Abbas dans sa pharmacie, les grenades du 2 Mai 1957 ont convaincu beaucoup de juifs qui n’avaient pas oublié les pogroms de 1934 et les massacres de 1945, de la nécessité d’un départ. L’assassinat de « Cheikh Raymond », le musicien aimé et respecté de tous, le 22 juin 1961, déclencha l’exode. Après les Accords d’Evian du 19 Mars 1962, la communauté juive décida, le 27 Mai 1962, de quitter la ville. En 1967, après « la Guerre des Six Jours », ceux qui restaient encore sont partis.
La génération des vieilles juives, qui avaient dû renoncer à leurs vêtements traditionnels en traversant la Méditerranée s’est éteinte.
Le cimetière Juif à Constantine est surveillé pour éviter les profanations mais désert, les synagogues sont fermées ou ont changé d’affectation, et la synagogue de mon enfance « le Temple Algérois », Place Négrier, où chantait mon grand-père qui avait une si belle voix, a disparu. Elle a été démolie, rasée pour laisser place à un parking. C’était pourtant la plus moderne, avec son «chemache » à bicorne, les jours de grande cérémonie, ses vitres colorées et, extrait des textes des prophètes (Isaïe 56,7), son message œcuménique d’espérance, de paix et de tolérance inscrit sur son fronton : «Car ma maison sera l’oratoire de tous les peuples ».
L'appartement du 44 rue Thiers
• • •
Retour de la famille à Constantine : Au 44 rue Thiers * : 1935-1957

Aujourd’hui, sur un plan récent de Constantine, je suis comme un voyageur égaré, sans boussole et sans soleil pour l’aider. Toutes les rues ont changé de nom et je ne retrouve souvent même pas leur tracé.
Mais ce 44 rue Thiers, en dépit de la guerre et de la misère autour de nous dont, enfants, nous étions inconscients, est de tous les lieux de passage de mon enfance et de mon adolescence, celui dont j’ai gardé le plus vif souvenir. ..
Les êtres dont j’ai partagé la vie et qui ne sont plus. Les bruits, les odeurs, l’atmosphère patriarcale, le judaïsme messianique mais ouvert et tolérant, le rêve sioniste aussi.
Et les paysages superbes d’une beauté écrasante (« al Dhama » : l’écrasante en Arabe) du rocher de Constantine fendu par les gorges du Rhumel…Et la « forêt des pins » ! Et à 12 km à l’est de Constantine les trois petits lacs de Djebel- Ouach où nous emmenait en auto, toute une marmaille, Zidane le chauffeur du magasin de grand-père! Et la rivière où avec mes oncles Georges, Eugène ou Maurice qui, patiemment, se chargeaient d’accrocher des vers à nos hameçons et de débrouiller nos lignes, nous allions pêcher des poissons pleins d’arêtes !
Les gorges du Rhumel traversent toute la ville et Constantine,-l’antique Cirta-perchée sur un rocher abrupt, à demi penchée n’est accessible de trois côtés que par quatre ponts lancés au-dessus de l’Oued Rhumel dont les gorges à pic sont infranchissables.
 Des fenêtres du 4e étage où nous habitions, au 44 rue Thiers, nous avions vraiment une vue unique. Certaines photos, prises par mon père en 1936, du « Pont Suspendu »construit juste avant la 1ère guerre mondiale et inauguré le 19 avril 1912, le sont de la fenêtre de la salle à manger, comme la photo que j’ai prise moi-même le dimanche 4 septembre 1949, lors d’une intervention de pompiers pour un feu de broussailles sur les pentes du Rhumel. (Voir photo). Des fenêtres du 4e étage où nous habitions, au 44 rue Thiers, nous avions vraiment une vue unique. Certaines photos, prises par mon père en 1936, du « Pont Suspendu »construit juste avant la 1ère guerre mondiale et inauguré le 19 avril 1912, le sont de la fenêtre de la salle à manger, comme la photo que j’ai prise moi-même le dimanche 4 septembre 1949, lors d’une intervention de pompiers pour un feu de broussailles sur les pentes du Rhumel. (Voir photo).
On surplombait les gorges dont les pentes, à la fin du Printemps, se couvraient de coquelicots éphémères. Ils ont ensuite disparu. Comme ont aussi disparu ces petites fleurs rouges à courtes tiges, les adonis, dont on ornait la table, dans une coupe d’eau à Pâque, et qu’on appelait « gouttes de sang ». Malgré les fleurs, les gorges étaient sombres, dangereuses, mystérieuses, inquiétantes. La toponymie rend compte d’impressions mêlées d’admiration, de vertige, de malaise aussi : « Pont Suspendu », « Pont du Diable », « Boulevard de l’abîme », et en Arabe : « al- Dhama » :l’écrasante, « Bled El Haoua » : la cité du vide.
On entendait crailler les corneilles qui nichaient dans les trous des rochers à pic, les stridulations des criquets entrecoupés de brusques silences l’été et le frôlement des chauves-souris occupées à leur chasse nocturne. Souvent aussi, le grondement du Rhumel, quand, à l’automne, les eaux coulaient en torrent. Les orages, avec les phénomènes d’écho dans les gorges, étaient d’une somptuosité apocalyptique.
Et le silence de la neige féérique !
Lors des violents tremblements de terre en 1946-1948 qui avaient chassé de Constantine une partie de la famille réfugiée à Philippeville, puis Alger, les sourds grondements des entrailles de la terre couvraient le cliquetis cristallin des verres qui, pendant d’interminables secondes, dansaient dans le haut vitré de la desserte de la salle à manger. Mais nous, enfants, inconscients du danger, excités par ce phénomène insolite, nous n’avions pas peur, malgré la ruée des habitants affolés vers les squares.
Lors de la violente secousse qui nous a réveillés en Juillet 1996 au château de Faverges, en Savoie, j’ai tout de suite reconnu ce bruit singulier, 50 ans après, et je me suis rendormie aussitôt rassurée : « c’est un tremblement de terre ! » me suis-je dit… Je m’étais familiarisée, enfant, avec ces phénomènes à Constantine et j’oubliais la menace de la tour moyenâgeuse du Château de Faverges, les humeurs imprévisibles de la nature et la vulnérabilité humaine.  Nous avions cependant apprivoisé ce paysage sauvage impressionnant et ce décor familier perdait pour nous parfois de sa poésie et de son pouvoir de fascination quand on voyait des paysans arabes en burnous enjamber le parapet et s’accroupir sur le terre-plein en dessous (visible sur la carte postale ci-dessus). Les musulmans jamais debout, dit-on, par égard pour Allah ! Nous avions cependant apprivoisé ce paysage sauvage impressionnant et ce décor familier perdait pour nous parfois de sa poésie et de son pouvoir de fascination quand on voyait des paysans arabes en burnous enjamber le parapet et s’accroupir sur le terre-plein en dessous (visible sur la carte postale ci-dessus). Les musulmans jamais debout, dit-on, par égard pour Allah !
Sans parler de ceux- c’est arrivé plusieurs fois – qui se couchaient sur le parapet, s’endormaient et dont il fallait aller récupérer les corps disloqués sur les pentes des gorges. Ces accidents font partie de mes cauchemars d’enfant.
J’éprouve maintenant un malaise vertigineux en haut des gorges et claustrophobe au fond des gorges. Ce n’était pas le cas à Constantine, même sur le Pont Suspendu qui résonnait sous nos pas, oscillait au passage des véhicules à 175 mètres d’altitude et que nous empruntions pour aller au cimetière ou à l’hôpital. Nous faisions de longues promenades sur le pont de Sidi Rached, viaduc de 27 arches, long de 447m, qui reliait le centre-ville au quartier de la gare. Nous traversions le pont d’El Kantara, pour aller à la gare ou rendre visite à la famille d’un frère de ma grand’mère, dans le faubourg du même nom (el kantara signifie le pont en arabe, c’est le premier pont construit, la voie d’accès principale de Constantine)
Jamais le vide ne nous effrayait alors. Mais la randonnée dans les gorges du Verdon et surtout le Grand Canyon, dans le Colorado, en Amérique m’ont plongée dans une angoisse paralysante.
Par contre, j’ai adoré, en Crète, la randonnée au fond des gorges de Samaria, en 1979, largement ouvertes avec des parfums de figuiers tièdes de soleil, tout le long de la quinzaine de km et au bout, la mer magnifique et la lumière comme une gifle… Souvenir de la Route de la Corniche, des figuiers sauvages et des cascades de Sidi M’Cid ?
•
L’appartement
Au 4ème étage, sans ascenseur, deux appartements de trois pièces s’ouvraient sur un petit palier et un étroit et sombre escalier en bois, refuge souvent des amoureux.
Dans l’un, deux familles chrétiennes, très modestes, l’une italienne, l’autre espagnole. Dans l’autre, la famille Melki, ma famille. La famille italienne Bel Antonio avec trois enfants occupait deux pièces et la cuisine. Une femme espagnole sans âge vivait dans une seule pièce avec son fils, un jeune adulte désœuvré qui la brutalisait. L’œil morne, la joue flasque malgré sa minceur, le cheveu gras très raide, il portait en permanence un costume noir avec une chemise blanche et cravate noire comme, jadis, les Espagnols sur leurs photos de mariage ou le Dimanche à l’église, mais le costume était lustré et la chemise défraîchie.
Les appartements partagés : collocations et sous-locations étaient très fréquentes à cause de la guerre, de la pénurie de logement et de la pauvreté. Cette femme, toujours en noir, petite, effacée, venait régulièrement repasser chez mes grands-parents. La misère a une odeur !
Pendant la guerre, l’appartement de mes grands-parents se composait d’un hall d’entrée, d’une salle à manger, de deux grandes chambres, d’une cuisine, d’un débarras, au fond d’un petit couloir, et d’un W.C. (Oui ! ma petite Clara ! nous avions des W.C. !)
Plus tard, à la fin de la guerre et au retour des jeunes hommes, la famille a loué l’appartement contigu qui s’était libéré dans un autre bloc d’immeuble. On a abattu des cloisons et curieusement ce deuxième appartement s’ouvrait de l’autre côté de la rue Thiers très pentue, au 2ème étage du 36 rue Thiers. Dans l’appartement agrandi, à deux entrées, on pouvait accéder d’un côté, le 44, par 4 étages d’un escalier en bois étroit et sombre, et de l’autre, par 2 étages de larges escaliers au 36. •
« La suicidaire »
Le 2ème appartement avait été occupé, avant nous, par un couple relativement jeune de métropolitains portés sur la boisson, et, un jour, la femme, qui s’était précipitée par la fenêtre du 4ème étage , a été miraculeusement stoppée dans sa chute à l’étage inférieur où elle était restée accrochée au garde-fou du balcon, happée au passage par le père ou un des 2 fils de la famille du 3ème étage, Charley ou Guy K. Elle s’en est tirée, peut-être dessaoulée, avec quelques contusions pendant que son mari criait d’une voix pâteuse : « Où est ma femme ? Où est ma femme ? » Penché à la fenêtre au-dessus du vide.
Il faut dire que les gorges du Rhumel exerçaient une fascination fatale sur tous les suicidaires.
 |
Trajectoire de la « suicidaire » d’une fenêtre à un balcon. 44 rue Thiers. |
La salle de bains était devenue un luxe nécessaire en 1944. Jusque-là nous utilisions un tub dans la cuisine et de l’eau chauffée sur la cuisinière au gaz de ville. Nous allions aussi très régulièrement au bain maure. Mais je l’avais en horreur. •
Le Hammam
Le hammam n’était fréquenté que par des femmes arabes –la majorité – et juives.
Dans ma petite enfance, j’avais le bain maure en horreur. Celui que j’ai connu ne correspond absolument pas du tout à l’image idéalisée, esthétisante, érotisante, aseptisée mais fictive et occidentalisée qu’en donnent les peintres dits « orientalistes ».
Une fois poussée l’énorme porte en chêne avec un anneau métallique, poisseuse d’humidité, on était pris de suffocation dans une vapeur opaque, trop chaude.
La vapeur d’eau bouillante s’élevait d’une immense cuve sans cesse alimentée par des « négresses »* avec des baquets d’eau froide puisée dans une autre cuve.
Les hautes voûtes sombres renvoyaient en écho un brouhaha continu. Des trous dans la longue voûte en berceau laissaient filtrer un jour avare et, en entrant, on distinguait à peine les groupes de femmes assises sur des tabourets bas qui émergeaient peu à peu du brouillard. Dans la lumière blafarde, des ombres de femmes nues parfois couvertes d’un simple pagne, « foutah » souvent rouge à bandes noires, circulaient fantomatiques.
Un cercle de l’enfer de Dante !
Des femmes noires sans âge, énergiques, très maigres, aux membres noueux, nous frottaient le corps avec de l’alfa et du savon et la tête avec du « ghassoul », cette argile minérale naturelle, saponifère, extraite des montagnes de l’Atlas marocain, devenue aujourd’hui à la mode, ou du savon de Marseille puis rinçage à l’eau vinaigrée. Elles nous briquaient, leurs mamelles sèches pendantes oscillant à chaque secousse.
Des femmes s’épilaient avec une pâte verdâtre, soufrée, malodorante dont elles s’enduisaient tout le corps.
Les chevelures étaient recouvertes d’une pâte de henné qui coulait en traînées rouges sur les fronts et les cous dégoulinant de sueur.
On glissait sur un sol gras et mouillé qui charriait en permanence de l’eau savonneuse et des touffes de cheveux. L’humidité rongeait tout. Des odeurs de soufre et d’égout flottaient partout.
Mais j’appréhendais surtout le rinçage final et l’eau puisée dans un baquet de bois fumant déversée sur ma tête avec une « tassa » en cuivre. J’avais du savon et de l’eau plein les yeux et le nez. Je pleurais, je me débattais, mais la femme me tenait en étau entre ses genoux.
Plus tard, adolescente et adulte, j’ai aimé le bain maure et la sensation d’être lavée de tout, purifiée, ressourcée après une séance d’intense transpiration et de rinçages abondants répétés. Je me suis même prêtée parfois aux massages de ces femmes, malheureuses esclaves venues de l’Afrique subsaharienne, qui pratiquaient aussi les massages, à même le sol, après avoir balancé, d’un geste ample, un plein seau d’eau, pour faire place nette.
Je ne réalise qu’aujourd’hui la dure condition de ces femmes, contraintes d’accepter ce « gagne-misère » qui desséchait leurs chairs et momifiait leur peau noire.
Après la guerre, de petits bassins de pierre individuels, parfois avec robinetterie, avaient remplacé les baquets de bois cerclés de mon enfance. L’espace avait été un peu compartimenté et, me semble-t-il, l’hygiène mieux respectée.
Note :* Négresse : ce vocable ne doit pas choquer dans ce contexte. Le vocabulaire évolue comme les réalités et les mentalités. Martin Luther king lui-même est passé du terme « negro » à celui de « black »(avec le « black power ») et pourtant en latin « niger » ne signifie que « noir », mais « nègre » est resté connoté « esclavage »et « trafic triangulaire ».
•
Les soirées en famille de 1940 à mi-1942
La salle à manger Henri II (style convenu à l’époque et décrié par les esthètes, mais que je trouve très beau néanmoins) en chêne massif toujours luisant de cire, se composait d’un grand buffet aux portes sculptées en profond relief d’animaux fabuleux et de personnages sur lesquels je m’inventais des histoires. Leur accoutrement m’intriguait … Encore aujourd’hui, je ne saurais dire s’il était moyenâgeux ou folklorique de provinces françaises si lointaines pour nous. A une desserte du même style, reste attaché pour moi le souvenir de délicieux camemberts à la douce pâte fruitée que nous découvrions après la guerre et tant de pénurie.
 Les chaises étaient recouvertes d’un cuir brun de Cordoue gaufré, avec petits motifs de rinceaux stylisés, retenu par de gros clous de laiton. Le piètement central de la table formait un grand carré fermé à l’intérieur duquel nous adorions nous cacher sous la nappe toujours blanche du vendredi soir. Les chaises étaient recouvertes d’un cuir brun de Cordoue gaufré, avec petits motifs de rinceaux stylisés, retenu par de gros clous de laiton. Le piètement central de la table formait un grand carré fermé à l’intérieur duquel nous adorions nous cacher sous la nappe toujours blanche du vendredi soir.
Deux mystérieux placards muraux se trouvaient à l’emplacement de fausses fenêtres visibles sur la façade extérieure de l’immeuble. L’impôt sur les portes et fenêtres, responsable de la multiplication des fausses fenêtres, ne sera supprimé qu’en 1926, après la construction de l’immeuble. Un des placards, dissimulé derrière la desserte, contenait une bibliothèque acquise par Maurice de livres précieusement reliés en cuir pleine peau de littérature française et de traductions latines que j’ai, en vain, plus tard, essayé d’exploiter pour mes versions de Tacite. Et l’autre, bien visible, mais interdit d’accès, les réserves de conserves et confitures à l’usage exclusif de la semaine de Pâque.
Je n’oublie pas le vieux piano Pleyel que mon grand-père avait offert à ma mère en 1928 pour son anniversaire, miraculeusement rescapé, sauvé en 1957, par Yolande alors qu’il était abandonné sur le palier, après l’exode de toute la famille pour la France ou Israël. Geneviève le conserve toujours chez elle. Ses touches à l’ivoire jauni et craquelé ont subi bien des doigts malhabiles. Après ma mère, j’y ai fait mes gammes et, accompagnée de Josiane au violon, joué la marche nuptiale de Mendelssohn lors du mariage d’Eugène avec Eléonore. Je revois aussi, interprétant une valse de Chopin, la malheureuse X., si belle et si douée qui a sombré dans la folie, à peine sortie de l’adolescence, dès le début de ses études supérieures à Alger.
L’hiver
Dans cette salle à manger, pendant la guerre, nous passions les soirées d’hiver autour du « Mirus », le poêle en faïence lie de vin, alimenté au bois, les lourds rideaux de velours rouge tirés sur le froid extérieur.
 Grand’mère somnolait sur sa chaise basse ou faisait des petites pâtes, les « kaouas ». Elle avait l’air éteinte mais ses doigts continuaient avec une agilité et rapidité extraordinaires à donner forme à ces petites pâtes un peu safranées qui tombaient comme une pluie d’or dans un récipient en osier tressé recouvert d’une serviette, posé sur ses genoux. Grand’mère somnolait sur sa chaise basse ou faisait des petites pâtes, les « kaouas ». Elle avait l’air éteinte mais ses doigts continuaient avec une agilité et rapidité extraordinaires à donner forme à ces petites pâtes un peu safranées qui tombaient comme une pluie d’or dans un récipient en osier tressé recouvert d’une serviette, posé sur ses genoux.
Grand-père, resté assis à table, chantait doucement des psaumes et des poèmes liturgiques. Après le repas, une main posée à plat sur la nappe blanche, main qu’il soulevait parfois comme pour marquer le tempo et l’autre tenant sa tabatière, il chantait. A intervalles réguliers, il s’arrêtait pour porter à son nez une prise de tabac que d’une pincée de ses deux doigts jaunis, il puisait en fourrageant méticuleusement dans sa tabatière en or finement ciselée. Il aspirait la poudre, narine après narine, dans un reniflement sonore à deux temps, ensuite, avec son grand mouchoir à rayures violettes largement déployé, il se mouchait bruyamment également narine après narine.
Puis le chant reprenait.
Pendant ce temps, Mireille s’occupait de nos engelures. Paul bricolait je ne sais quoi ou lisait ses bandes dessinées : Bicot, Les Pieds Nickelés…
Josiane et moi attendions Mireille. Surtout l’hiver, nous avions peur de rejoindre notre chambre commune noire et glacée. Parfois nous nous endormions à table, au chaud, la tête posée sur nos bras croisés. Les lits étaient froids et humides malgré les bouillottes, nos doigts et orteils bouffis et rouges
d’engelures. Seule la salle à manger était chauffée avec le poêle à bois. Nous y étions tous réunis.
Après la guerre seulement, le chauffage central alimenté avec des boules de coke entreposées à la cave, fut installé dans toutl’appartement agrandi.
L’été
 L’été, les fenêtres enfin grandes ouvertes sur le ciel immense pour capter le moindre souffle frais de la nuit, nous occupions nos débuts de soirée à manger des amandes fraîches que nous cassions au pilon de cuivre sur le bord de la fenêtre. Nous en avions des couffins pleins, directement cueillies de l’arbre. Parfois, nous mangions des abricots, au-delà du raisonnable, juste pour récupérer les noyaux avec lesquels nous jouions. Nous lisions aussi : outre Bicot et les Pieds Nickelés, des Contes de fées, Hector Malot : En Famille et Sans Famille, A. Daudet : Le Petit Chose, J. Renard : Poil de Carotte etc... Soir après soir, ensuite, nous recherchions la petite Ourse et la grande Ourse au milieu des étoiles. L’été, les fenêtres enfin grandes ouvertes sur le ciel immense pour capter le moindre souffle frais de la nuit, nous occupions nos débuts de soirée à manger des amandes fraîches que nous cassions au pilon de cuivre sur le bord de la fenêtre. Nous en avions des couffins pleins, directement cueillies de l’arbre. Parfois, nous mangions des abricots, au-delà du raisonnable, juste pour récupérer les noyaux avec lesquels nous jouions. Nous lisions aussi : outre Bicot et les Pieds Nickelés, des Contes de fées, Hector Malot : En Famille et Sans Famille, A. Daudet : Le Petit Chose, J. Renard : Poil de Carotte etc... Soir après soir, ensuite, nous recherchions la petite Ourse et la grande Ourse au milieu des étoiles.
La radio- une grosse T.S.F. en bois- n’était allumée que pour les informations et Radio-Londres, la BBC, dont l’indicatif sonore, les 4 notes de la 5ème Symphonie de Beethoven dite « héroïque » (en morse 3 brèves, 1 longue : le V de victoire) résonne encore à mes oreilles. Le reste, pour l’instant, dépassait mon entendement.
Après 1944
A notre retour à Constantine en 1944, après presque deux ans passés à Oran où nous avons vécu, chez nos parents, le débarquement américain, le rétablissement du décret Crémieux et le retour à l’école,- épisode important de mon enfance que j’ai aussi raconté- les soirées étaient moins sereines. Mes trois oncles Maurice, Eugène et Georges et mon père avaient été remobilisés. Nous attendions dans l’angoisse des nouvelles du Front. Nous commencions à soupçonner l’indicible. J’entendais associer le nom d’Hitler à celui d’Aman. Campagne d’Italie, débarquement en Provence, Campagne d’Allemagne ! Grand-père gardait l’oreille collée au poste et priait. Grand’mère scrutait les rares photos envoyées par ses fils et y découvrait des motifs d’inquiétude. Georges, affecté au service de santé, a été gravement blessé deux fois en allant chercher des blessés sous les balles et elle seule l’a senti ou compris en regardant une photo. Et il en sera ainsi jusqu’à leur retour. La France a été reconnaissante à Georges : croix de guerre avec 3 citations, médaille militaire, Légion d’honneur à titre militaire décernée dans la Cour d’honneur des Invalides à Paris.
C’est à Constantine que nous avons célébré sobrement la victoire, si cher payée, entachée par les tueries de Sétif le 8 Mai 1945 et la terrible répression de Sétif, Guelma et Kherrata qui fit dire au général Duval : « Je vous donne la paix pour 10ans, à vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés ! ». Neuf ans après, la Toussaint 1954 et la guerre à nouveau !
•
Joseph et Hocine . Années de guerre.
Un ou deux ans après notre arrivée à Constantine, Hocine a rejoint le cercle de famille autour du feu, sans perdre pour autant tout à fait son statut subalterne.
Il avait 14ans environ, aidait un peu au ménage mais surtout aux courses et petites corvées : le four banal, les petits achats, monter de la cave les bûches ou les boules de coke l’hiver, la glace pour la petite glacière l’été, les marchés tous les jours.
Joseph
Mais cette dernière charge revenait surtout à Joseph, employé aussi au magasin de mon grand-père, un pauvre Juif, père de famille nombreuse, alcoolique, qui découpait  de larges trous dans ses godasses de cuir informes parce qu’il avait des cors. de larges trous dans ses godasses de cuir informes parce qu’il avait des cors.
Il était malodorant, transpirait, tremblait, s’empêtrait dans les comptes qu’il rendait à grand’mère qui se disputait continuellement avec lui. Sans cesse, il soulevait sa casquette crasseuse pour s’éponger le front. Son pantalon de récupération troué au genou, trop grand pour lui, était retenu à la taille par une ficelle.
Je revois ce malheureux Joseph, courbé sous un énorme bloc de glace qu’il portait sur l’épaule, un sac de jute posé en capuchon sur sa tête, dégoulinant de sueur et de glace fondue après avoir monté péniblement les 4 étages. Parfois il avait attendu des heures depuis l’aurore pour en obtenir.
On conservait la glace dans une petite glacière, et aussi, enveloppée dans de vieilles couvertures, dans de grandes bassines en zinc. La matière plastique nous était inconnue. On débitait la glace au couteau et au marteau. Pour conserver l’eau fraîche, on utilisait aussi des « gargoulettes », cruches poreuses en argile, ou des récipients en verre, entourés de linges mouillés : souvent des bouteilles dans des chaussettes de laine.
Joseph était aussi chargé de remplir, à la cave, les bouteilles du vin blanc et rosé cacher tiré de gros tonneaux que grand-père commandait chez Kanoui à Alger. Là il s’attardait beaucoup et remontait l’œil trouble et le pas chancelant. Pourquoi aussi tenter le diable ?
Pauvre Joseph ! Qu’est devenu ce malheureux après 1962 s’il avait survécu ?
Hocine
Pour en revenir à Hocine, son frère aîné, âgé d’environ 15 ou 16 ans, qui travaillait dans la famille S., l’avait conduit, un jour, loqueteux et pouilleux, de son douar chez mes grands-parents. La misère était grande chez les Arabes et beaucoup de Juifs aussi, surtout pendant la guerre.
Ma grand’mère a donné à l’adolescent de l’argent et du linge propre, pas tout à fait à ses mesures, et l’a envoyé directement au bain maure, sans même le faire entrer dans l’appartement, en lui recommandant de se faire raser la tête et de jeter toutes ses hardes à la poubelle. Les poux et le typhus étaient un terrible fléau. En 1941, Pierre Cohen-Solal, le jeune oncle de 27 ans de mon mari est mort du typhus à Constantine. Et aussi la même année, au collège de Sétif où il était pensionnaire, un jeune Bougiote de ses amis, Paul Courand, âgé de 17 ans. Et toujours en 1941, une épidémie de typhoïde frappa, entre autres, mon oncle Maurice. Les enfants de la famille furent recueillis par Suzette jusqu’à la guérison. Poux, puces, punaises, blattes proliféraient partout. Pénurie de savon, de produits désinfectants et de médicaments ! Rareté de l’eau ! Pauvreté et promiscuité ! Impuissance de la médecine ! Jusqu’à l’arrivée des Américains, de la D.D.T. du savon et de la pénicilline inconnue jusque-là!
Hocine, donc, est revenu du hammam et s’est attaché à la famille. Il souffrait de malaria et ses crises, malgré la quinine, étaient fréquentes. Il était secoué alors de violents tremblements et suait sur sa literie qui sentait l’urine et qu’il repliait le matin. Grand’mère et Mireille le soignaient comme l’un des enfants.
Bien plus tard, dans les années 50, il avait été promu employé du magasin de tissus. Josiane et moi étions en vacances à Constantine et nous l’avons rencontré par hasard rue Nationale, métamorphosé, correctement vêtu et si heureux de nous voir : « Claudette ! Josiane ! ». Il nous aurait bien embrassées mais. ..
Certes, au quotidien, nous vivions dans une relative harmonie avec les Arabes, depuis des siècles, nous les Juifs, mais chaque communauté dans son quartier et avec les siens : Le quartier juif : Kar Chara, le quartier arabe, et, avec la colonisation, le quartier dit : « européen ». Seule l’école fut un lieu extraordinaire de brassage et d’assimilation, mais les enfants arabes étaient minoritaires à l’école de Jules Ferry.
Les massacres du 5 août 1934
« Ce jour-là la France était absente ».
Nous évitions les quartiers arabes et depuis les pillages et massacres du 5 août 1934 qui avaient endeuillé la communauté juive de Constantine et fait 25 victimes dont 6 femmes et 4 enfants, nous vivions dans la méfiance et la sourde crainte d’un nouveau « pogrom », encouragé par l’antisémitisme d’Etat et ambiant. Le pogrom de 1934 eut lieu à Constantine mais aussi à Ain Beida, Sétif et divers villages de l’Est. Le climat s’apaisa un temps, après la guerre, la défaite nazie et la découverte des camps, le peuple juif pensait avoir recouvré sa dignité et trouvé, enfin, sa normalité, mais la bête immonde que nous croyions abattue, l’hydre aux multiples têtes dont l’une immortelle de l’antisémitisme, ne faisait que somnoler !
•
La trappe sous le toit
Chez mes grands-parents, pendant la guerre, au fond d’un court et étroit couloir sombre qui menait à la chambre des enfants et se terminait en cul de sac, une échelle permettait d’accéder à une trappe sous le toit.
Grand’mère nous disait : « Si des émeutiers arrivent, vous vous cachez là-haut et vous ne parlez pas, vous ne bougez pas ! ». Le traumatisme du 5 août 1934 était encore vivace dans les années 1940 !
Cet endroit me remplissait d’autant plus d’effroi qu’il avait été transformé en véritable caverne d’Ali Baba.
Dans l’ombre, s’entassaient de gros sacs de jute boursouflés, difformes, remplis de légumes secs, farine, semoule, café vert en grain et aussi de très gros pains de sucre coniques, d’énormes jarres d’olives vertes et noires, de miel épais et d’huile d’olive à l’odeur puissante qui figeait l’hiver et qu’on puisait difficilement à la louche. Une insolite épicerie aux odeurs mêlées derrière un simple rideau.
Mais, dans l’ensemble, à Constantine, enfants, ma sœur et moi avons vécu ces années chez mes grands-parents, malgré la guerre, les lois de Vichy et notre renvoi de l’école en octobre 1941 (cause de notre présence à Constantine) dans une rassurante sérénité, protégées par l’affection des adultes, en « vase clos ».
Notre vie était bien réglée et sécurisante pour deux petites filles très ballottées jusque-là. Ma petite tante Mireille, seulement de dix ans mon aînée, nous entourait d’affection, s’occupait de nos jeux qu’elle partageait parfois, de notre travail scolaire. Elle illustrait de dessins nos « cahiers de poésie ». Elle était gaie et chantait. Nous l’aimions. Grand’mère, dévouée et bienveillante, régnait sur ses fourneaux et sur Joseph et nous houspillait mollement. Nous respections grand-père, son autorité affectueuse, sa culture et sa foi. Nous nous disputions avec Paul à qui Mireille donnait toujours tort puisqu’il était l’aîné. Chacun était à sa place. Le monde était en ordre.
2 - Grand-père Alfred, Fredj, Melki
né à Constantine le 10 février 1890 - mort en Israël le 6 mars 1984

• • •
Constantine 1941-1948
De 1941 à 1943, période de tourmente, nous avons fait, ma petite soeur Josiane et moi, de fréquents séjours à Constantine, chez mes grands- parents maternels.
A partir de 1944 et jusqu’en 1948, nous y avons vécu durant quatre années scolaires.
Nous suivions De Gaulle qui affirmait le 26 Juin 1940 à Londres, à la B.B.C. « nous referons la France » pendant que la France de Pétain préparait sa « Révolution Nationale » en s’attaquant à « L’Anti-France ». Une des premières mesures pour la « restauration morale » de la France fut de rendre la « France aux Français »et nous, à notre statut « d’indigènes »en Algérie. Mon père fut licencié de la fonction publique. Peu après, Paul et moi fumes renvoyés de l’école publique, Josiane (4 ans) du jardin d’enfants payant du Lycée Laveran (sa jeune institutrice pleurait en lui rendant son petit tablier et le panier d’osier brodé de fils de laine multicolores dans lequel elle transportait d’ordinaire son goûter) et Georges de la Faculté de Médecine. Mes parents, obligés de quitter Oujda, réduits à Oran à une vie de parias, contraints de vivre à l’hôtel, nous confièrent, ma sœur et moi, à nos grands-parents, à Constantine où les privations se faisaient moins sentir et surtout où, entourées, protégées, nous pouvions continuer à vivre normalement.
« Un régime patriarcal »
La famille restée à Constantine à cette époque : grand-père, grand’mère, Mireille, Paul, Josiane et moi, toute la maisonnée vivait sous un régime patriarcal.
Ma grand’mère Clara, Valentine, née Sultan, cardiaque, alourdie par les maternités et très myope, vivait dans l’ombre et au service de son époux.
Grand’ mère debout dès le point du jour, servait à son époux un café parfumé à la fleur d’oranger qu’il sirotait bruyamment après la première prière matinale avec taleth et phylactères. Toute la matinée à la cuisine, elle lui faisait servir café au lait, citron pressé etc… dans son lit où il demeurait souvent assis à prier ou à étudier, calé dans des coussins, avec sa tabatière en or à sa portée. Pendant la guerre, un client lui offrait un tabac à priser de qualité dans de grandes bouteilles en verre fermées par des capsules de porcelaine.
Ma petite tante Mireille, seule jeune fille de la maison, prenait le relais de grand’mère pour aider son père à s’habiller. Yolande qui était institutrice à Biskra, s’était mariée le 21 Décembre 1941, juste après avoir perdu, elle aussi, son emploi ainsi que son mari Armand, jeune avocat débutant.
En 1940, grand-père n’avait que 50 ans mais, avec ses cheveux et sa barbe blanchis prématurément, il s’était installé dans une vieillesse studieuse et respectée. Il était le patriarche. Tout naturellement chacun le respectait et le servait et il lui était naturel d’être servi.
Fils unique avec deux sœurs dans un milieu où, chaque matin, on remercie Dieu de n’être pas une femme (voir la prière du matin), il était marqué par la mentalité judéo-arabe de son milieu à cette époque.
Bien que d’origine livournaise par son père, grand-père faisait partie de cette « génération tournante »selon l’expression de Chouraqui, avec une enfance judéo-arabe et un âge adulte français. Il maîtrisait parfaitement le français écrit y compris l’orthographe, et oral, mais il roulait les « r » comme ceux qui pratiquent couramment l’arabe.
Parfois, avec grand’mère, les échanges se faisaient en arabe.
En 1913, à la naissance de ma mère Hélène, son premier enfant, il était si déçu d’avoir une fille qu’il a refusé de la voir pendant 8 jours. Son excuse ? Les préjugés de son milieu et sa jeunesse impétueuse : 22ans !
Ensuite, la sagesse venant avec l’âge, et son esprit ouvert et tolérant prenant le dessus, son affection pour ses filles et petites filles ne s’est jamais démentie. Grand’mère, à table, lui préparait une assiette de fruits pelés et découpés qu’il mangeait à la fourchette, à cause de ses doigts jaunis par le tabac à priser. Il mangeait lentement, religieusement, avec maintes prières pour remercier Dieu.
Par sobriété ou pour obéir à je ne sais quel précepte talmudique, il ne consommait que la moitié des assiettes qu’on préparait pour lui, après en avoir soigneusement partagé le contenu. Parfois, par convivialité et esprit de partage, à la mode africaine, grand’mère et lui mangeaient dans la même assiette..
Grand-père était plutôt petit, un peu bedonnant sans être gros, il avait une noble et belle tête blanche, une abondante chevelure très raide et brillante, des sourcils épais, un peu broussailleux, une barbiche impeccablement taillée et de grands yeux clairs, plutôt verts par « temps calme » et gris quand il était en colère. Il avait de très belles mains, très soignées, aristocratiques. Il avait dû être beau comme Eugène.
La barbe de deuil : la révolte du Sage.
Tous les ans, pendant 33 jours, du 1er jour de Pâque soit 1er soir de Omer jusqu’au Lag Baomer soit 34ème soir de Omer, grand-père laissait pousser une barbe de deuil pour commémorer la mort de 24000 disciples de Rabbi Ha kiva décimés pendant 33 jours par une épidémie de peste.
Mais quand grand’mère mourut le Samedi 8 avril 1949 du Shabbat Agadol qui précède Pâque, il entra en rébellion contre son Dieu qui lui infligeait ainsi en même temps un double deuil et il mit fin à cette pratique rituelle. Son perpétuel dialogue avec le dieu de ses pères fut sûrement houleux ce jour-là, digne certainement des révoltes des grands prophètes bibliques ou des poètes romantiques : « Pourquoi ma place est-elle douloureuse ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ? » Jr 15-18 « Oh Dieu ! Ne te dérobe pas : j’erre çà et là dans mon chagrin... »Ps 55.1.3
La pureté, même physique, étant une exigence de sa foi, il apportait un soin extrême à sa tenue et était d’une propreté méticuleuse. Il faisait même cirer la semelle de ses chaussures.
En Israël, chez Mireille où il séjournait, il exigea une douchette dans les W.C.
Chaque jour, on repassait avec pattemouille les plis de ses pantalons préalablement dépoussiérés et détachés avec une brosse et une décoction de « sapindus », ces petites boules de couleur marron, provenant du savonnier, qui moussaient et qu’on achetait chez le droguiste.
Avant de sortir, il se pliait au rituel de la brosse à habits avant celui de la Mezouza. En franchissant le seuil dans un sens ou dans l’autre, grand-père prononçait une prière, la main posée sur la mezouza.
Son costume.
Grand- père a toujours adopté le costume européen, contrairement à beaucoup de vieux Constantinois de sa génération, comme Sidi Fredj, le Grand Rabbin du département par exemple, qui parfois, promenait sa longue silhouette drapée dans un burnous.
Grand-père portait, l’hiver, un chapeau melon, à la mode du début du siècle, comme un Lord anglais. L’été, un panama de paille. Et toujours un costume cravate de bon faiseur (ses tailleurs étaient Drai et Ghenassia, rue Nationale à côté du Lycée Laveran) avec un gilet l’hiver et sa montre en or à gousset dont la chaîne pendait sur le gilet.
A son retour au foyer, en 1919, après la guerre, il fit renoncer grand’ mère au costume traditionnel des Juives de Constantine.
Grand-père et les enfants
 Grand-père qui avait été un très jeune père dur avec ses 3 premiers enfants : Hélène, ma mère, Maurice et Eugène et usait peut-être du nerf de bœuf, selon une conception de l’éducation qui relevait du dressage animal, avait, quand nous vivions avec lui, abandonné, depuis longtemps, les châtiments corporels. Yolande née le 1er mai 1919 ne se souvient pas avoir reçu une seule gifle de son père. Grand-père qui avait été un très jeune père dur avec ses 3 premiers enfants : Hélène, ma mère, Maurice et Eugène et usait peut-être du nerf de bœuf, selon une conception de l’éducation qui relevait du dressage animal, avait, quand nous vivions avec lui, abandonné, depuis longtemps, les châtiments corporels. Yolande née le 1er mai 1919 ne se souvient pas avoir reçu une seule gifle de son père.
Il lui savait gré de l’avoir libéré du service armé. Il était réserviste à Biskra en 1919 et la naissance d’un 4ème enfant l’autorisait à rentrer dans ses foyers- ce qu’il fit aussitôt, sans avertir personne, fort de son bon droit. Il avait 29 ans !
Yolande suscitait une violente jalousie chez son frère Eugène qui se plaignait du traitement de faveur injuste dont elle jouissait. Il faut croire que Eugène, esprit rebelle, coléreux, « soupe au lait », mais tendre, affectueux, et charmeur aussi, a dû souffrir, enfant, de rudes corrections, car quand grand’ mère est morte en 1949, il s’est agenouillé auprès d’elle, refusant qu’on lui couvre le visage et pleurant : « Qui va me protéger maintenant ? » Il avait 33ans et revenait de la guerre !
Longtemps, longtemps après, Yolande, toujours restée très proche de ses frères et sœurs, a réconforté et accompagné Eugène dans ses dernières années de solitude à Cannes alors qu’il affrontait dans une maison de retraite sa maladie, un cancer de la gorge (Il avait tant fumé !) puis généralisé, et sa cécité. Et lors de son décès, en Janvier 1998, elle lui tenait la main, accompagnée seulement d’une des filles d’Eugène, Colette, dite Rachel juste arrivée de l’étranger, l’Australie, je crois, où elle élevait des moutons.
 Donc, au début des années 40, le nerf de bœuf désaffecté toujours bien visible, suspendu à un clou, ne servait qu’à nos jeux. Nous jouions à avoir peur. Donc, au début des années 40, le nerf de bœuf désaffecté toujours bien visible, suspendu à un clou, ne servait qu’à nos jeux. Nous jouions à avoir peur.
Grand-père avec nous était tolérant et d’une grande sagesse. Il n’avait pas besoin de sévir. Il nous inspirait le respect et nous obéissions. Le piano se taisait dès qu’il entrait dans la salle à manger. La « Lettre à Elise » tournait court.
A table, nous devions nous taire et ne pas nous lever avant la fin du repas.
Si, pendant une prière, nous nous mettions à chuchoter, il ponctuait sous forme de grognement une syllabe de son chant et le calme revenait. Les Vendredi soir sans parler de Pâque, nous finissions par nous endormir à table, la tête reposant sur nos bras croisés. Les prières étaient interminables. Grand’ père qui avait une belle voix, vocalisait, chantait en modulant des airs judéo-andalous. Il se livrait à toute sorte d’arabesques sonores. Il chantait en priant avant, pendant, et surtout après le repas, des psaumes en hébreu et des « hazarot »poésies médiévales sur les 613 commandements de la Torah.
Pendant l’année 1944-1945, après notre réintégration à l’Ecole Publique, je préparais à l’école Ampère, les examens de la Bourse et du Certificat d’Etudes pour entrer en 6ème au Lycée Laveran et je travaillais avec beaucoup de sérieux. Grand-père suivait de très près nos résultats scolaires et avec une fierté empreinte de solennité, il apposait sur mes carnets de notes une signature calligraphiée, claire, élégante : A. F. Melki. (Alfred, Fredj, Melki)
En 6ème j’étudiais le latin et l’Anglais, en 4ème le Grec ancien et je n’ai jamais reçu même une initiation d’Hébreu ou d’Arabe. Je le regrette.
Certes, nous connaissions par cœur les prières du Vendredi soir parce qu’elles étaient chantées. Adultes et enfants, en chœur, nous rendions grâce à Dieu dans l’allégresse d’une soirée familiale heureuse. Et jusqu’à aujourd’hui, ces prières sont indissociables pour moi de l’air dont mon grand-père accompagnait les paroles – qu’il comprenait littéralement, lui, avec quelques autres initiés de la famille.
Ailleurs qu’à Constantine et chantées autrement, je ne reconnais plus ces prières et suis à peine capable de suivre l’officiant.
Quant à l’arabe, parlé partout autour de nous, j’ignorais cette langue dont je ne comprenais et parlais que des bribes.
Mon grand-père : un "homme d'étude"
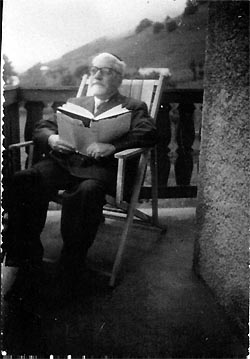 L’image que je garde de mon grand-père que tout le monde appelait « R’bi Haiem » est celle d’un homme d’étude. Je le revois toujours lisant, les lunettes sur le nez ou la loupe à la main pour déchiffrer les caractères hébraïques de ses vieux livres jaunis et souvent écornés. Des centaines couvraient le mur de sa chambre dans une très grande bibliothèque. L’image que je garde de mon grand-père que tout le monde appelait « R’bi Haiem » est celle d’un homme d’étude. Je le revois toujours lisant, les lunettes sur le nez ou la loupe à la main pour déchiffrer les caractères hébraïques de ses vieux livres jaunis et souvent écornés. Des centaines couvraient le mur de sa chambre dans une très grande bibliothèque.
Il était un érudit, grammairien et philologue, il maîtrisait l’hébreu ancien et moderne et étudiait l’araméen et l’arabe. En Israël, il acquit un dictionnaire de la langue hébraïque en 25 volumes. Il étudiait aussi le Nouveau Testament, le Coran et la Kabbale.
Il consacrait l’essentiel de son temps, surtout quand ses fils ont pris en charge le commerce de tissus, à la prière liturgique, à l’étude du Talmud et de la Bible. A partir de 1970, quand il perdit la vue, un rabbin venait tous les matins de 10 heures à midi pour lire et étudier avec lui les lois d’Israël (613 !). Jamais, à table, je ne l’ai vu avec un livre pour réciter les innombrables prières de toutes les fêtes qu’il connaissait par cœur, sans parler des psaumes et poèmes liturgiques.
Et c’est sûrement son immense culture qui le rendait si tolérant. Il respectait les rites alimentaires, mais sans rigidité et sans hypocrisie. « Tout ce qui vient de Dieu est bon », disait-il.
Par contre, un jour de shabbat, sur le chemin de la synagogue, il trouva, à ses pieds, un sequin d’or. Ce qui n’a rien d’étonnant puisque toutes les femmes juives qui portaient encore le costume traditionnel, en avaient, cousus sur la jugulaire ou la ceinture de leur tenue d’apparat du Samedi. Grand-père comprit que son Dieu le mettait à l’épreuve et il renonça à le ramasser. Cela aurait été « H’ram » péché.
Arrivé à la synagogue, il envoya un malheureux le ramasser mais celui-ci ne trouva rien à l’endroit indiqué. Dans l’intervalle, le sequin avait fait un autre heureux, moins scrupuleux d’observer la loi du shabbat.
Le linceul et le cognac.
« La mort ne surprend point le sage ». La Fontaine.
Grand-père nonagénaire attendait la mort sereinement. Il tenait prêt, dans son armoire, un linceul de lin blanc.
Un jour, pris de malaise, il dit à Paul, en montrant du doigt une étagère de sa bibliothèque chargée de livres :
Grand-père : « Tu vois ! Maimonide, cet éminent médecin, dans le 8ème livre à gauche, chapitre tant, décrit exactement ce que je ressens comme signes annonciateurs de la mort ! C’est ça ! Le ventre, c’est la fin ! ».
Paul : « Eh bien ! Récite le Chéma ! » .
Grand-père : « qu’est-ce que tu cherches ? »
Paul : « Ton linceul ! Pour t’enterrer ! ».
La réaction de Paul était due à sa nature effrontée et frondeuse autant qu’à son refus d’envisager la mort de son père.
Grand-père : « Bon ! Je crois que ça va mieux, apporte- moi un petit cognac ! ».
J’ai souri au récit que m’a fait Paul de cette scène, et comment ne pas penser à La Fontaine !
Grand-père né le 10 Février 1890 vécut 4 ans encore et mourut le 2 Adar Beth 5744 soit le 6 Mars 1984 d’une crise cardiaque « Néchika Elohim », le « Baiser de Dieu ». Mais, ce jour –là, il n’était pas prêt. Même le linceul resta introuvable. C’est Gaston Drai, un homme pieux qui offrit le linceul.
« Ce n’est rien ! Une indigestion ! » dit-il « C’est le thé que j’ai pris avec le biscuit que m’a apporté Mireille ».
Il n’avait pas prévu de mourir. Il voulait être présent à la Brit Mila, la circoncision du bébé de ses infirmiers dont il aurait été le parrain, le lendemain.
Cet après-midi-là, il attendait la chaise de Rabbi Eliaou Anabe (le prophète Elie) qui reste à la synagogue et que l’on apporte dans les maisons pour le rituel de la Circoncision.
Quand, enfin, elle arriva, heureux, il bénit tous les présents et à 8 heures du soir, il mourut dans l’ambulance qui le transportait, contre son gré, à l’hôpital.
Il fut enterré, très rapidement, le lendemain matin à 12 heures, selon le rituel juif, dans la terre de ses ancêtres.
Le sionisme de grand-père.
Grand-père et ses deux sœurs sont morts, après leur départ d’Algérie, à un âge très avancé pour cette époque. Grand-père à 94 ans en Israël, et ses sœurs dans le midi de la France. Grand-père a réalisé son rêve de toujours : vivre, mourir, être enterré en Israël.
je l’ai toujours entendu faire des références constantes à l’histoire juive et au retour espéré en Terre Sainte.
« L’an prochain à Jérusalem » n’était pas qu’un vœu pieux pour lui.
Il s’est toujours impliqué totalement dans la vie juive. A Constantine, il fut ministre officiant et administrateur du « temple algérois », rasé après l’indépendance.
En 1927, il faisait venir de Jérusalem le champagne pour la Bar Mitsva de Maurice. Chacun rapportait du sable de la « Terre Promise ».
Dès 1950, peu après son veuvage et moins de deux ans après la création de l’Etat d’Israël, il est parti vivre 6 mois de l’année à Jérusalem, tout seul dans un hôtel, à l’abri, croyait-il, désormais des pogroms et de tous les fascismes. Il voyait un signe dans son 2ème prénom Fredj qui signifie « délivrance » en hébreu. Une nouvelle sortie d’Egypte, en quelque sorte !
Ensuite, il fut hébergé à Jérusalem par un jeune couple David et Judith Sinaï, israéliens d’origine yéménite, qu’il avait connus à Constantine.
Paul se souvient les avoir conduits en 203 à un congrès à Alger en 1950. Le congrès dura trois jours que Paul, peu impliqué, mit à profit pour se promener et se distraire.
En Israël, grand-père fut nommé Grand Rabbin (Grand Maître) par le Sanhédrin de Jérusalem. Il recevait des Rabbins venus solliciter ses conseils pour leurs discours. Philologue, membre de l’Académie Hébraïque de Jérusalem, il apporta sa contribution à la création de la langue hébraïque moderne (d’où l’acquisition du Dictionnaire de l’Hébreu en 25 volumes !).
La famille de grand-père.
Alfred, Fredj, Melki, mon grand-père, est né à Constantine, le 10 février 1890.
Il est mort le 6 mars 1984 à Natanya, en Israël.
Son père : Haï Melki est mort en1916. Melki signifie « propriétaire » en arabe. Sa famille serait originaire de Livourne.
Sa mère : Radia Toubiana.Toubiana serait le nom d’une tribu de Nefoussa, dans le sud tunisien. Le Djebel Néfoussa est une région berbère. Racines judéo-berbères ?.
Un grand portrait du grand-père Haï trônait dans la salle à manger du 44 rue Thiers, avec un turban à la mode turque. Il est né, très probablement, avant 1870 et la naturalisation française des Juifs de l’Algérie, ottomane jusqu’en 1830.
Il était « sergent de police » et avait reçu une médaille de bronze pour « ses actes de courage et de dévouement » accomplis en 1893 lors d’une épidémie de typhus. Je ne peux pas m’empêcher d’évoquer à nouveau l’attitude héroïque de son petit- fils Georges qui fut blessé deux fois en allant chercher les blessés et victimes sous les balles, lors de la 2ème guerre mondiale. Incorporé dans le service de santé au 3ème bataillon médical, il fit la Campagne d’Italie, le débarquement en Provence et la Campagne d’Allemagne. Il fut décoré de la croix de guerre avec 3 citations et de la Médaille Militaire et reçut le titre de Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire, dans la grande Cour des Invalides, le Jeudi 21 Mai 1970…
Un poignard avec une croix gammée, trophée de guerre de Georges, avait été accroché symboliquement à côté du portrait du grand-père Haï. Ils s’étaient tous deux, le grand-père et le petit-fils, dévoués pour la Vie, l’un contre un fléau de la nature et l’autre contre la peste brune. (Haï signifie Vie en hébreu)
Le « rapport » du « sergent de police » Haî Melki
| 
Eugène
|
Le plaisant rapport en sabir franco- arabe aux allitérations comiques que la légende familiale prête au « sergent de police » Haî Melki et que son petit-fils Eugène se plaisait à répéter : «assara Arabes tombés dans le râ, ça me regarde pas ! ».En arabe, « assara » signifie dix, et « râ », cuvette, ravin, trou. Ce rapport a- t-il existé et correspond-il à un accident réel ? Il signifierait que dans les années 1890-1910, le statut du « sergent de police »juif, limitait ses attributions et interventions à ses seuls coreligionnaires ?
Haî est mort en tenant la main de sa belle-fille, ma grand’mère Clara, enceinte d’Eugène, donc en 1916.
Radia, son épouse, née Toubiana vécut et mourut ensuite chez son fils et elle adorait Eugène qui ressemblait à son défunt mari.
Un frère de Radia eut deux fils qui firent de brillantes études : Marcel Toubiana, professeur agrégé de Lettres Classiques au Lycée d’Alger dans les années 30 et son frère Directeur de l’Ecole de Garçons de la rue Danrémont à Constantine.
Leur émancipation et assimilation à la culture française avaient été fulgurantes dès le début du 20ème siècle. |
Les deux sœurs de grand-père.
Grand-père avait deux sœurs que j’ai bien connues. Elles portaient des prénoms arabes : Benina et Bellara et le costume traditionnel des juives constantinoises avec le petit cône sur la tête.
Le décret Crémieux date de 1870 et jusqu’en 1830 l’Algérie faisait partie de l’empire Ottoman. On y parlait arabe.
L’aînée Benina, plus brune que sa sœur, me semblait froide et sèche. Elle avait épousé Yacov A , un troubadour oriental, un « tourab addour » un « chanteur de maison », un fort bel homme aux yeux bleus qui se produisait avec une chéchia rouge, des bottes de janissaire comme un Turc, et des culottes et un gilet gréco-turcs.
 Sur la photo de son groupe de musiciens bien moustachus, il joue de l’Oud, le luth oriental constantinois avec 4 paires de cordes, apparu en 500 ap J. C. Probablement chantait-il le « Maalouf » : « fidèle à la tradition », amour courtois et élan vers Dieu. On peut noter sur cette photo la présence d’un « porteur de béret », comme on devait appeler les réfugiés espagnols de 1492 « Megourashim », par opposition aux juifs autochtones en turban ou chéchia «Toshabim ». Son instrument de musique est différent mais je ne suis pas spécialiste. Et les cigarettes des deux autres, Sur la photo de son groupe de musiciens bien moustachus, il joue de l’Oud, le luth oriental constantinois avec 4 paires de cordes, apparu en 500 ap J. C. Probablement chantait-il le « Maalouf » : « fidèle à la tradition », amour courtois et élan vers Dieu. On peut noter sur cette photo la présence d’un « porteur de béret », comme on devait appeler les réfugiés espagnols de 1492 « Megourashim », par opposition aux juifs autochtones en turban ou chéchia «Toshabim ». Son instrument de musique est différent mais je ne suis pas spécialiste. Et les cigarettes des deux autres,
probablement chanteurs, présents sur cette photo tronquée, me remplissent de perplexité amusée. Signe de virilité ? De promotion sociale ? Mode ? Pour la beauté de la pose ?
Le couple de ma grand ’tante vivait dans une certaine aisance.
J’ai entendu, une fois, cette sœur aînée autoritaire interpeler mon grand-père. J’ai ressenti cet incident comme un crime de lèse –majesté.
L’autre sœur, Bellara, plus jeune que grand-père, à la peau laiteuse et aux yeux très clairs, toute en rondeur et douceur, toujours souriante, nous accueillait avec chaleur.
Elle avait épousé un brave représentant de commerce : Simon Z. Elle hébergeait une sœur de son mari, une pauvre vieille fille simplette, « Un Cœur Simple », « Rachelou », toujours en tablier souillé à la cuisine. Bellara l’appelait à la rescousse pour partager sa joie de nous voir et son admiration pour de si mignonnes petites filles.
Rachelou avait une voix perçante et des baisers très mouillés dont je n’ai jamais réussi à me protéger.
Au retour à la maison, nous avions droit à la tournée de sel de
grand’mère, « contre l’œil ».
Epilogue
En 1999, soit 15ans après la mort de grand-père, j’accompagnais ma tante Yolande en Israël. La famille fêtait la Bar Mitsva de Ami-Haî, un petit fils de Mireille.
Lors de la cérémonie religieuse, l’officiant lut des textes en hébreu que grand-père avait composés.
Et, hommage émouvant, à l’entrée de la salle des fêtes, un immense portrait de grand-père sur un chevalet avait été installé. Autour de lui, tous les descendants présents (dont moi) se sont rassemblés pour la photo de famille souvenir.
3 - Grand-mère Clara
née et morte à Constantine (26 avril 1890 - 19 avril 1949)

• • •
Le costume hispano-judéo-arabe de ma grand'mère Clara.
Sur une photo de 1917, destinée à grand-père mobilisé à Biskra, grand' mère apparaît vêtue de la tenue traditionnelle des juives constantinoises avec, sur la tête, le petit cône caractéristique sur son foulard à franges noires : un hennin en miniature peut-être importé d'Espagne au Moyen Age : la "sarma" ou "kouffia". Dès 1919, à la demande de grand-père, elle renonça à cette tenue.
Grand'mère porte une fine chemise blanche aux manches amples retenues derrière sous une longue robe sans manches (la « djubba » en arabe dont « jupe » est l’avatar francisé en passant par la Sicile d’après le Robert) en tissus broché, lamé, au cou des louis d'or cousus sur un lien noir et, pour fermer le décolleté, une fibule (khlilettes) en or filigrané avec de petites perles baroques. On devine des bracelets presque jusqu'au coude sur le bras droit visible. Une assez riche parure en somme selon le goût oriental.
Autour d'elle, en contraste, signe de volonté d’assimilation, ses trois premiers enfants, habillés à l'européenne : à sa gauche, ma mère Hélène, impressionnée, l'air figé, un peu dur et les lèvres pincées, avec des bracelets aux deux poignées. Mon oncle Maurice, à sa droite, boudiné dans le costume marin mis à la mode en Europe par la reine Victoria en hommage à la Royal Navy et inauguré par Edouard VII enfant, et Eugène sur les genoux de grand’mère, très mignon dans sa longue robe festonnée qui cachait le "molleton" dans lequel on "enfagotait" les bébés. Les nourrissons étaient momifiés avec deux bandes: une fine pour le nombril et une épaisse pour retenir le molleton sous la poitrine. Cette pratique sévissait toujours dans les années 1950...
Grand'mère était encore très mince, mais peut-être pas très jolie.
Après sa "mue" en 1919, elle a offert toute son ancienne garde-robe traditionnelle à sa jeune belle- sœur Bellara que j'ai toujours vue habillée en judéo- arabe (sur une photo de famille datée 1947, Bellara est au centre). Grand'mère conserva jusqu'en 1942 deux somptueuses robes en velours pourpre brodées de fil d'or qu'elle avait reçues pour son mariage.
 Comment grand' mère se défit des deux précieuses robes pourpres lourdes de broderies d’or qu'elle conservait depuis son mariage, depuis plus de trente ans, de son ancienne garde-robe judéo- arabe. Comment grand' mère se défit des deux précieuses robes pourpres lourdes de broderies d’or qu'elle conservait depuis son mariage, depuis plus de trente ans, de son ancienne garde-robe judéo- arabe.
C'était en 1942, sous le régime de Vichy. Outre la pénurie, le magasin de tissus indigènes en gros du 4 rue Casanova avait été mis sous “administration aryenne”. Un
“administrateur aryen ” imposé, la gêne s'installait dans la famille.
Une veille de fête, Pâque ou kippour, grand- père vendit le vélo de course de Georges (celui qui avait servi à transporter l’agneau) pour pouvoir célébrer dignement cette obligation religieuse.
Là-dessus, arrive au magasin, en délégation avec deux autres rabbins, le Président du Consistoire qui faisait sa tournée pour quêter l'argent nécessaire au mariage de deux jeunes filles nécessiteuses.
Grand-père rouvre le tiroir à peine refermé sur l'argent du vélo et en remet le contenu. On ne refuse pas une “mitsva”!
Paul, 14 ans, privé d'école par les lois de Vichy était présent : « Tout? Tu as tout donné? Et la fête?”.
Grand- père :”Dieu pourvoira, mon fils!”
Le même jour, se présente au magasin un riche client arabe, à la recherche de deux robes brodées d'or pour le mariage de sa fille. C'était une spécialité de grand-père avant la crise de 1929.
Grand-père hésite un peu, puis actionne la manivelle du téléphone qui reliait le magasin à la maison : “Clara! Qu'as-tu fait des deux robes de velours pourpre brodées d’or que tu avais reçues pour ton mariage? Acceptes-tu de t'en défaire?”
Grand'mère avait vécu bien d'autres renoncements!
L'acheteur comblé, invité à donner son prix, fut d'une grande générosité.
Grand-père s'adressant alors à Paul « Tu vois? Mon fils, Dieu ne laisse jamais toutes les portes fermées!”
Et c'est ainsi que disparut complètement la garde-robe judéo-arabe de grand'mère.
•
La journée rose
La distillation de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau de rose était un rituel que nous célébrions, au printemps, comme une fête païenne, dans la joie, à la maison inondée de parfums.
Les Arabes, au marché, vendaient d'énormes sacs de délicates fleurs blanches ou rose pâle d'oranger bigaradier et de pétales de roses.
Jeune, grand'mère, vraie prêtresse de Flore, s'habillait de rose, pour l'occasion, avec un foulard rose sur la tête. Plus tard, elle se contentait de nouer un ruban rose sur l'alambic en zinc que l'on remontait de la cave une fois par an. A même le sol, sous l'alambic, un kanoun au charbon.
Au fur et à mesure que grand'mère recueillait l'extrait, elle étiquetait les flacons pour en indiquer la concentration: première bouteille, deuxième bouteille etc...Et elle suivait un "seder", un ordre rituel immuable: elle commençait toujours par l'eau de fleur d'oranger.
Une montagne de pétales et fleurs odorants sur un drap blanc au milieu de la cuisine, un alambic enrubanné de rose, la vapeur qui se condensait en gouttelettes qui roulaient dans le serpentin et, le soir, des flacons remplis d'une eau parfumée, c'était, pour nous, enfants, un enchantement, une journée magique: "la journée rose".
L'eau de fleur d'oranger « al maa zhar », « l’eau de chance » servait à adoucir le café, à parfumer les pâtisseries et les grenades de Roch Hachana, et à certains rituels religieux.
 Le “m'reuch” l'aspersoir en argent massif ciselé et repoussé était en permanence sur le buffet rempli d'eau de fleur d'oranger pour le café. On en aspergeait les convives et les fidèles pendant les festivités et à la sortie de la synagogue. L’équivalent en quelque sorte du goupillon et de l'eau bénite, chez les chrétiens. Le “m'reuch” l'aspersoir en argent massif ciselé et repoussé était en permanence sur le buffet rempli d'eau de fleur d'oranger pour le café. On en aspergeait les convives et les fidèles pendant les festivités et à la sortie de la synagogue. L’équivalent en quelque sorte du goupillon et de l'eau bénite, chez les chrétiens.
Pour les “Bar Mitsva” (littéralement “fils de la loi”) et pour “Simhat Torah” (la “joie de la Torah”) fête qui clôt la lecture annuelle du Pentateuque, marquée par des chants et des danses, les femmes, depuis le balcon où elles étaient tenues séparées des hommes à la synagogue, jetaient des dragées et aspergeaient les fidèles d'eau de fleur d'oranger.
Le “Chemache”, le bedeau, gardien de la synagogue, en versait aussi sur la main des fidèles, à la sortie.
Tous ces rites conféraient un caractère sacré à la fabrication de l'eau de fleur d'oranger.
Je possède un très beau “m'reuch” en argent massif, hérité de mes beaux-parents S…, mais je ne lui ai pas trouvé d’usage. Il est désaffecté. Aujourd'hui, en Israël, mon oncle Paul dit qu'on utilise de l'eau de Cologne à la synagogue. C'est banal et le rituel est vidé du symbolisme poétique de la fleur d'oranger.
Quant à l'eau de rose, « al maa ward », que Saladin fit transporter à Jérusalem reprise aux Croisés en 1187 par une caravane de 500 chameaux pour purifier la mosquée d’Omar et avec laquelle Mehmed II, en 1453, purifia l’Eglise byzantine de Constantinople avant de la convertir en mosquée, nous la réservions modestement à l'hygiène et à la toilette. On lui accordait des vertus adoucissantes pour les fesses rougies des bébés, les yeux congestionnés et toute sorte de petites misères de l'épiderme. Elle était le complément de l'huile d'amande douce et servait aussi de démaquillant pour les nez poudrés de la volatile poudre de riz rose qui se répandait en nuages même sur les cils et sourcils. Le poudrier avec sa petite glace et sa houppette de cygne était l'accessoire de maquillage indispensable et l'objet de toutes les convoitises pour les petites filles. On offrait un poudrier comme on offrait un bijou. Il y en avait de très précieux. Mais quand je suis arrivée à l'âge adulte, la poudre de riz et son “pompon” étaient passés de mode.
Et notre alambic et ses pétales parfumés remisés dans le Musée de nos souvenirs. •
La cuisine de grand'mère.
 La cuisine était sommaire. Sous une immense hotte, noircie à l’intérieur du conduit, bordée d’un volant festonné de rouge, un évier, un réchaud à gaz de ville, et, sur un plan de travail blanc carrelé que nous appelions « potager », un ou deux « kanouns »au charbon dont on attisait les braises avec un éventail en goum le « m’rahoua » et, en cas de besoin, un petit réchaud à pétrole en cuivre dont on activait la pompe pour faire jaillir la couronne d’une flamme bleue. L’orifice du réchaud était souvent bouché et on utilisait une aiguille à réchaud. La cuisine était sommaire. Sous une immense hotte, noircie à l’intérieur du conduit, bordée d’un volant festonné de rouge, un évier, un réchaud à gaz de ville, et, sur un plan de travail blanc carrelé que nous appelions « potager », un ou deux « kanouns »au charbon dont on attisait les braises avec un éventail en goum le « m’rahoua » et, en cas de besoin, un petit réchaud à pétrole en cuivre dont on activait la pompe pour faire jaillir la couronne d’une flamme bleue. L’orifice du réchaud était souvent bouché et on utilisait une aiguille à réchaud.
Contre un mur, une table en bois brut et, pour les marmites, un placard mural derrière un rideau, lieu de prédilection des blattes, énormes à Constantine où elles proliféraient, avec toutes sortes de nuisibles, avant l’arrivée des Américains et de la DDT !
Par manque de place, la grande « kesra »en bois d’olivier où on roulait le couscous et pétrissait la pâte, était rangée, après usage, sous un lit de la chambre d’enfant. Grand’mère, de petite taille, installait, pour pétrir, sa « kesra »sur un lit. On mettait aussi sur les lits recouverts de linges blancs, les pains et gâteaux, en attente de four banal. Et c’est ainsi que grand’mère, distraite, s’assit un jour sur un plateau de gâteaux de Pourim avant cuisson !
 L’eau coulait par intermittence au robinet. Elle était rationnée et, l’été, coupée à certaines heures. L’eau coulait par intermittence au robinet. Elle était rationnée et, l’été, coupée à certaines heures.
Quand, à l’étage inférieur, la jeune Mme T.. qui chantait tout le temps et n’avait que des filles, laissait couler l’eau trop longtemps dans sa courette, on entendait des borborygmes dans les tuyaux et ma grand’mère, excédée, crier devant son robinet qui crachait des bulles d’air : « Fermez l’eau ! » en détachant chaque syllabe d’un ton sans réplique.
On faisait presque tout à la maison : les conserves, les confitures, le pain, les pâtes, les gâteaux à l’exception de la « pièce montée »commandée à la pâtisserie pour le dernier soir de la semaine de Pâque. Echange familial rituel pour Pâque avec la tante Bellara, la jeune sœur de grand- père : elle offrait le plat de résistance : un couscous au mouton, on lui offrait le dessert : de la pièce montée à la nougatine.
L’été, toute sorte de pâtes entièrement faites à la main avec seulement des couteaux et un rouleau à pâtisserie séchaient sur des draps blancs étalés sur les lits de la chambre des enfants : des « rechtas », des « kaouas », des « dremettes » etc…
On torréfiait aussi le grain vert de café, à la maison, avec un torréfacteur au charbon, à manivelle. La corvée quotidienne du moulage, avec un moulin à café Peugeot en bois et métal vert coincé entre les genoux, revenait le plus souvent aux enfants.
A la belle saison, tous les Vendredi, un paysan arabe livrait des fruits et légumes frais de la plaine du Hamma où la famille de grand’mère, les S…, possédaient deux « jardins ». L’oncle Lazare D… s’occupait de la répartition entre les trois sœurs : Clara, ma grand’mère, Eugénie et Augustine : des petits navets d’or, de minuscules courgettes velues avec leurs fleurs, des guirlandes de gombos, des herbes odorantes, des tomates gorgées de soleil, des poivrons, des pastèques, des melons. Paul se souvient des pastèques et melons entassés sous le « potager » où grand’mère les entreposait après les avoir triés selon leur degré de maturité.
 On allait, en outre, tous les jours, s’approvisionner au marché. Pour quelques sous des « porteurs » surtout très jeunes, transportaient sur leur tête les couffins pleins jusqu’à l’appartement. Bien entendu, nous ne connaissions pas les « caddies ». Comme nous ne mangions que les fruits et légumes de saison, l’hiver, nous entamions enfin les bocaux si convoités. L’hiver, grand’mère faisait avec des légumes secs, du blé, du maïs, de l’orge perlé, des févettes et toute sorte de céréales, des soupes que je boudais, parce qu’elle les parfumait abondamment avec des épices auxquelles je n’étais pas habituée. J’aimais les petites « couronnes » mais je trouvais les autres pâtisseries trop grasses et trop sucrées : « makrouds », « cigares »etc. … je n’aimais pas beaucoup manger et j’étais difficile. Je ne voulais pas de poulet « parce qu’il avait des veines ! ». Pas de tfinas, surtout celle aux gombos. J’aimais le pain et le beurre mais … « Pas ce beurre- là ! ». C’était du beurre arabe, non traité, jaune ocré, rance et on le laissait nager, tout huileux, dans l’eau pour le conserver. Pendant la guerre il n’y en avait pas d’autre. On allait, en outre, tous les jours, s’approvisionner au marché. Pour quelques sous des « porteurs » surtout très jeunes, transportaient sur leur tête les couffins pleins jusqu’à l’appartement. Bien entendu, nous ne connaissions pas les « caddies ». Comme nous ne mangions que les fruits et légumes de saison, l’hiver, nous entamions enfin les bocaux si convoités. L’hiver, grand’mère faisait avec des légumes secs, du blé, du maïs, de l’orge perlé, des févettes et toute sorte de céréales, des soupes que je boudais, parce qu’elle les parfumait abondamment avec des épices auxquelles je n’étais pas habituée. J’aimais les petites « couronnes » mais je trouvais les autres pâtisseries trop grasses et trop sucrées : « makrouds », « cigares »etc. … je n’aimais pas beaucoup manger et j’étais difficile. Je ne voulais pas de poulet « parce qu’il avait des veines ! ». Pas de tfinas, surtout celle aux gombos. J’aimais le pain et le beurre mais … « Pas ce beurre- là ! ». C’était du beurre arabe, non traité, jaune ocré, rance et on le laissait nager, tout huileux, dans l’eau pour le conserver. Pendant la guerre il n’y en avait pas d’autre.
Ma grand’ mère aurait eu sûrement de bonnes raisons de ne pas m’aimer puisque je n’appréciais pas toujours sa cuisine, que je traînais les pieds pour aller au four (pourtant je ne reculais pas devant les petites tâches ménagères : mettre le couvert, moudre le café, laver les lavabos avec de l’alfa et du savon) mais je me sauvais pour ne pas lui laver les pieds et, parfois, je donnais raison à ce malheureux Joseph, bredouillant de crainte et d’alcool, quand elle me demandait de vérifier des comptes qu’elle lui contestait.
Peut-être, en voulait-elle à la guerre de cette situation et de cette charge qu’on lui imposait.
 L’après-midi, grand’mère s’endormait sur sa chaise basse, après avoir parcouru de ses yeux très myopes les premières et dernières pages de romans d’une petite collection populaire que Mireille empruntait chez un libraire arabe qui louait et vendait des livres d’occasion dans un étroit sous-sol sans fenêtres, rue de France. Grand-père la taquinait : « Alors ? Clara ! L’amant est sorti par la porte ou par la fenêtre ? ». Il se moquait ainsi des comédies de boulevard qu’il avait dû subir pour faire plaisir à sa femme, au magnifique théâtre de Constantine. Mais ils avaient été aussi amateurs d’opéras dont grand-père fredonnait parfois un air au milieu de mille chants liturgiques. L’après-midi, grand’mère s’endormait sur sa chaise basse, après avoir parcouru de ses yeux très myopes les premières et dernières pages de romans d’une petite collection populaire que Mireille empruntait chez un libraire arabe qui louait et vendait des livres d’occasion dans un étroit sous-sol sans fenêtres, rue de France. Grand-père la taquinait : « Alors ? Clara ! L’amant est sorti par la porte ou par la fenêtre ? ». Il se moquait ainsi des comédies de boulevard qu’il avait dû subir pour faire plaisir à sa femme, au magnifique théâtre de Constantine. Mais ils avaient été aussi amateurs d’opéras dont grand-père fredonnait parfois un air au milieu de mille chants liturgiques.
En fin d’après-midi, grand-mère retournait à la cuisine.
C’était là toute sa vie.
Je n’aimais pas toujours les plats qui sortait de cette cuisine mais j’adorais l’odeur et l’atmosphère de cette maison, surtout le Vendredi soir : odeurs mêlées de pain chaud, de la graine de couscous que la vapeur faisait gonfler dans le « kess-kess »-le panier conique en alfa- odeurs d’herbes aromatiques fraîches –menthe et coriandre- de pâtisseries aux parfums de vanille , de citron, de cannelle, de fleur d’oranger, une odeur généreuse, chaleureuse de fête et d’harmonie familiale.
La table était belle avec la nappe blanche, grand’mère avait troqué son tablier graillonné de cuisine contre une fraîche robe de cretonne souvent fleurie l’été. Mireille chantait, faisait des vocalises sur les prières en apportant les plats fumants. Grand-père remerciait Dieu en hébreu. Nous cessions de nous disputer avec Paul. La « meshama yetera » :l’âme supplémentaire qui nous visite le shabbat se réjouissait certainement.
Plus tard, adolescente, je suis devenue friande de tous les plats de la cuisine juive traditionnelle d’Afrique du Nord, que je suis heureuse de pouvoir confectionner à l’occasion. Mais grand’mère n’était plus là.
•
Le sorbet dit "Créponné", les olives, les abricots, les oranges confites.
 L’été, l’élaboration de sorbets au citron nous occupait, dans les rires et la joie, une grande partie de la journée. Grand’mère préparait le sirop de sucre avec du jus de citron pressé qu’elle versait dans la cuve de la sorbetière, une vieille sorbetière manuelle en bois cerclé. L’été, l’élaboration de sorbets au citron nous occupait, dans les rires et la joie, une grande partie de la journée. Grand’mère préparait le sirop de sucre avec du jus de citron pressé qu’elle versait dans la cuve de la sorbetière, une vieille sorbetière manuelle en bois cerclé.
Puis, autour de la cuve, nous remplissions la sorbetière de glace cassée au couteau et marteau dans un gros bloc, puis pilée grossièrement Nous ajoutions du gros sel et nous tournions, nous tournions la manivelle, à tour de rôle, un temps indéfini, jusqu’à ce que le liquide sucré au citron se transforme en un mousseux mais pas aussi neigeux sorbet que le « créponné » de la place de la Brèche. Il nous semblait délicieux. Nous l’avions bien mérité.
Mais je me demande aujourd’hui, si ce que nous obtenions, par manque de persévérance et de patience, n’était pas, le plus souvent, une « agua limon » mixture entre le sorbet et la citronnade glacée. Mais nous étions toujours si heureux du résultat !
 A la fin de l’été, les olives fraîchement cueillies arrivaient par sacs entiers, tellement belles, brillantes ou pruinées, avec leur dégradé de couleurs, vert, rosé clair, violet, noir violacé ou noir mais tellement amères. Chacun s’évertuait pour aider grand’mère à casser délicatement les olives vertes, sans écraser la pulpe ni entamer le noyau, avec les manches des pilons de cuivre, avant de les mettre à la saumure dans de grandes jarres de grès. Les olives noires, les plus mûres et les plus chargées en huile, étaient suspendues dans des sacs de jute avec du gros sel, à la fenêtre, pour les laisser dégorger. Mais il fallait beaucoup attendre avant de les consommer. A la fin de l’été, les olives fraîchement cueillies arrivaient par sacs entiers, tellement belles, brillantes ou pruinées, avec leur dégradé de couleurs, vert, rosé clair, violet, noir violacé ou noir mais tellement amères. Chacun s’évertuait pour aider grand’mère à casser délicatement les olives vertes, sans écraser la pulpe ni entamer le noyau, avec les manches des pilons de cuivre, avant de les mettre à la saumure dans de grandes jarres de grès. Les olives noires, les plus mûres et les plus chargées en huile, étaient suspendues dans des sacs de jute avec du gros sel, à la fenêtre, pour les laisser dégorger. Mais il fallait beaucoup attendre avant de les consommer.
Nous nous régalions des confitures d’abricots, si parfumés jadis, parsemées de quelques amandes amères que l’on retirait des noyaux et des juteuses oranges à grosse  peau, coupées en deux et confites, spécialement préparées pour la semaine de Pâque. Et quels parfums se dégageaient alors des grandes bassines à confitures en cuivre ! peau, coupées en deux et confites, spécialement préparées pour la semaine de Pâque. Et quels parfums se dégageaient alors des grandes bassines à confitures en cuivre !
Des bocaux de conserves et confitures pour l’hiver s’accumulaient dans tous les placards : tomates et poivrons séchés à l’huile, têtes d’artichauts, citrons, « variantes » au vinaigre, concombres colorés à la betterave crue et même de petits piments très piquants rouges dans des bouteilles de bière à capsules de porcelaine, d’où il n’était pas facile de les extirper.
Je regardais, fascinée, ma grand’mère éplucher, nettoyer et débiter les oignons, les légumes, les fruits, en quartiers, en tranches ou en dés, à une vitesse prodigieuse, avec des gestes de prestidigitateur. Le corps était presque impotent mais les mains et les doigts d’une dextérité et d’une agilité surprenantes.
Ma grand’mère, cardiaque, très myope, usée et alourdie par 9 ou 11 maternités et les épreuves, passait l’essentiel de son temps dans son étroite cuisine ou dans la salle à manger, sur sa chaise basse paillée où elle lisait ou s’endormait. Elle ne sortait pratiquement plus et si elle devait sortir, on descendait du 4ème étage une chaise sur laquelle elle s’asseyait pour reprendre son souffle à chaque palier, en remontant.
Elle s’activait toute la matinée à la cuisine, et elle y retournait pour préparer le repas du soir.
•
Le four banal
Constantine. Années 1940...
 Pendant la guerre, on ne délivrait de pain dans les boulangeries que contre des tickets de rationnement. Aussi, nous mangions, tous les jours, du “pain de maison” longuement pétri dans la grande “kesra” en bois d’olivier, confectionné avec de la semoule fine et non de la farine et un levain que grand'mère préparait elle-même en laissant fermenter un morceau de pâte très molle prélevé d’un pétrissage précédent. Pendant la guerre, on ne délivrait de pain dans les boulangeries que contre des tickets de rationnement. Aussi, nous mangions, tous les jours, du “pain de maison” longuement pétri dans la grande “kesra” en bois d’olivier, confectionné avec de la semoule fine et non de la farine et un levain que grand'mère préparait elle-même en laissant fermenter un morceau de pâte très molle prélevé d’un pétrissage précédent.
Le pain du Vendredi soir et Samedi, du shabbat, était badigeonné au jaune d'œuf pour lui donner un air de fête.
Les pains, les gâteaux, les gratins étaient cuits au four banal tenu par un Arabe au coin de la rue Thiers très pentue, en haut d'une série d'escaliers, en sous-sol, face à la grande synagogue de Sidi Fredj, le grand rabbin du département de Constantine.
Au-dessus du four, un bordel public fréquenté par des fantassins du troisième zouave qui faisaient le pied de grue, en face, attendant leur tour, sur le signal, à travers une petite lucarne, d’une portière maquerelle.
Rencontre improbable, sur le même trottoir, des fidèles de la « Maison de Dieu » et de ceux de la « maison de tolérance ». Mais « les desseins de la Providence sont impénétrables! »
Au four donc, on apportait de longs plateaux de tôle noire chargés de pains ou de gâteaux, le plus souvent sur la tête, des gratins aussi et je me rebiffais contre cette corvée.
Les veilles de fêtes et de Shabbat, des théories d'enfants souvent très modestes, attendaient leur tour, leur plateau sur la tête, résignés.
Parfois, des femmes, savates aux pieds, arrivaient au four en continuant à battre à la fourchette ou au fouet leur biscuit de Savoie pour empêcher la pâte de retomber.
Au four banal, en contrebas de la rue, l'homme, un Arabe plutôt jeune, glabre, à l'allure nonchalante, à l'air un peu hautain ou détaché, forme que prend parfois la patience, pieds nus sur de grandes nattes de crin qu'il nous était interdit de fouler, alimentait le feu avec des fagots de lentisque odorant. On entendait ronfler le brasier dans le four quand il ouvrait la lucarne. Il maniait en expert une pelle en bois d'olivier plate avec un très long manche. Il enfournait ou déplaçait sans cesse, sur la sole du four, plus ou moins près du foyer, les pains et plateaux de petits gâteaux pour une cuisson parfaite. Il les déposait ensuite, toujours avec sa pelle, en les faisant glisser par petites secousses horizontales, brûlants, dorés à point, directement sur les nattes pour les laisser refroidir. Le fournier ne se trompait jamais sur les propriétaires de tout ce qu'on lui confiait à cuire.
Il y avait des pains de toutes les formes mais pas de pains tressés, cette coutume de la halah tressée pour le shabbat ne semble pas être parvenue jusqu’à nous à Constantine, à cette époque-là. Assurément, nous ignorions que Dieu avait paré de tresses la chevelure d’Eve avant de la présenter à Adam.
Certaines familles marquaient les pains de leur sceau : des incisions sur la pâte, des trous de fourchette, des empreintes de doigts, des dessins linéaires, des fleurs, des étoiles de pâte sculptée, des graines de sésame, d’anis ou de pavot. Grand’mère faisait pour nous de petits pains en forme de poissons et souvent de petits pains ronds au chocolat ou aux noix.
Au retour du four, on transportait le pain cuit dans des serviettes attachées aux quatre coins. Les plateaux, empruntés au four, avaient été restitués.
L'odeur mêlée de bois brûlé, de pain chaud à l'anis et de pâtisseries parfumées nous raccompagnait jusqu’à la maison.
Nous remontions, chargés, les quatre étages bruyamment, en léchant parfois le chocolat fondu qui avait coulé à la surface de nos petits pains. Grand’mère, qui guettait, nous attendait en haut des escaliers, impatiente.
4 - Paul : notre enfance

• • •
Mon oncle Paul, le plus jeune frère de ma mère, mon aîné de 5 ans, nous a toujours considérées, Josiane et moi, comme ses petites sœurs. Dans ces années de guerre, nous avons vécu sous le même toit, et beaucoup partagé de notre enfance, chez mes grands-parents, à Constantine.
Il était un garnement joueur, farceur, frondeur, indiscipliné, « petit dernier », chouchouté par sa mère, mais rieur, affectueux et généreux. Il usait ses culottes courtes et ses genoux sur une planche à roulettes de sa fabrication, une « carriole » avec laquelle il dévalait, en bas de l’immeuble, sous les arcades, le trottoir pentu de la rue Thiers. Je me souviens de ce costume à culottes courtes en flanelle moutarde, confectionné pour sa Bar-mitsva, qu’il s’est entêté à porter les jours suivants, sur sa planche, et, à son retour, des récriminations de Mireille, en période de pénurie où il nous fallait tout épargner.
Nous avions un cycle de jeux communs: tentative d’élevage de vers à soie dans des boîtes en carton garnies de feuilles de murier, d’araignées dont nous récupérions les poches  d’œufs pour les enfermer dans des boîtes d’où finissait par surgir une multitude de minuscules araignées dont nous ne savions plus quoi faire, culture de pois chiches, de lentilles, de haricots sur du coton mouillé qui ne dépassait pas le stade de la germination. Nous achetions à de jeunes arabes des chardonnerets pris à la glue ou au lance pierres qui, à notre grand désarroi, en cage, ne survivaient pas longtemps. Nous collectionnions, l’été, les noyaux d’abricots. Les osselets, quémandés chez le boucher, bouillis et séchés, étaient teints au safran, à la pelure d’oignon ou peints avec le rose à ongles de Mireille, à son insu. Nous étions émerveillées des moirures et bigarrures de ses précieuses billes agates. Avec le petit os en Y, dégagé du bréchet de poulet, nous jouions à table à «Yadès » « j’y pense ». Une fois l’enjeu fixé, le plus souvent une bille ou une petite corvée domestique, Il ne fallait pas, par distraction, se laisser surprendre et, en l’absence de vainqueur, le jeu se poursuivait parfois jusqu’au lendemain. d’œufs pour les enfermer dans des boîtes d’où finissait par surgir une multitude de minuscules araignées dont nous ne savions plus quoi faire, culture de pois chiches, de lentilles, de haricots sur du coton mouillé qui ne dépassait pas le stade de la germination. Nous achetions à de jeunes arabes des chardonnerets pris à la glue ou au lance pierres qui, à notre grand désarroi, en cage, ne survivaient pas longtemps. Nous collectionnions, l’été, les noyaux d’abricots. Les osselets, quémandés chez le boucher, bouillis et séchés, étaient teints au safran, à la pelure d’oignon ou peints avec le rose à ongles de Mireille, à son insu. Nous étions émerveillées des moirures et bigarrures de ses précieuses billes agates. Avec le petit os en Y, dégagé du bréchet de poulet, nous jouions à table à «Yadès » « j’y pense ». Une fois l’enjeu fixé, le plus souvent une bille ou une petite corvée domestique, Il ne fallait pas, par distraction, se laisser surprendre et, en l’absence de vainqueur, le jeu se poursuivait parfois jusqu’au lendemain.
 Un de ses jeux préférés qu’on pouvait voir pratiquer aussi dans les rues et les cours d’école : le « sou follet », variante du plumfoot, sport traditionnel chinois mais sans règles. Un de ses jeux préférés qu’on pouvait voir pratiquer aussi dans les rues et les cours d’école : le « sou follet », variante du plumfoot, sport traditionnel chinois mais sans règles.
Son « sou follet » dit « s’follet » était un sou de 25 centimes, troué, dans lequel il introduisait du papier découpé en fines lanières pour lui donner des ailes, un « volant » avec lequel il jonglait de la tête, des pieds et des genoux.

 Il aimait aussi nous taquiner. Il chantait, en tapant lourdement des pieds, d’une voix caverneuse : « Boum ba ! Boum ba ! Watcha ! Watcha ! … » Cris de Sioux emplumés avant la mise à mort, entendus au Nunez, dans le quartier arabe, le cinéma des westerns et des films de cape et d’épée, fréquenté surtout l’après-midi, par des gamins chahuteurs, qui essayaient de se faufiler sans payer. J’y ai vu, avec Paul, Laurel et Hardy, Bud Abbott et Lou Costello dans des films comiques américains insipides, au milieu des claquements de fauteuils, des cris et des sifflets d’une nuée de yaouleds déchaînés. Il aimait aussi nous taquiner. Il chantait, en tapant lourdement des pieds, d’une voix caverneuse : « Boum ba ! Boum ba ! Watcha ! Watcha ! … » Cris de Sioux emplumés avant la mise à mort, entendus au Nunez, dans le quartier arabe, le cinéma des westerns et des films de cape et d’épée, fréquenté surtout l’après-midi, par des gamins chahuteurs, qui essayaient de se faufiler sans payer. J’y ai vu, avec Paul, Laurel et Hardy, Bud Abbott et Lou Costello dans des films comiques américains insipides, au milieu des claquements de fauteuils, des cris et des sifflets d’une nuée de yaouleds déchaînés.
 Paul endossait, surtout l’hiver, quand la nuit tombait tôt, un grand burnous noir à large capuchon de grand-père, rabattu sur le nez, et allumait une lampe de poche sous son visage. Il surgissait ainsi comme un diable, bras écartés, brusquement de n’importe quel coin noir de la maison. Frankenstein, Loup garou, momie géante, sauvages anthropophages, Dracula, tout y passait. Il nous terrorisait. Paul endossait, surtout l’hiver, quand la nuit tombait tôt, un grand burnous noir à large capuchon de grand-père, rabattu sur le nez, et allumait une lampe de poche sous son visage. Il surgissait ainsi comme un diable, bras écartés, brusquement de n’importe quel coin noir de la maison. Frankenstein, Loup garou, momie géante, sauvages anthropophages, Dracula, tout y passait. Il nous terrorisait.
Tarzan était son jeu de rôle favori. En s’essayant au cri fameux de Johnny Weissmuller, après avoir gonflé ses biceps, il sautait du haut d’une grosse armoire, avec une liane imaginaire, directement sur un des lits en cuivre et fer forgé laqué blanc alignés dans la chambre des enfants. Les sommiers à ressorts métalliques s’écrasaient jusqu’au sol, sous le choc. Il nous invitait à le suivre dans ses exploits, mais nous nous contentions de sauter de la cheminée.
Ce n’était pas notre seul jeu à risque, Notre domaine était, au 5ème étage, la terrasse et le toit de l’immeuble qui surplombaient l’étroite rue Thiers et les gorges du Rhumel. J’ai longuement raconté cette terrasse et nos jeux.
 Paul était intarissable sur les gaffes du, selon les cas, facétieux ou « idiot du village » Jeha qui, pour gratter son oreille gauche, faisait tout le tour de sa tête avec sa main droite, qui croyait ou feignait avoir appris à lire à son âne, à penser à un dindon, qui sciait la branche sur laquelle il était assis, mais qui, malin et rusé, avec un clou, réussissait à récupérer, à moitié prix, sa maison qu’il avait vendue et, comble de l’irrévérence, mentait même à Dieu. Ces contes oraux transmis de génération en génération, fonds commun de morale avec les fabliaux, les fables de Pilpay, d’Esope, de Phèdre, de La Fontaine etc… édifient, même les enfants, sur tous les travers humains. Nous nous traitions souvent entre nous de « Jeha » quand nous voulions nous moquer d’une maladresse ou d’une balourdise. Paul était intarissable sur les gaffes du, selon les cas, facétieux ou « idiot du village » Jeha qui, pour gratter son oreille gauche, faisait tout le tour de sa tête avec sa main droite, qui croyait ou feignait avoir appris à lire à son âne, à penser à un dindon, qui sciait la branche sur laquelle il était assis, mais qui, malin et rusé, avec un clou, réussissait à récupérer, à moitié prix, sa maison qu’il avait vendue et, comble de l’irrévérence, mentait même à Dieu. Ces contes oraux transmis de génération en génération, fonds commun de morale avec les fabliaux, les fables de Pilpay, d’Esope, de Phèdre, de La Fontaine etc… édifient, même les enfants, sur tous les travers humains. Nous nous traitions souvent entre nous de « Jeha » quand nous voulions nous moquer d’une maladresse ou d’une balourdise.
Parfois, enfants, nous nous sommes « crêpé le chignon », au sens propre, mais le combat était inégal parce que j’avais les cheveux longs et souvent des nattes et aucune prise sur les siens, coupés ras très courts.
Le régime pétainiste de Vichy nous avait jetés hors l’Ecole Publique, Paul, Josiane et moi, et nous avions tout le loisir de faire des bêtises, au grand dam de grand’mère qui usait facilement de l’injure en arabe et de Mireille, un peu injuste, et nous en profitions, qui donnait toujours tort à Paul puisqu’il était notre aîné.
Plus tard, dans les années 1950, nous étions si heureux de nous retrouver !
Quand nous arrivions de Tlemcen où nous étions pensionnaires Josiane et moi pour passer à Constantine des vacances scolaires, Paul nous promenait, nous
présentait à ses amis, nous gâtait. Dans sa Peugeot 203, puis sa Citroën 11, nous allions à Collo à 110 km de Constantine. Le site était encore sauvage, et la crique que nous avions découverte, entourée de rochers mordorés, de chênes lièges verts, de tamaris, de lentisques et de genêts, paradisiaque. Le sable blond et chaud, l’eau couleur d’émeraude, limpide et douce, l’air tiède et lourd de parfums sauvages. Le soleil de midi léger sur les têtes mouillées. Et le chant des cigales.
Nous gardions sur notre peau de soleil, au goût de sel, cette odeur fruitée si particulière d’eau de mer, de sable éclaté, de poussière de sel, de mousse et de coquillages, que je ne retrouve plus aujourd’hui en Méditerranée.
Nous nagions, pêchions des oursins, ramassions des coquillages.
A Bône, à 156 km, nous allions aussi prendre des bains à Toche et danser à Bugeaud. A Philippeville, à 85km, nous fréquentions la plage animée de Rusicade, avec ses bohémiens qui se produisaient sur les trottoirs, chantaient au son des guitares et accordéons et ses vendeurs ambulants de petites pêches kabyles, cacahouètes, « bliblis »sucrés tricolores, glaces, sorbets au citron, menthe verte et limonade glacées.
Lors d’un réveillon fêté avec ses amies, nous avions fait beaucoup de route d’une plage à l’autre, essayé des bains la nuit, mangé des moules et des crevettes au petit matin et pas dormi pendant 36 heures ! Au retour, Paul conduisait toujours. Lucette Ténoudji, notre amie trop tôt disparue, notre ange gardien, l’empêchait de s’endormir au volant, en parlant sans arrêt et en l’obligeant à mâcher du chewing gum.

Pendant son idylle avec Evelyne, mon amie de pension, Paul venait régulièrement à Alger où nous faisions des études supérieures. Alger est à 437km de Constantine ! Avec Evelyne et un copain de Paul, dandy à l’élégante nonchalance, devenu peu après, émigré en Israël, pionnier et soldat en kaki et pataugas, nous avons dansé à l’Aletti.
Deux ou trois fois, Paul est venu de Constantine à Alger conduit par un prétendant maigrichon que j’avais surnommé « Mignon ». Mignon ne s’est pas assez vite découragé parce qu’il avait une grosse décapotable ! Il devait être amoureux, genre transi, pour avoir dit à Paul, et surtout rien à moi : « Qu’elle m’épouse ! Et après, elle pourra faire ce qu’elle veut ! ». Entendre : les études qu’elle veut, bien sûr ! Les choses ne se passaient pas comme aujourd’hui ! On épousait d’abord !
Ma mère l’aurait presque regardé d’un œil favorable ! Une marchandise ?
Quelle horreur ! Je me sentais humiliée des prétentions de cet avorton à la taille exiguë … Méchante, orgueilleuse jeunesse vraiment ! Les yeux du refus, du rejet sont injustes et cruels, mentent et déforment tout, autant que les yeux aveugles de l’amour dans l’autre sens. Une « cristallisation » à l’envers ! Et justement, l’uniforme de ... qui finissait son service militaire à Alger commençait déjà à exercer, même de loin, tout son prestige sur ma cervelle de 18 ans !


La plage et le casino de Rusicade
Sur cette plage nous avons une nuit dormi sur le sable sous les pilotis, par faute de chambre d’hôtel, en toute liberté et en toute sécurité !
Odeur du bois rongé par le sel, suintant d’humidité. Ecume des vagues roulée jusqu’à nos pieds et éclatée sur le sable. Bruit incessant du froissement de la mer toujours recommencée. Court instant où le ciel perd son soleil, où le jour bascule dans la nuit et le silence, étoiles dans le ciel immense et pur, vidé de la touffeur blanche du jour. Froid pénétrant du petit matin. Puis clarté blanche de l’aube, l’aurore et l’immense bonheur du premier bain au soleil!
L’innocence de l’Eden et la nature en fastueux cadeau !
Paul et la religion
Paul fait partie de ces juifs religieux « un peu mais pas trop ».
Bien peu pharisien, il ne s’embarrasse jamais des détails contraignants dans la pratique religieuse du judaïsme. Quand, au cimetière, il n’y a pas le « ménien », les dix officiants mâles nécessaires pour réciter les prières rituelles, Paul compte aussi les femmes, les enfants et au besoin, les arbres, les oiseaux !
Mais il continue à téléphoner d’Israël tous les Vendredi pour nous souhaiter Shabbat Chalom et avant chaque fête religieuse de crainte que j’oublie la célébration. Il est l’œil de ma conscience religieuse !
Sa nostalgie de la France est aussi d’un gourmet qui passe outre les interdits : ah ! le sandwich jambon beurre ! l’huitre arrosée d’un Gewurztraminer! Le roquefort accompagné de confiture d’abricot !
Paul a toujours été impulsif et impatient, taquin et effronté comme le garnement impertinent très gâté qu’il fut.
J’ai déjà raconté comment il s’est comporté avec grand-père qui se croyait mourant. Mais il y a aussi la « scène des visions » et celle « des bananes ».
Un jour, au tout début des années 1950, en Israël, au volant de sa Peugeot 203, sur des routes à peine praticables, mal signalées, empierrées, ensablées, sous un soleil torride, il accompagnait grand-père pour un pèlerinage, entre Tibériade et Safed, sur le tombeau d’un Sage, Isaac Louria* (1534-1572) rabbin et kabbaliste, considéré comme le penseur le plus profond de la mystique juive. A l’arrêt, il s’éloigna. A grand-père qui s’étonnait de son absence prolongée, Paul répondit qu’il s’était absorbé dans une vision miraculeuse : le tsimsoum**, les « sefirot » : les vases brisés de la lumière divine, Illuminations, 7ème ciel, char en feu... Toute la lyre quoi !
Grand-père haussa les épaules. Alors Paul, pointant du doigt le tombeau, lui dit : « Alors, lui, tu le crois quand il raconte tout ça, tu me fais venir jusqu’ici avec cette chaleur et moi tu ne me crois pas ! »

« Les Séfirot » : les vases brisés de la lumière divine
|
|
* Isaac Louria, mort à 38 ans d’une épidémie qui frappa la région de Safed, est l’auteur du « Livre des Visions » « Sefer ha Hetionot » rédigé par un de ses disciples d’après son enseignement. Comme Socrate et Platon !
** « tsimsoum »du « en sof » : « contraction de l’infini » en hébreu, dans la kabbale, le processus primordial qui est à l’origine des mondes.
Paul et grand-père
Grand-père mourut inopinément le
soir du 6 Mars 1984. Il fut très rapidement enterré dès
le lendemain matin. Dans la précipitation, Paul, par suite d’un
malentendu avec le reste de la famille sur le lieu de réunion et l’heure
des obsèques, se retrouva un moment seul devant le corps de
grand-père
au funérarium.
Désemparé, impressionné par le silence, il s’adressa à son
père : « Tu sais, papa, si je récite pour
toi des psaumes que je connais mal, je vais le faire de travers, tu ne vas
rien comprendre, et tu ne seras pas content.
Et, en pleurant, il se mit à fredonner des airs d’opéra
que grand-père aimait chanter… Opéras auxquels il avait
assisté, jadis, avec grand’mère au magnifique théâtre
de Constantine : La Tosca de Puccini, Carmen : « toréador »… Madame
Butterfly : « je t’ai donné mon cœur ». … « Les grands
yeux noirs » …
Ensuite, Paul exigea du marbrier qu’il coule une chape en ciment sous
la dalle de marbre pour éviter l’affaissement. L’ouvrage
achevé, il vint voir la tombe et, s’adressant à grand-père, dit : « Tu
vois ? Comme ça, tu ne pourras plus venir m’embêter ! ».
Son humour noir, ses provocations effrontées, son insolence sont,
en réalité, un exutoire à sa sensibilité, à sa
souffrance, à son profond chagrin.
Maintenant, il ne va plus au cimetière : « A quoi ça
sert ? Il n’y est plus l » dit-il, en levant les yeux
et en pointant son doigt vers le ciel.
• Yolande  Yolande est née à Constantine le 1er Mai 1919. 4ème
enfant de la famille de mes grands-parents Melki. Sa naissance a libéré son
père, réserviste à Biskra, du service des armées. Yolande est née à Constantine le 1er Mai 1919. 4ème
enfant de la famille de mes grands-parents Melki. Sa naissance a libéré son
père, réserviste à Biskra, du service des armées.
En 1940, Yolande était déjà fiancée. Elle rendait
visite à ses parents à Constantine quand elle revenait de Biskra,
son premier poste d’institutrice, après le baccalauréat
et l’école d’institutrices. Elle y était hébergée
par la plus jeune sœur de ma grand’mère, Augustine dite
Loueino, l’épouse d’un propriétaire de palmeraies à Biskra,
Touitou.
Yolande était si vive, si jolie, si fine, si rieuse, elle sentait
si bon Heure Bleue de Guerlain ou Fleur de Rocaille de Caron, dans sa veste
en mouton doré, si agréable au toucher !
Avec sa veste qui conservait le froid humide de l’extérieur,
l’hiver, une bouffée d’air frais et parfumé pénétrait
dans la salle à manger chaude et un peu enfumée par le feu
de bois.
Avec son teint de lait et ses grands yeux noirs, elle ressemblait à la
Blanche Neige de mon livre de Contes et je ne comprenais pas pourquoi elle
avait choisi Armand de la même façon que je ne comprenais pas
pourquoi Ginger Rogers dansait amoureusement avec Fred Astaire. Je les trouvais
laids tous les deux ! Mais en 1940-41, j’étais encore bien
petite !
Armand était étudiant en Droit à Alger, et ce statut
lui conférait un prestige certain.
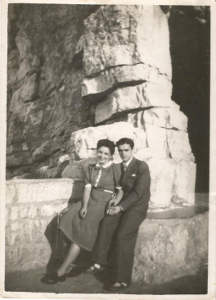
Yolande et Armand route de la Corniche
|

Josiane et Claude |
Le mariage eut lieu en pleine guerre le 21 Décembre 1941. Pas de
taxis ! Le cortège s’est rendu en calèche (écolo-rétro à la
mode aujourd’hui) à la synagogue de la place Négrier,
dite « le temple algérois », puis dans la grande
maison mauresque de la grand’mère Attali pour les réjouissances.
Pas de photos non plus ! Pas même de la mariée ! Seulement
une toute petite photo de Josiane et moi, filles d’honneur en tulle
enrubannées, debout sur la banquette du piano chez mes grands-parents
avec le portrait de Yolande, sur le piano, en double exemplaire.et une corbeille
de fleurs.
Le jeune couple passa ensuite quelques jours chez Josiane et Claude
mes parents à Oran, puis à l’hôtel à Alger,
en voyage de noces.
Mais en Octobre 1941, deux mois avant son mariage, Yolande, institutrice, avait été exclue
de la Fonction Publique par le « Statut des Juifs » du
régime de Vichy et Armand avocat, profession libérale, privé de
son emploi. Ils donnèrent des cours, Armand travailla un peu chez un confrère
en attendant des jours meilleurs. Temps difficiles !
Quand, une fois mariée, Yolande habita chez ses beaux- parents Sarbib,
51 rue Nationale, une chambre aménagée avec satin et volants roses
d’où on pouvait observer sur les toits des maisons arabes, en face,
des cigogneaux sur leur fagot et entendre le caquètement des cigognes
et cinq fois par jour l’appel à la prière du muezzin du haut
de son minaret, je l’ai souvent vue en larmes, quand elle rendait visite à mes
grands-parents.

Calèches au départ du Pont de Sidi M’cid Constantine.
(Vers 1960)
Yolande : deux tragédies mais l’amour
de la vie.
La mort d’Adeline, la sœur d’Armand, terrassée
par une crise cardiaque à 35 ans, sur une plage de Philippeville (aujourd’hui
Skikda) le 8 Juillet 1951 fut une épreuve tragique.
Pour une journée à la plage, à 85 km de Constantine,
4 adultes et 4 très jeunes enfants s’étaient entassés
dans la 4 C.V. d’Armand.
Au retour, dans l’auto, devant, Jules Atlani, le mari d’Adeline
et Armand qui conduisait, et derrière, Yolande qui tenait le corps
raidi d’Adeline. Les enfants, Jean-Lou, Geneviève, et les deux
petits de 2 et 3 ans Yves et Gérard, désormais orphelins de
mère avaient été confiés, pour le retour, à d’autres
membres de la famille.
Adeline avait de fréquents malaises,- je l’ai vue un jour défaillante,
appuyée contre une cheminée-. Elle avait attendu le retour
de Jules A., longtemps prisonnier de guerre pour se marier. Elle avait attendu
aussi pour avoir des enfants. Aujourd’hui, soignée, Adeline
aurait survécu.
Sa mère est morte à plus de 100 ans à Epinal. A son décès,
sous son oreiller, un livre de prières en hébreu et un couteau.
Dans le malheur, la superstition est parfois un recours, le sentiment que l’on
peut se prémunir ou agir contre tout.

Jean-Lou et Geneviève
|
Yolande, qui a eu deux enfants brillants,
Jean-Lou, qui vit en Amérique, et Geneviève, avocate à Paris,
a connu une autre tragédie. Elle perdit son premier bébé,
pendant la guerre, quand les chirurgiens gynécologues juifs étaient
interdits d’exercice par les mêmes lois infâmes qui
l’avaient déjà privée de son travail. Un
chirurgien militaire « aryen », boucher incompétent,
pratiqua une césarienne qui la laissa horriblement mutilée,
entre la vie et la mort, plusieurs semaines. Dans sa chambre d’hôpital,
grand-père priait devant la fenêtre, en regardant le ciel.
Pendant 8 longs mois, elle resta à la clinique Gozlan 51 rue
Nationale dont les médecins juifs étaient interdits
de pratique.
Elle garde de cette intervention criminelle, suivie par
la perte d’un autre bébé un corps meurtri et
une blessure que seul son amour de la vie a peut-être cicatrisée.
|
Yolande, curieuse de tout, s’intéresse à la politique, à l’art,
lit beaucoup. Restée très proche de sa famille, elle est d’un
exceptionnel dévouement.
Jeune adolescente, à Constantine, je la suivais sur tous les marchés,
je m’enfonçais avec elle, à peine méfiante, dans
les ruelles du quartier arabe. Elle savait reconnaître un beau fruit
mûr et pas suret, une courgette sans son duvet, amère, une prune
ou un raisin sans leur pruine, moins frais, des melons et pastèques
gorgés de suc, un poisson à éviter, l’œil
terne et l’écaille affaissée. Elle savait où trouver
le marchand arabe qui vendait les pêches de vigne les plus juteuses et
parfumées et celui qui fabriquait le petit lait le plus doux et le plus
onctueux, le boucher arabe qui vendait vraiment de l’agneau de lait,
et tant pis pour la cacherout ! J’en ai gardé toute ma vie
l’amour des marchés et de la beauté de leurs étals.
 J’étais plutôt maigre et pas très gourmande mais
j’adorais le beurre et elle me mettait sans cesse en garde, aussi, contre
la mauvaise graisse accumulée des femmes. J’étais plutôt maigre et pas très gourmande mais
j’adorais le beurre et elle me mettait sans cesse en garde, aussi, contre
la mauvaise graisse accumulée des femmes.
Elle aimait créer, des tapis, des jouets (Ah ! cette Bécassine
en tissu et tricot réalisée pour Noémie et qui trône
aujourd’hui, bien toilettée dans la chambre de son arrière-petite-fille
Lucie !), des travaux d’aiguilles méticuleux et raffinés.
Merveilleux châles crochetés pour Sarah et Clara, mes deux premières
petites filles !
 Avec sa jolie main blanche aux longs doigts effilés, elle sculptait
avec délicatesse, en la pinçant, la pâte des corbeilles
aux amandes (knedlettes) ou celle des petites galettes salées constantinoises
trouées à la main, et non avec une roulette à trous. Je
reconnaissais, entre toutes, ses pâtisseries à leur finesse et
régularité. Avec sa jolie main blanche aux longs doigts effilés, elle sculptait
avec délicatesse, en la pinçant, la pâte des corbeilles
aux amandes (knedlettes) ou celle des petites galettes salées constantinoises
trouées à la main, et non avec une roulette à trous. Je
reconnaissais, entre toutes, ses pâtisseries à leur finesse et
régularité.
Dévouée à sa famille, elle l’était aussi à « ses petits » de
l’Ecole Maternelle dont elle était Directrice, à Epinal.
Honorée des Palmes Académiques, elle les a quittés, avec
regret et des larmes en 1979.
Yolande aime partager les joies. Elle est d’une nature généreuse,
capable d’enthousiasme. Elle éclate alors facilement d’un
bon rire franc.
Armand et elle sillonnaient les routes de France en auto, découvrant,
admirant. Toujours prête pour la fête, à 80 ans, elle m’a
entraînée une semaine en Israël en 1999 pour assister à la
Bar Mitsva d’Ami- Haï le petit-fils de sa sœur Mireille alors
qu’Armand, vieilli, était resté à Aix-En Provence.
Je suis heureuse de la savoir aujourd’hui, en 2012, arrière-grand-mère
d’une petite Clara, prénom de sa mère et donc de ma grand’mère
Melki. Mais aussi d’une de mes petites filles. La chaîne n’est
pas rompue !
Elle est rattrapée doucement par l’âge et la maladie, mais
elle a su garder, au téléphone, son enthousiasme et sa voix claire
et jeune pour dire merci au travail de mémoire que je fais ; « Merci !
Merci ! Merci ! Ma fille chérie ! »
5 - La terrasse et nos jeux
• • •
Le printemps
•
La grande lessive
Constantine, années 40.  La terrasse au-dessus de l'appartement de mes grands-parents n'occupait qu'une partie du 5e étage. Deux appartements se partageaient le reste: celui de la famille S… et celui des Gh.. La terrasse au-dessus de l'appartement de mes grands-parents n'occupait qu'une partie du 5e étage. Deux appartements se partageaient le reste: celui de la famille S… et celui des Gh..
La terrasse était un extraordinaire belvédère d'où l'on dominait les gorges du Rhumel. A gauche, le "Pont Suspendu" au-dessus de l'abîme.
La terrasse comprenait une buanderie avec un double bassin en ciment, une énorme lessiveuse en zinc galvanisé sur trépied et un âtre. Elle servait aux grandes lessives.
Nous, enfants, l'avions monopolisée. Nos jeux y suivaient le rythme des saisons.
La grande lessive de mes grands-parents nous en chassait à peine quelques heures toutes les semaines. Une "laveuse", une femme arabo-berbère à la peau tannée et profondément ridée, décharnée mais aux bras robustes couverts de tatouages comme son visage, les yeux cernés de "khol", la bouche teintée de" souak », l'écorce du noyer, venait un ou deux jours pour "mettre au savon", frotter, faire bouillir sur un grand feu de bois dans la lessiveuse, puis rincer et étendre le linge. La veille, ma petite tante Mireille triait puis mettait à tremper séparément tout le linge sale. Les immenses mouchoirs de grand- père blancs rayés de violet comme ceux des Arabes- à qui il les vendait probablement- trempaient à part, à cause du tabac à priser.
Les enfants se disputaient pour apporter à la “laveuse”, à dix heures, des œufs frits au plat avec des oignons verts crus, à midi, un repas, des boissons, du café au lait...Le travail était dur et grand'mère nourrissait bien cette femme courageuse qui, dès l'aurore, arrivait de loin, sur le plateau. Elle découvrait alors son visage dissimulé par le « aâjar »blanc, diaphane, bordé de guipure qui ne laissait apparaître que les yeux et deviner le reste. Elle ôtait son grand “haïk” noir, la « m’laya » des Constantinoises, ses babouches et ses bracelets joncs martelés. Elle portait comme toutes les campagnardes berbères une gandoura bariolée aux couleurs très vives et de larges et fines manches blanches attachées derrière. Elle relevait les pans de sa robe, resserrait son foulard de tête, un carré de tissus plié en deux selon la diagonale et disposé sur la tête, les deux pointes croisées sur la nuque puis ramenées et nouées au- dessus de la tête. Elle travaillait pieds nus. Ses talons rougis au henné étaient durs, calleux et crevassés d'avoir tant foulé la terre et les cailloux des chemins. Elle était toujours imprégnée d'une odeur de fumée de bois mêlée à des traces de musc, de violette ou d’œillet et de “smen” un peu rance: le beurre fondu salé.
 J'aimais suivre les mouvements de ses larges mains aux paumes rougies de “henné”. Elle frottait le linge d'une pulsion de tout son corps, sur une planche en bois d'olivier, usée, ondulée sur une face, qu'elle calait obliquement à demi immergée dans un baquet. J'aimais suivre les mouvements de ses larges mains aux paumes rougies de “henné”. Elle frottait le linge d'une pulsion de tout son corps, sur une planche en bois d'olivier, usée, ondulée sur une face, qu'elle calait obliquement à demi immergée dans un baquet.
Elle lavait le linge à peu près comme elle pétrissait la pâte : elle malaxait, tapait, pressait puis reprenant une brosse à chiendent, d'un geste énergique, elle débarrassait le linge bien savonné et largement étalé sur la planche de toute salissure récalcitrante. Des mèches de cheveux rouges, collés par la sueur, sortaient de son foulard bordé de franges noires.
Puis venait l'étape du « lessivage »sur un grand feu de bois. Le linge était bien disposé dans la lessiveuse autour du tuyau central creux se terminant par un champignon perforé. L'eau bouillante montait dans le tuyau et retombait en douche sur toute la surface du linge avant de remonter à nouveau.
Pour « l'azurage », lors du dernier rinçage, pour aviver l’éclat du linge, un petit bloc de poudre bleue dans une étamine se diluait doucement. Au fur et à mesure une belle auréole s'élargissait autour du bloc.
Mireille et cette femme essoraient les épais et lourds draps de lin, chacune à une extrémité, par un mouvement de torsion inversé.
C’était le moment le plus excitant pour nous et nous nous mettions à courir entre les draps mouillés étendus d’où l’eau dégouttait encore, quand il faisait très chaud.
Le soleil baissait quand la femme rangeait son billet dans son mouchoir noué qu'elle enfouissait dans sa poitrine, dans le repli du corsage « iciwi »qui gonfle au- dessus de la ceinture et qui servait de poche au même titre que le capuchon du burnous des hommes.
Un jour, cette femme fruste est arrivée, après une violente dispute avec son mari, un grand couteau de cuisine sous son haïk. Elle expliqua à ma grand'mère que si son mari se présentait, elle le tuerait. Ma grand'mère effrayée mais prudente et avisée, lui mit dans la main une pièce, en lui recommandant d'aller se cacher ailleurs et surtout de ne plus revenir... Une autre « laveuse" fut recrutée. Beaucoup plus jeune, elle arriva dès le lendemain, ses chaussures à la main et, sur la tête, une serviette tenue entre les dents.
J'aime toujours l'odeur du linge séché au soleil et j'ai conservé ma planche à laver ondulée d'Algérie, incrustée de moisissures, usée et fendillée d'avoir tant servi. A N…, dans l'Eure, j'y fais sécher des poivrons dans mon jardin quand, l'été, le climat normand le permet.
A Constantine, tout l'été, se succédaient sur le toit de la terrasse toutes sortes de planches sur lesquelles séchaient tomates et poivrons grillés, pelés et salés.
Nous adorions croquer dans la chair pulpeuse, savoureuse et veloutée des tomates, tiède de soleil et salée de gros sel, le premier jour de leur exposition avant qu'elles ne commencent à sécher, se flétrir et rabougrir.
Le problème était toujours de dissimuler notre larcin à grand'mère, en déplaçant les tomates sur les planches pour combler les trous.
Cette saveur perdue reste, avec celle des figues de Barbarie sur la route vers Sidi M'cid, parmi les petites « madeleines » de mon enfance.
Aujourd'hui je mesure le progrès accompli.
J'ai connu, enfant, les corvées de la grande lessive à la terrasse.
En 1957, à Nazare, j’ai vu les lavandières du Portugal avec leurs multiples jupons-7-sur le bord des rivières.
A Alger, les lavages dans la baignoire avec la lessiveuse en zinc qui encombrait la cuisine sur son réchaud-trépied alimenté au gaz (on devait pour cela débrancher le tuyau de la cuisinière à gaz).
Puis une « Lincoln », choisie au Salon des arts ménagers à Alger, semi-automatique, branchée au gaz, avec évacuation manuelle. Ma mère, excédée par la manœuvre, préférait laver le linge à la main !
Aujourd'hui, malgré la puce électronique d’une machine Miele, il m'arrive parfois de reproduire les gestes de cette femme dans mon évier.
Mais aucune machine à sécher ne remplacera jamais le soleil et l'odeur du linge séché sur la terrasse de mon enfance, à Constantine.
•
Le toit
 La terrasse était le rendez-vous de tous les enfants de l’immeuble. Nos jeux suivaient le cours des saisons. La terrasse était le rendez-vous de tous les enfants de l’immeuble. Nos jeux suivaient le cours des saisons.
Nous grimpions sur le toit de vieilles tuiles rouges à deux versants qui dominait le Rhumel.
Les plus fous d’entre nous et les plus inconscients s’amusaient même à défier le danger en se risquant sur le versant qui surplombait le vide. Josiane et Paul l’ont fait. Je criais, affolée, pour les faire revenir mais ils riaient et, aujourd’hui encore, Josiane prétend qu’elle s’accrochait à une cheminée. Ce versant et la cheminée sont bien visibles avec le Pont Suspendu au fond sur une photo de 1953 où mon cousin Guy enfant pose debout sur le toit.
Josiane et Paul sont, avec deux ou trois autres enfants dont nos voisins de palier italiens Antoine et Gilbert Bel Antonio, des miraculés.

Le 44 rue Thiers, sur une carte ancienne, tel que je l’ai connu. Au 1er plan à droite, l’immeuble avec sa terrasse. En dessous, des arcades, sous lesquelles nous entendions les enfants du talmud –thora. Le grand hangar blanc devant, qui appartenait au propriétaire de l’immeuble, Mr Zarka, abritait un cheval et sa carriole, et le gardien.
•
La planche à roulette de Paul dite carriole (ou carrico à Oran)
 Un jour, Paul, disposé à nous faire partager son jeu favori, très pratiqué aussi par les petits Arabes, apporta sur la terrasse une planche à roulettes de sa fabrication, grossière ébauche des planches actuelles, faite de bric et de broc, de bois de récupération, de ficelle et de fil de fer sur laquelle on avançait assis après une énergique impulsion des deux jambes ou poussé par un compagnon de jeu, en terrain plat. Un jour, Paul, disposé à nous faire partager son jeu favori, très pratiqué aussi par les petits Arabes, apporta sur la terrasse une planche à roulettes de sa fabrication, grossière ébauche des planches actuelles, faite de bric et de broc, de bois de récupération, de ficelle et de fil de fer sur laquelle on avançait assis après une énergique impulsion des deux jambes ou poussé par un compagnon de jeu, en terrain plat.
D’ordinaire, Paul dévalait le trottoir pentu de la rue Thiers sous les arcades, très peu fréquenté, et y usait ses chaussures pour le freinage, ses culottes et ses genoux.
Mais la rue était interdite aux petites filles de la maison. Ma sœur Josiane prétend avoir au moins une fois enfreint l’interdit mais elle était plus petite que moi et un peu « garçon manqué ». Paul arriva donc sur la terrasse, sa carriole sous le bras.
Ce jour- là, ma grand’mère qui travaillait dans la cuisine juste sous la terrasse, excédée par le vacarme de feraille assourdissant, sur les tomettes, des roulements à billes qui servaient de roues et des chocs sur les murs de la « carriole » dans ses trajectoires hasardeuses, nous cria d’en bas, dans l’escalier, toute sorte d’insultes en arabe qui lui étaient familières. Quand nous descendîmes, elle nous accueillit devant la porte, un par un, avec une grande tape dans le dos, poing fermé, mais volontairement amortie, en réitérant ses insultes. Les châtiments corporels n’étaient pas en usage dans notre famille et le nerf de bœuf suspendu dans le couloir, arme de dissuasion plus efficace que le petit martinet, était complètement désaffecté.
Donc l’expérience de la planche à roulettes sur la terrasse tourna court.
Grand’mère était une sorte d’anthologie vivante de la malédiction en arabe.
A la décharge de grand’mère, je dois dire qu’elle maîtrisait aussi tous les contrepoisons, antidotes et parapluies contre les influences maléfiques : le 5, le feu, le sel, les formules magiques en arabe etc…
Les injures et malédictions avaient aussi leurs contrepoids en arabe : l’arméra : mon âme, na bébèsse : je prends ton mal, kappara : je meurs pour toi, l’aziz ou l’aziza : chéri(e), mais je ne me souviens pas qu’elle ait utilisé souvent ces expressions en arabe. Le méritions-nous ? Ou préférait-elle le français plus sobre dans ces cas et surtout plus explicite pour nous ?
La colère fusait en salves de gutturales arabes, les autres sentiments devaient s’exprimer plutôt en français.
•
Le mouton de Pessah : Constantine 1941
Un agneau contre 3 mètres de tissu.
 Au Printemps 1941 ou 1942, sur cette terrasse, nous avons nourri, pendant deux mois, un agneau. Georges l’avait échangé contre 3 mètres de tissu chez un paysan arabe. Il l’avait, à vélo, transporté sur ses épaules, à la façon des bergers des santons des crèches de Provence. Puis, au milieu des cris d’excitation des enfants de l’immeuble, avec l’animal sidéré toujours sur ses épaules, il avait monté les 5 étages à pied jusqu’à la terrasse. Au Printemps 1941 ou 1942, sur cette terrasse, nous avons nourri, pendant deux mois, un agneau. Georges l’avait échangé contre 3 mètres de tissu chez un paysan arabe. Il l’avait, à vélo, transporté sur ses épaules, à la façon des bergers des santons des crèches de Provence. Puis, au milieu des cris d’excitation des enfants de l’immeuble, avec l’animal sidéré toujours sur ses épaules, il avait monté les 5 étages à pied jusqu’à la terrasse.
C’était la guerre et ses privations : pas d’essence, pas d’auto, et avec un «administrateur aryen » imposé au magasin de tissus de mon grand-père, si peu d’argent mais encore quelque tissu. Et Pessah à célébrer !
L’agneau courait vers nous, dès que nous ouvrions la porte de la terrasse, les bras chargés de fanes de carottes ou de poireaux et d’herbes souvent cueillies sur les pentes du Rhumel par Hocine ou Joseph.
Nous avions pris l’habitude de jouer avec cet agneau, de caresser sa toison touffue et bouclée, à la puissante odeur de suint, et oublié qu’il était destiné au sacrifice de Pâque.
Le jour où on l’a emmené, nous, enfants, étions tous désespérés. La veille du sacrifice, Joseph l’avait descendu de la terrasse et enfermé dans les WC de l’appartement.
Dans la cuisine, un boucher rituel, un « Shohet » : Rabbi Sion Ch… est venu le sacrifier. –J’ai trouvé, par hasard, la reproduction d’une photo où ce rabbi est décoré par un officiel.
Un kanoun avec de la cendre pour recueillir le sang et une grande cuvette étaient prêts. Nous, les enfants, avons fui au bout du couloir, refusé de toucher aux côtelettes et même de regarder l’os d’agneau du plateau du Seder pendant la lecture de la haggadah. Nous n’étions pas des Cannibales !
Selon l’usage, grand’mère dut tremper sa main dans le sang et l’appliquer sur la porte d’entrée pour y laisser l’empreinte. Cette pratique qui peut paraître barbare et primitive est un salmigondis d’héritage de rituels sacrificiels de la religion juive primitive avec le souvenir de la sortie d’Egypte et des linteaux des maisons marqués du sang des agneaux sacrifiés pour que Dieu épargne ces maisons, et que « l’ange de la mort » « passe au- dessus »( « Pass over »en anglais et aussi la racine hébraïque de « pessah ») sans s’arrêter –offrandes rituelles liées au sang versé – et de traditions culturelles plutôt islamiques : le 5 protecteur, la « main de Fatma », le « hamsa » arabo-judéo- berbère. En tout cas, pour nous, «cela portait bonheur » comme « portait bonheur » l’os du mouton du plateau du Seder que nous gardions toute l’année au-dessus d’une armoire. « C’est comme ça ! » tenait lieu d’explication.
La fête du dernier soir de Pessah, avec les crêpes épaisses au beurre et au miel confectionnées par grand’mère sur de grandes plaques bombées de tôle noire, accompagnées d’un délicieux « l’ben », le petit lait, les fleurs dites « gouttes de sang »qui couvraient la table avec de jeunes épis de blé, les fèves fraîches d’un vert très clair plantées bien verticales dans de la semoule avec des louis d’or, symboles dans tout le Maghreb de prospérité et de fécondité par l’abondance de leurs fleurs et le nombre de graines que contiennent leurs grosses gousses, cette fête donc nous réconciliait avec Pâque, son mouton, ses galettes indigestes et nous faisait presque oublier « notre » mouton .
A Constantine, le « pain azyme » était une galette très épaisse, très dure, et particulièrement indigeste. Une fois l’an, seulement, la Fabrique Zarka la produisait. Certaines familles, comme celle de la tante Eugénie dite « Zeiro », la sœur de ma grand’mère, la fabriquaient elles-mêmes.
On était obligé de piler cette galette très fine pour le café au lait qui prenait la consistance du ciment, plus grossièrement pour les potages et autres usages. Le pilon de cuivre était l’accessoire indispensable pour la galette de Pessah, et le pilage une corvée partagée. A table, on laissait la galette tremper dans l’eau, comme la « soupe » des paysans de jadis, qui, dans des maies en bois, conservaient leur pain toute l’année.
Pour le trempage, une grande coupe en faïence à grosses fleurs rouges qui faisait partie de la vaisselle réservée pour Pâque, pleine d’eau, était prévue à table. Une des fantaisies de Paul fut d’y prendre son café au lait du matin. Le jour où, après avoir bien tassé sa galette pilée, il remplit par erreur la coupe de petit lait au lieu de lait, avec le café, la mixture était si écœurante qu’il renonça définitivement même à la coupe à fleurs rouges.
Une année, j’étais très petite, cette galette béton m’a rendue si malade que mon grand-père, esprit ouvert et tolérant, a dit : « apportez lui du pain ! ».
A Oran, la galette était plus acceptable que celle de Constantine.
Après le débarquement des Américains, seulement, en Novembre 1942, nous avons découvert que la galette de Pessah pouvait être fine et comestible.
Aujourd’hui, le pain azyme « Rosinski frères » est presque une friandise et beaucoup en mangent toute l’année.
•
L'été
• Le matelassier
 Au printemps, sur la terrasse, deux ou trois jours au moins étaient réservés à la réfection des matelas de laine avachis et tachés. Les jeunes enfants adorent grimper sur les lits, faire sauts et cabrioles, culbutes et roulés boulés jusqu’à la lourde chute au sol. Paul avait mis au point un périlleux numéro de Tarzan. Il sautait, en poussant le cri fameux de Johnny Weissmuller, avec une liane imaginaire, du haut d’une grosse armoire sur laquelle il se hissait depuis la tablette en marbre de la cheminée, directement sur un des lits de la chambre des enfants. Sous le choc, le sommier métallique à ressorts s’écrasait en grinçant jusqu’au sol. Josiane et moi, peu fidèles Chitas nous contentions de sauter depuis la cheminée. Chez mes grands parents, matelas et sommiers étaient très malmenés. Au printemps, sur la terrasse, deux ou trois jours au moins étaient réservés à la réfection des matelas de laine avachis et tachés. Les jeunes enfants adorent grimper sur les lits, faire sauts et cabrioles, culbutes et roulés boulés jusqu’à la lourde chute au sol. Paul avait mis au point un périlleux numéro de Tarzan. Il sautait, en poussant le cri fameux de Johnny Weissmuller, avec une liane imaginaire, du haut d’une grosse armoire sur laquelle il se hissait depuis la tablette en marbre de la cheminée, directement sur un des lits de la chambre des enfants. Sous le choc, le sommier métallique à ressorts s’écrasait en grinçant jusqu’au sol. Josiane et moi, peu fidèles Chitas nous contentions de sauter depuis la cheminée. Chez mes grands parents, matelas et sommiers étaient très malmenés.
Le matelassier, un vieil artisan Juif, arrivait, parfois aidé de sa femme, avec sa cardeuse à main démontée et une mallette en bois, très tôt le matin.
Toute la matinée, dans la poussière et une légère persistante odeur de suint libérée par le cardage, assis sur l’arrière de la cardeuse, il introduisait d’une main la laine, de l’autre il actionnait le balancier en bois muni de gros clous, dans un mouvement régulier de va-et-vient pour aérer la laine tassée et jaunie des matelas éventrés. Il étalait ensuite les flocons de laine souple, mousseuse, soyeuse et débarrassée des impuretés sur un grand drap blanc déployé sur les tomettes rouges du sol.
L’après-midi, commençait la confection du nouveau matelas avec une toile neuve rayée, plus tard damassée bleue ou jaune et la laine cardée bien répartie sur la toile pour un matelas équilibré et moelleux. Après le remplissage, commençait le long et minutieux travail de couture. Avec deux longues aiguilles recourbées et du gros fil de coton, assis en tailleur à même le sol devenu très chaud, il cousait les bourrelets des bordures pour maintenir la laine sur les côtés. Puis, pour la maintenir à l’intérieur, le capitonnage : sur les œillets, de petits carrés d’étoffe repliée. Les capitons de tissus-une cinquantaine environ pour un grand matelas- étaient reliés par deux avec le fil à travers le matelas.
La vieille toile, lavée et repassée était souvent réutilisée ou servait de protection sur le matelas rénové, ou à isoler le matelas du sommier métallique à ressorts parfois un peu piqué de rouille.
Sous la chaleur, c’était de longues et dures journées pour cet artisan qui transpirait sous la casquette que, pour se conformer à la loi juive, il n’ôtait jamais. Grand’mère n’aimait pas nous voir tourner autour de lui dans la poussière de laine. Elle nous autorisait seulement à lui apporter son frugal repas. Il se nourrissait essentiellement, sobre comme les fellahs des terres arides, de pain à l’huile, d’oignons, d’olives et de quelques figues ou dattes, avec, à sa portée, sa petite gargoulette d’eau fraîche. Il consentait parfois à boire un peu de café, au lait le plus souvent. Aux heures les plus chaudes, au plein soleil de la terrasse, les  murs ne projetant plus aucune ombre, un grand mouchoir de Cholet aux larges rayures mauves, retenu sous sa casquette, protégeait sa nuque et une partie de son visage. murs ne projetant plus aucune ombre, un grand mouchoir de Cholet aux larges rayures mauves, retenu sous sa casquette, protégeait sa nuque et une partie de son visage.
En fin de journée, la fatigue s’inscrivait en larges cernes gris sur ses joues. Il descendait les matelas considérablement rehaussés, prêts pour le trampoline. Puis il démontait sa cardeuse et la rangeait dans un coin jusqu’au lendemain.
Longtemps, j’ai utilisé une très longue pièce d’un robuste tissu bleu damassé d’un ancien matelas. J’y ai renoncé quand elle a été hors d’usage pour un vrai molleton de protection acheté sous plastique qui recouvre désormais un matelas industriel en latex sur sommier à lattes dit « tapissier ».
Aujourd’hui, ces cardeuses en bois mues par la main de l’homme, avec leur curieuse planche balancier hérissée de gros clous sous laquelle passait la laine, ne se trouvent plus que chez les antiquaires, dans les écomusées ou comme l’alambic ou la sorbetière de ma grand’mère dans le musée de nos souvenirs d’enfant.
•
« Notre piscine » et Sidi M'Cid
 Un été, vers 1942, nous avons eu l'idée, vue la hauteur de la plinthe, de faire de la petite terrasse carrelée de tomettes rouges avec une grande plinthe de 40cm environ, une piscine, pour rivaliser avec Sidi M'Cid. Un été, vers 1942, nous avons eu l'idée, vue la hauteur de la plinthe, de faire de la petite terrasse carrelée de tomettes rouges avec une grande plinthe de 40cm environ, une piscine, pour rivaliser avec Sidi M'Cid.
Nous avons frotté le sol et les plinthes avec de l'alfa et le savon que, en période de pénurie, grand'mère nous avait concédé, ignorant l'usage que nous voulions en faire. Nous avons réussi, avec des seaux d’eau, à inonder la terrasse en pente légère vers l'évacuation sur 1 ou 2 cm de hauteur sans nous préoccuper des fuites et infiltrations possibles et, ravis du résultat, nous avons pataugé, glissé sur les fesses et rampé sur le ventre toute une après-midi.
Sidi M'Cid était un site d'une exceptionnelle beauté naturelle qu'il fallait mériter car nous nous y rendions surtout à pied,
 une
ribambelle d'enfants, sous un soleil de plomb. Nous longions la « route de la corniche » route en lacets creusée dans la roche, au-dessus de l'abîme, avec parfois des surplombs vertigineux. A ciel ouvert, percée d'une série de courts tunnels, elle offrait des points de vue magnifiques sur les gorges du Rhumel. En-dessous, accroché à la muraille rocheuse, le « chemin des touristes », étroite passerelle métallique de moins d'un mètre de large sur laquelle je ne me suis jamais risquée. Au fond du ravin, un filet d'eau glissait entre les roches détachées des flancs et grossissait parfois sous l'orage en torrent boueux. Ensuite, une dégringolade dans un sentier abrupt dans les fourrés de diss et taillis de lentisques, pour économiser le prix de l'ascenseur, creusé aussi dans la roche, qui descendait à 70m dans la falaise. une
ribambelle d'enfants, sous un soleil de plomb. Nous longions la « route de la corniche » route en lacets creusée dans la roche, au-dessus de l'abîme, avec parfois des surplombs vertigineux. A ciel ouvert, percée d'une série de courts tunnels, elle offrait des points de vue magnifiques sur les gorges du Rhumel. En-dessous, accroché à la muraille rocheuse, le « chemin des touristes », étroite passerelle métallique de moins d'un mètre de large sur laquelle je ne me suis jamais risquée. Au fond du ravin, un filet d'eau glissait entre les roches détachées des flancs et grossissait parfois sous l'orage en torrent boueux. Ensuite, une dégringolade dans un sentier abrupt dans les fourrés de diss et taillis de lentisques, pour économiser le prix de l'ascenseur, creusé aussi dans la roche, qui descendait à 70m dans la falaise.
Sur le chemin, nous rencontrions de jeunes Arabes qui vendaient,
pour quelques sous, des figues de Barbarie qu'ils avaient cueillies
sur les raquettes épineuses des cactus qui,  avec
les agaves aux pointes rigides et acérées, bordaient les chemins. avec
les agaves aux pointes rigides et acérées, bordaient les chemins.
A mains nues ou protégées d'un lambeau de tissu, ils choisissaient un fruit bien mûr, coloré, rouge orangé, dans un panier tapissé de feuilles fraîches et, de la peau épaisse, hérissée de pustuleux piquants, ils faisaient surgir avec un couteau très aiguisé, en trois incisions expertes, deux horizontales et une verticale, une pulpe juteuse et sucrée mais sans parfum, dont nous nous régalions en crachant sans arrêt les grains durs. Malgré son arsenal défensif et dissuasif, la figue de Barbarie reste liée à nos plus grands plaisirs d'enfants.
A Sidi m'Cid, à 100m au-dessous du niveau de la ville, dans un extraordinaire décor naturel de rochers, de cascades et de verdure, des sources d'eau chaude alimentaient deux bassins, un de 18m sur 7 m, peu profond (1, m15) à l'état naturel, dans une excavation de la roche qui recueillait l'eau chaude qui jaillissait du rocher à 3 mètres de hauteur. L’eau transparente reflétait le bleu du ciel et le décor de verdure et rochers. Un deuxième bassin rond était aménagé avec une bordure. Des rangées de cabines les séparaient. Et enfin, au pied d'une falaise, une superbe piscine olympique aux vastes gradins de pierre, construite dans les années 1930, alimentée aussi par la cascade d’eau chaude. Bien des champions dont Alfred Nakache, recordman du monde du 200m brasse en 1942 et champion de France du 100m, 200m, 400m crawl plusieurs années consécutives, s’y sont formés. Même en hiver, par temps de neige, la température de l’eau n’était jamais inférieure à 22°.
|
 |
|
Dans cette piscine olympique, après avoir pataugé dans les petits bassins avec des flopées de jeunes « yaouleds » criards, j'ai modestement fait mes premiers plongeons de pied, sans même savoir nager, soutenue par mes copains, J.P A… et Max M… , les neveux de notre voisine du 5éme étage Mme Ghenassia, qui me tenaient par la main, de chaque côté. Néophyte un peu inconsciente !
 A Sidi M’Cid été 1951 : Josiane, Claude, Jacqueline à l’arrière-plan. A Sidi M’Cid été 1951 : Josiane, Claude, Jacqueline à l’arrière-plan.
|
 Dans l’eau : Max, Claude, Jean-Pierre, Maya, Guy, Jacqueline. Dans l’eau : Max, Claude, Jean-Pierre, Maya, Guy, Jacqueline.
|
Je ne peux pas clore ce chapitre sans évoquer le tragique destin d'Alfred Nakache, de son épouse Paule née Elbaz 29 ans, très proche de notre famille, et de leur petite fille Annie 2 ans, déportés à Auschwitz en Janvier 1944, livrés à la Gestapo sur dénonciation, victimes de la méchanceté humaine et de la barbarie nazie. Paule et la petite Annie ne sont jamais revenues.
•
Les "boums"
 Sur cette terrasse, nous avons aussi chanté et dansé : nos premières « boums » en quelque sorte (nous ne connaissions pas encore ce mot) avec nos voisins de palier italiens : Antoine et Gilbert Bel Antonio et leur jeune tante de notre âge. Plus tard, un été, en vacances à Constantine, j’ai vu cette belle fille de 15 ou 16 ans tirant l’aiguille derrière le comptoir d’une grande blanchisserie. Elle avait un enfant et travaillait déjà, alors qu’une dizaine d’années d’études nous attendait encore. Faisaient aussi partie du groupe les neveux et nièces de Mme Gh, notre voisine du 5ème : Jean-Pierre et Guy A. et Max M. et leurs sœurs : Mamie et Maya, Colette Z.- toujours mon amie- et sa sœur Nelly, sans parler de toute la marmaille des tout petits voisins : « Vonvon » S. et ses frères, la petite Jacqueline Gh. et ses deux frères etc... Sur cette terrasse, nous avons aussi chanté et dansé : nos premières « boums » en quelque sorte (nous ne connaissions pas encore ce mot) avec nos voisins de palier italiens : Antoine et Gilbert Bel Antonio et leur jeune tante de notre âge. Plus tard, un été, en vacances à Constantine, j’ai vu cette belle fille de 15 ou 16 ans tirant l’aiguille derrière le comptoir d’une grande blanchisserie. Elle avait un enfant et travaillait déjà, alors qu’une dizaine d’années d’études nous attendait encore. Faisaient aussi partie du groupe les neveux et nièces de Mme Gh, notre voisine du 5ème : Jean-Pierre et Guy A. et Max M. et leurs sœurs : Mamie et Maya, Colette Z.- toujours mon amie- et sa sœur Nelly, sans parler de toute la marmaille des tout petits voisins : « Vonvon » S. et ses frères, la petite Jacqueline Gh. et ses deux frères etc...
Tout enfants, nous avons écouté là, sans nous lasser : « voilà les gars de la marine ! » chanté en chœur par les « Compagnons de la Chanson », sur un phonographe « Voix de son maître », avec cornet et manivelle. Nous n’aimions pas les autres disques : Reda Caire, Tino Rossi, Edith Piaf ! Nous adorions  Danièle Darrieux qui chantait « le premier rendez-vous » ou « c’est un mauvais garçon » mais nous n’avions pas ses disques et Josiane et moi regrettions de ne plus entendre mon père sur son violon jouer le soir La Méditation de Thaïs, le concerto de Mendelssohn ou le printemps de Beethoven. C’était la guerre et les lois de Vichy et notre vie était bouleversée. Après le débarquement américain nous avons aussi écouté quelques 33 tours de standards américains. Mais nous avions grandi et abandonné la petite terrasse. L’appareil à cornet de notre enfance appartenait à Suzette –Mme S. – l’autre locataire du 5ème étage, « la bonne fée de la terrasse ». La fenêtre de son couloir s’ouvrait directement sur la terrasse. Par-là, elle nous surveillait un peu et nous approvisionnait aussi. Danièle Darrieux qui chantait « le premier rendez-vous » ou « c’est un mauvais garçon » mais nous n’avions pas ses disques et Josiane et moi regrettions de ne plus entendre mon père sur son violon jouer le soir La Méditation de Thaïs, le concerto de Mendelssohn ou le printemps de Beethoven. C’était la guerre et les lois de Vichy et notre vie était bouleversée. Après le débarquement américain nous avons aussi écouté quelques 33 tours de standards américains. Mais nous avions grandi et abandonné la petite terrasse. L’appareil à cornet de notre enfance appartenait à Suzette –Mme S. – l’autre locataire du 5ème étage, « la bonne fée de la terrasse ». La fenêtre de son couloir s’ouvrait directement sur la terrasse. Par-là, elle nous surveillait un peu et nous approvisionnait aussi.
Suzette avait trois fils plus petits que ma sœur Josiane et moi mais elle adorait les filles. N’avait-elle pas, sur les conseils de je ne sais quelle matrone, bu, après incantations toujours en arabe, un verre d’eau sur la tête de Josiane et sur la mienne, après l’avoir fait tourner dans un sens puis dans l’autre ? On lui avait fait espérer ainsi une fille blonde aux yeux bleus. Son troisième enfant fut encore un garçon, brun à la peau très mate comme elle et son mari !
Le verre d’eau avait raté son coup ! Par surmenage sans doute ! On lui accordait trop de pouvoir : éloigner les esprits malfaisants, soigner les migraines et les maux de ventre, réaliser les vœux !
•
L'automne
La Souccah
 A la fin de l’été, sur la terrasse, dans une grande excitation joyeuse, nous célébrions Soukot « la fête des cabanes » qui commémore la vie précaire des Hébreux errant, après la sortie d’Egypte, sous des « nuées de gloire », dans le désert, pendant quarante ans. « Colonnes de nuées, le jour, et de feu, la nuit ». Précarité absolue de l’homme et protection absolue de Dieu. A la fin de l’été, sur la terrasse, dans une grande excitation joyeuse, nous célébrions Soukot « la fête des cabanes » qui commémore la vie précaire des Hébreux errant, après la sortie d’Egypte, sous des « nuées de gloire », dans le désert, pendant quarante ans. « Colonnes de nuées, le jour, et de feu, la nuit ». Précarité absolue de l’homme et protection absolue de Dieu.
« Dans la souccah, tu demeureras 7 jours ». Ainsi nous est-il ordonné (lévitique 23, 42.).
La préparation était fébrile. Les jours précédents, des Arabes circulaient dans le quartier juif avec des charrettes tirées par des mulets, pleines de roseaux et de branches de palmier. On marchandait et on achetait.
Les adultes édifiaient avec de très longs roseaux une grande cabane. Les branches de palmier qui recouvraient le toit devaient laisser apercevoir le ciel : deux tiers de branchages et un tiers de ciel.
Grand-père venait inaugurer la souccah en chantant le « Hallel » et en agitant le « loulab » dans les quatre directions et vers le haut et le bas pour signifier que Dieu est partout. Le « loulab » est une branche de palmier garnie de feuilles de saule et de myrte. Dans sa main libre, grand-père tenait un cédrat qu’il respirait profondément en demandant la protection divine.
Parmi d’autres, l’une des explications est que chacune des quatre espèces : palmier, cédrat, myrte, saule, est le symbole d’une attitude des Juifs à l’égard de l’étude de la Torah et de la pratique des « mitsvot ». L’étude de la Torah est comparée au goût et l’accomplissement des « mitsvot » à l’odeur : la datte : goût sans odeur, le cédrat : goût et odeur, le myrte : odeur sans goût, et le saule : ni goût ni odeur. Et le « loulab »est le symbole du peuple juif au-delà de toutes les différences dans la pratique- ou non- de la religion. Je ne me souviens pas que grand-père ait souvent pris là ses repas avec nous. Probablement, les prenait-il seul en revenant de la synagogue tôt le matin et le soir.
Nous, enfants, ne quittions plus la terrasse. Dans la vaste cabane, où table et chaises avaient été installées, nous faisions de copieuses « goûtettes », aussi joyeuses que celles que grand’mère et ma petite tante Mireille organisaient pour nous, le soir de Pourim, avec un service de table miniature en verre bleu à relief dans le « coin du piano ». La banquette cannée du piano tenait lieu de table, et de petits tabourets bas en bois blanc paillés, de sièges. Nous avions même de petits kanouns avec des braises sur lesquels nous réchauffions nos minuscules marmites de petits pois avec boulettes de viande.
A la fin de la semaine de soukot, après le démontage de la cabane, grand’mère récupérait des roseaux pour en faire des brochettes qui marquaient la fin de la célébration, et aussi, pour nous enfants, avec la rentrée des classes, la fin des longues vacances d’été –trois mois- et des jeux sur la terrasse.
Cette fête qui termine un cycle liturgique avec la fin de la lecture annuelle de la Torah, était pour nous, écoliers, aussi la fin d’un cycle.
•
L'hiver
La neige
 En hiver, la couche de neige était parfois si haute qu’elle empêchait l’ouverture de la porte de la terrasse. Cris de surprise et de joie. Le spectacle rare de Constantine et des gorges du Rhumel sous la neige, vu de la terrasse ou de notre balcon, était une féerie. Mais c’était un émerveillement éphémère car la neige fondait vite sous le soleil. La terrasse sortait de sa torpeur hivernale le temps de quelques batailles de boules de neige avec Paul, d’une ébauche de bonhomme de neige. Mais notre équipement ne nous permettait pas ou peu les jeux dans la neige : des chaussures basses en cuir obtenues contre des tickets de rationnement et qu’il nous fallait épargner, des jupes courtes avec des mi-bas tricotés à la main qui s’arrêtaient sous le genou. Les filles ne portaient jamais de pantalons et les « collants » de laine n’existaient pas chez nous. En hiver, la couche de neige était parfois si haute qu’elle empêchait l’ouverture de la porte de la terrasse. Cris de surprise et de joie. Le spectacle rare de Constantine et des gorges du Rhumel sous la neige, vu de la terrasse ou de notre balcon, était une féerie. Mais c’était un émerveillement éphémère car la neige fondait vite sous le soleil. La terrasse sortait de sa torpeur hivernale le temps de quelques batailles de boules de neige avec Paul, d’une ébauche de bonhomme de neige. Mais notre équipement ne nous permettait pas ou peu les jeux dans la neige : des chaussures basses en cuir obtenues contre des tickets de rationnement et qu’il nous fallait épargner, des jupes courtes avec des mi-bas tricotés à la main qui s’arrêtaient sous le genou. Les filles ne portaient jamais de pantalons et les « collants » de laine n’existaient pas chez nous.
La fameuse ordonnance du 16 brumaire an IX de la République, jamais abolie jusqu’à aujourd’hui, en 2012, qui exigeait une autorisation accordée par la Préfecture de police pour le port du pantalon par les femmes était certes tombée depuis longtemps en complète désuétude. L’interdit social ou de la mode perdura cependant jusqu’aux années 1960 environ.
Aujourd’hui, d’après certains témoignages de jeunes filles, c’est la jupe qui poserait problème !
L’hiver, la terrasse, désertée même par la « laveuse », était enfin rendue à elle-même et, figée dans le froid, elle retrouvait le silence. Un froid si rigoureux que nous avions les doigts bouffis et parfois crevassés par les engelures.
 Même les bains d’urine tiède - ultime recours !- prônés par une certaine « médecine » restaient sans effet sur nos mains et pieds douloureux, avec d’insupportables démangeaisons quand, pendant la guerre, le soir, à la chaleur du « Mirus », l’unique poêle de la maison, en fonte émaillée rouge sombre alimenté au bois, le sang recommençait à circuler dans nos doigts gourds. Des soins inefficaces occupaient largement nos soirées ! Grand’mère somnolait sur sa chaise basse, grand-père, resté assis à table, fredonnait des psaumes « tehilim » ou « piyoutim » poèmes liturgiques, doucement. Nous hibernions au coin de la cheminée, devant le poêle, dans l’odeur des sarments brulée, récitant nos leçons, en attendant le retour des cigognes et le temps des jeux sur la terrasse. Même les bains d’urine tiède - ultime recours !- prônés par une certaine « médecine » restaient sans effet sur nos mains et pieds douloureux, avec d’insupportables démangeaisons quand, pendant la guerre, le soir, à la chaleur du « Mirus », l’unique poêle de la maison, en fonte émaillée rouge sombre alimenté au bois, le sang recommençait à circuler dans nos doigts gourds. Des soins inefficaces occupaient largement nos soirées ! Grand’mère somnolait sur sa chaise basse, grand-père, resté assis à table, fredonnait des psaumes « tehilim » ou « piyoutim » poèmes liturgiques, doucement. Nous hibernions au coin de la cheminée, devant le poêle, dans l’odeur des sarments brulée, récitant nos leçons, en attendant le retour des cigognes et le temps des jeux sur la terrasse.
6 - Les pratiques superstitieuses
• • •
La superstition
Les croyances et pratiques superstitieuses transmises depuis la nuit des temps dans le bassin méditerranéen étaient fréquentes dans notre milieu judéo-arabe, à Constantine, malgré notre émancipation culturelle, souvent sur les recommandations et conseils de vieilles juives ou de « fatmas» un peu sorcières qui faisaient autorité et qu’on appelait à l’aide.
Mais chez mes grands-parents M… la superstition n’avait pas une influence notable.
La croyance au « mauvais œil » était la plus répandue. Le « mauvais œil » symbolise une emprise maléfique totale sur quelqu’un ou quelque chose, par envie, jalousie, méchanceté. Ma grand’mère Clara, suivant l’usage, mais avare d’explications, à toute occasion, faisait tourner au-dessus de nos têtes sa main fermée sur une poignée de gros sel, 7 fois dans un sens et 7 fois dans l’autre, en marmonnant en arabe une formule incantatoire passe-partout : « Que l’œil du rat, que l’œil du voisin qui te veut du mal aille dans le feu ! ».
Le rat avait sûrement un rapport avec le blé ensilé, sans parler de tout ce qu’il véhicule de pouvoir maléfique associé à la peste dans la pensée populaire et de son sens métaphorique. Pour le voisin, on comprend !
Puis grand’mère nous faisait, à la ronde, simuler un crachat sur sa main. Nous arrondissions, à l’unisson, nos lèvres fermées et, avec une pulsion de la langue contre les dents, nous produisions quelques postillons humides. C’était un jeu. Paul, toujours taquin, crachait vraiment.
Enfin, elle jetait le sel dans la cendre avec braises incandescentes d’un petit « kanoun ». Le grésillement du sel qui crépitait était un signe favorable. A défaut de kanoun, la cuvette des W.C. pouvait faire l’affaire.
Si les sortilèges et maléfices résistaient à cette sorcellerie, c’était bien le diable !
Il s’agissait –je l’ai su bien plus tard – d’un rite de transfert et d’expulsion du mal, faisant office de remède, très répandu dans le Maghreb. On sacrifie un animal ou on utilise un produit comestible (œufs, sel, semoule) ou quelque autre objet ( tamis, laine) remis à une personne officiant qui promène l’objet au-dessus du patient 7 fois dans le sens des aiguilles d’une montre puis autant inversement en prononçant des formules pour transférer
le mal. Ainsi l’objet se charge du mal et est ensuite détruit. .
Grand’mère n’utilisait que le sel réputé repousser le mauvais œil et très souvent utilisé dans maints rites propitiatoires.
Quant au nombre 7, nombre bénéfique et mystiquement parfait, on le retrouve partout des 7 planètes . . . aux 7 nains.
Dans notre famille, le monde moderne avait suffisamment pénétré pour que la médecine fût plus une science, un art qu’une magie. Aussi les « remèdes de bonne femme » y avaient peu cours. On appelait le docteur A…, le médecin de famille, ou le docteur M…. On leur faisait plus confiance qu’aux tissus rouges et lentilles pour soigner les rougeoles ! On se fiait plus à l’aspirine qu’au verre d’eau salée sur la tête pour les migraines. Le grain de blé sur l’orgelet et l’oignon cuit et chaud sur l’abcès laissaient ma famille un peu sceptique.
Par contre, Mme Alice, la cuisinière des S… à Bougie, préconisait toutes sortes de remèdes de ce genre entre 2 infusions de menthe « narnar » ou « flio » à Jacques contre ses fréquentes migraines. Pour un effet plus durable, on lui a aussi attaché autour du cou avec un lacet de cuir, un petit sac en tissus rouge, un talisman, une amulette, un grigri, fabriqué par un « marabout juif » avec une écorce de courge sèche sur laquelle était gravé à la pointe d’un couteau, une supplique en hébreu ! En ces temps de préhistoire de l’obstétrique, Mme Alice prédisait le sexe des enfants à naître, en jetant de l’alun sur des braises et, Pythonisse inspirée, interprétait les formes que prenait la pierre boursouflée. L’alun était d’un usage courant pour cautériser les estafilades des lames Gilette lors des rasages. Il voisinait avec le blaireau et le rasoir. Le 5, chiffre faste pour l’Islam (cf. les 5 doigts de la main de Fatma-masa 163) était un autre recours contre le « mauvais œil ». La main était déjà l’emblème de la déesse Tanit vénérée à Carthage.
Contre le «mauvais œil », on étend les 5 doigts de la main droite et on dit : « 5 dans ton œil » ou « 5 sur ton œil », « khamza fe ain chitan » ! : 5 dans l’œil du diable !
Outre les médaillons en forme de main, en or, argent, ciselé, filigrané, martelé, émaillé avec ou sans petites perles baroques qu’elle offrait, grand’ mère façonnait à la naissance des bébés une double main, dans de la pâte à pain. Avec un couteau, elle faisait apparaître 5 doigts aux extrémités. J’ai déjà évoqué la main trempée dans le sang du mouton sacrifié à Pâque.
J’observais médusée et inquiète les couteaux sous les oreillers des bébés, d’autant que je savais qu’Hercule, à peine né, avait étranglé 2 serpents dans son berceau.
J’ai établi, bien plus tard, le lien entre cette pratique et le rituel du sabre tel que le rapporte André Chouraqui dans La Saga des juifs en Afrique du Nord. Il s’agissait d’éloigner des berceaux où sommeillaient les bébés incirconcis tous les démons qui encombraient l’espace et surtout, dans la communauté juive, Lilith le démon femelle qui n’épargnait que les filles. Je me souviens avoir vu, une fois, sous l’oreiller d’un de mes petits cousins –ou voisins ?- une chauve- souris capturée à l’intérieur d’une maison et qu’un arabe un peu sorcier avait enfermée entre 2 feuilles d’aluminium scellées en forme de petite soucoupe volante. Les chauves-souris avaient mauvaise réputation ! Et pourtant parmi les 1000 espèces de chauves-souris connues seules 3 sont « vampires », la plupart sont d’inoffensives insectivores !
Sous l’oreiller de Jean-Lou, sa grand’mère paternelle, avait mis, outre le couteau, un talisman, un « nouet » -pratique berbère aussi – un petit sac de satin noir qu’elle avait confectionné avec 50 (ou 500 ?) petites graines de je ne sais quoi : cumin ? Graines noires de pavot ?
On pratiquait aussi dans notre famille le rite du Henné : « Tania » à Constantine. On déposait au creux de la main de la future mariée de la pâte de henné avec un louis d’or offert par la mère du marié, attachée par un voile blanc et un ruban rouge. Cette plante était supposée posséder des vertus de magie sympathique et de bénédiction, des propriétés prophylactiques, un pouvoir de protection magique et médicale, de garantie de fécondité, de « baraka » enfin. On utilisait aussi le henné dans des rites d’inauguration associé au lait, au miel, à l’encens, et parfois même à . . . des écailles de poisson. Le poisson, parce que la valeur numérique des lettres hébraïques de « dag » : poisson, est le nombre 7 (encore lui !), symbole d’abondance et de fécondité, symbole aussi du Léviathan dont les Justes sont appelés à goûter la chair au paradis, était censé protéger du « mauvais œil ». Héritage recueilli par les premiers Chrétiens dans les Catacombes avec « ichthus » : en grec : « poisson » et sigle de : Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur ?
L’interdiction de couper ses ongles ou de se coiffer n’importe où était, bien entendu une mesure d’hygiène élémentaire, mais pouvait trouver sa source dans la crainte que les rognures d’ongle ou les cheveux ne tombent entre les mains de jeteurs de sorts ou de « voulteux » : envoûteurs.
Mais l’ambiance générale chez mes grands-parents n’était pas à la superstition, ni à la croyance aux amulettes, aux incantations des marabouts et aux mômeries des matrones. Tout juste, un peu, quelques rabbis miraculeux et leurs dons surnaturels comme le Rab En Kaoua de Tlemcen.
Grand-père, en bon disciple de Maïmonide, le « Rambam», suivait son maître qui, dans son Epître aux Yéménites, mettait en garde contre la « fantasmagorie chaldéenne qui encourageait les plus incultes à se prémunir contre les influences maléfiques. »
Jérémie déjà dénonçait le pouvoir prêté aux idoles : « Leurs dieux en bois plaqués d’or et d’argent ne protègent pas plus qu’un épouvantail dans un champ de concombres ! »
Les Djouns : démons, rouhot raot : mauvais esprits, ghoul : ogres, mazihim : esprits malfaisants, succubes, incubes, etc... Étaient interdits de séjour chez mes grands-parents. Tout cet univers occulte nous était étranger.
Le verre d’eau que l’on jetait sur les pas de celui qui se préparait à partir, pour susciter bonne mer, bon vent, voyage sans mauvaise rencontre : détrousseurs, pirates, flibustiers et retour sans péril est la seule pratique folklorique que nous conservons. C’est un jeu, un au-revoir pittoresque, un geste de tendresse protectrice. Et surtout ne cherchez pas un sens à ce geste !
Toute cette magie ancestrale et « bon enfant » était inoffensive à défaut d’être efficace !
7 - La jeune fille et le mariage juif
dans les années 40 à Constantine.
• • •
A Constantine, j’ai vraiment vécu la totale métamorphose de la population juive avec le contraste entre la vieille génération encore souvent ancrée dans son passé et les nouvelles totalement assimilées à la France et à la civilisation occidentale. Constantine, ville de l’intérieur, perchée sur son rocher, inaccessible comme un nid d’aigle, inexpugnable même pour Jugurtha, est restée longtemps fermée aux influences extérieures. La population juive si longtemps repliée sur elle-même, conservait des vestiges du long passé arabo-judéo-berbère. Des femmes âgées, comme du temps pas si lointain où l’Algérie faisait partie de l’empire ottoman, gardaient la langue, les rituels partagés, les croyances notamment superstitieuses, les habitudes alimentaires, le goût oriental des riches étoffes, des bijoux, des broderies au fil d’or, et les imposaient en quelque sorte aux jeunes générations au nom de la tradition, au moins pour certaines célébrations.
J’ai connu aussi le contraste dû à l’évolution des mœurs, entre la « jeune fille rangée », « jeune fille à marier » toujours chaperonnée, qui ne pouvait que rêver en attendant un mariage « arrangé » par les familles, avec tractations souvent au sujet d’une dot, et la jeune fille émancipée par les études qui, avec un métier, avait gagné son autonomie et le droit à un mariage d’inclination, sans intercesseurs.
« La jeune fille rangée » des années 40
Elle lisait des romans de Max du Veuzit et de Delly (*), debout devant la cheminée de sa chambre, répondait de façon distraite.
 Elle vouait un culte à Pierre Richard-Willm, le très séduisant « jeune premier aux mille fiancées » des années 30-40, blond « Chevalier du Moyen-Age » et « dandy fin de siècle », à raie impeccable et ondulations qui finissaient en accroche-cœurs. Dans ses films, des amours romanesques comme on en rêve toute sa vie : Le Werther de Max Ophuls, le Dantès de Robert Vernay, « L’inventeur » lunaire et maladroit du film « Anne-Marie » de Raymond Bernard, sur un scenario de Saint-Exupéry. Etc… Elle vouait un culte à Pierre Richard-Willm, le très séduisant « jeune premier aux mille fiancées » des années 30-40, blond « Chevalier du Moyen-Age » et « dandy fin de siècle », à raie impeccable et ondulations qui finissaient en accroche-cœurs. Dans ses films, des amours romanesques comme on en rêve toute sa vie : Le Werther de Max Ophuls, le Dantès de Robert Vernay, « L’inventeur » lunaire et maladroit du film « Anne-Marie » de Raymond Bernard, sur un scenario de Saint-Exupéry. Etc…
Elle avait des cahiers et carnets, qu’elle gardait jalousement, sur lesquels elle collait des illustrations découpées dans des revues de cinéma ou des photos d’artistes qui la faisaient rêver : Joan Harlow, Clark Gable, Veronica Lake, Greta Garbo, Jean Murat, Claudette Colbert etc…
Elle recopiait des poèmes et dessinait.
Elle sortait très peu et toujours accompagnée, « chaperonnée ». On était très strict avec les jeunes filles à marier.
Il n’était pas question pour elle de « faire Caraman », comme nous, la génération d’après-guerre. On « faisait Caraman » à Constantine, comme la rue de la République à Beni Saf, le cours Bertagna à Bône, la rue d’Arzew à Oran, la rue Michelet à Alger, la rue Trezel à Bougie.
La rue Caraman était étroite. On s’y bousculait donc
mais on était sûr de se rencontrer. Cette rue allait de
la cathédrale, qui marquait la limite du quartier juif, jusqu’à la
Place de la Brèche. Qui savait encore qui était Caraman ?
Caraman c’était le paseo et la Brèche, c’était
la Place et l’esplanade aux créponnés. Caraman, mort
du choléra, est un des officiers avec Valée, Damrémont,
Rohault de Fleury, Lamoricière, Seguy-Villevalex qui, en 1837,
ont participé à la prise de Constantine. La ville, sur
son rocher, véritable forteresse naturelle, paraissait imprenable :
« Même Jugurtha ne pouvait pas prendre d’assaut Cirta à cause de la nature du lieu ».Salluste.
Rue Caraman, le soir, avant le dîner, toute une jeunesse « faisait le boulevard », « le paseo », déambulait dans des allers et retours incessants. D’un côté on montait, de l’autre on descendait. Un manège, un ballet de séduction en quelque sorte... On y retrouvait aussi ses amis, sans les chercher et sans rendez-vous.
L’été, on s’aventurait parfois sur l’esplanade de « La Brèche » pour déguster des « créponnés » ces neigeuses préparations glacées au citron. On accédait à l’esplanade par des escaliers sur lesquels de jeunes cireurs, assis sur leurs boîtes en bois, s’entraînaient à la percussion avec leurs brosses à reluire.

La« Brèche » s’ouvrait sur un panorama magnifique, les Monts bleutés d’El kantara, le Chettaba, la plaine fertile du Hamma et ses «Jardins» et les méandres de l’oued Rhumel.
Avec la jeune fille, toujours « chaperonnée », nous faisions souvent de très longues promenades. Nous partions du bas de la rue Nationale, traversions le Pont d’El Kantara, longions la gare, puis le Pont de Sidi Rached, long viaduc de 447m aux 27 arches dont l’une, au centre, enjambe sur 70m une gorge du Rhumel profonde de 100m. Du pont, on apercevait le quartier  arabe, les terrasses, les vieilles maisons aux tuiles romaines patinées par le temps, le dédale des ruelles et les minarets. Sur les toits, souvent, des cigognes blanches à ailes noires de l’espèce commune, craquetaient debout sur leur fagot, une patte relevée, la tête rejetée en arrière au-dessus du dos, dans leurs nids couverts de brindilles qu’elles désertaient dès Août pour revenir en Mars. Elles étaient très nombreuses à Constantine. arabe, les terrasses, les vieilles maisons aux tuiles romaines patinées par le temps, le dédale des ruelles et les minarets. Sur les toits, souvent, des cigognes blanches à ailes noires de l’espèce commune, craquetaient debout sur leur fagot, une patte relevée, la tête rejetée en arrière au-dessus du dos, dans leurs nids couverts de brindilles qu’elles désertaient dès Août pour revenir en Mars. Elles étaient très nombreuses à Constantine.
Nous revenions vers le cinéma Le Nunez, la Place de la Brèche, rue Caraman, rue de France et rue Thiers.
La « jeune fille rangée » se maria. Nourrie de romans où les princes épousent des bergères, elle rêvait, peut-être, d’amours romanesques, de passions exaltantes qui consument les cœurs !
Son destin prit certainement un tour plus prosaïque. Les hommes revenus de la guerre voulaient enfin fonder rapidement des foyers. Ils multipliaient les rencontres en vue d’accordailles.
(*) Pseudonyme littéraire sous lequel Marie Petitjean de la Rosière (1875-1947) et son frère Frédéric Delly (1876-1949) écrivirent des romans sentimentaux qui connurent un grand succès populaire.
« Tania » et « Tevilah ».
On vivait une époque de transition. La jeune génération était totalement occidentalisée et, en l’absence des hommes, les femmes avaient découvert, pendant la guerre, le monde du travail et l’indépendance financière, comme en France, mais certains rites judéo-arabes ancestraux qui faisaient partie intégrante de la vie traditionnelle, s’imposaient encore.
 La « Tania », le rituel païen du henné est une cérémonie traditionnelle orientale qui faisait partie des célébrations du mariage juif comme musulman. Cette vieille tradition berbère, arabe et juive, donnait lieu, chez les juifs, à une petite fête, après les fiançailles, dans la semaine précédant le mariage. On accordait au henné, rempart contre les éléments extérieurs nuisibles, des vertus de magie sympathique, une valeur médicinale, cosmétique et, en particulier chez les berbères où les tatouages au henné étaient souvent d’un grand raffinement aux signes mystérieux, un pouvoir de séduction. La « Tania », le rituel païen du henné est une cérémonie traditionnelle orientale qui faisait partie des célébrations du mariage juif comme musulman. Cette vieille tradition berbère, arabe et juive, donnait lieu, chez les juifs, à une petite fête, après les fiançailles, dans la semaine précédant le mariage. On accordait au henné, rempart contre les éléments extérieurs nuisibles, des vertus de magie sympathique, une valeur médicinale, cosmétique et, en particulier chez les berbères où les tatouages au henné étaient souvent d’un grand raffinement aux signes mystérieux, un pouvoir de séduction.
La fiancée juive, habillée de rose, à l’orientale, en vêtements traditionnels le plus souvent, et toutes les jeunes filles à marier parentes ou amies recevaient dans le creux de la main de la pâte de henné attachée avec une gaze et un ruban rouge. Avec un louis d’or dans celui de la future mariée. La mère du marié offrait une corbeille capitonnée de satin rose avec des mules, des anneaux ouverts pour les chevilles (khelkhal) (que la jeune femme ne porterait jamais, bien entendu) et de gros serpents en or et, avec des « youyous » bien sonores, certaines femmes faisaient une démonstration de « danses au foulard » sur de la musique arabe. La jeune fille moderne se prêtait, parfois, un peu contrainte à ces réjouissances typiquement judéo-arabes. La danse au foulard est un art qui ne souffre pas la médiocrité.
Seules les femmes étaient conviées à ce rituel festif.
 La « Tevilah » « l’immersion » en hébreu, et «baptême » en Grec, rituel du bain de purification, avec immersion totale, rite ancestral, dans la tradition religieuse biblique juive mais célébré à l’orientale, avait lieu au bain maure la veille du mariage. Le Vendredi après-midi avant le Shabbat, la fiancée était accompagnée au bain rituel : « le Mikvé » (littéralement « collection d’eau ».) Un « mahbès », un grand pot en cuivre contenait les serviettes et le nécessaire de toilette. Une « tassa », en cuivre également, servait à s’asperger. La « Tevilah » « l’immersion » en hébreu, et «baptême » en Grec, rituel du bain de purification, avec immersion totale, rite ancestral, dans la tradition religieuse biblique juive mais célébré à l’orientale, avait lieu au bain maure la veille du mariage. Le Vendredi après-midi avant le Shabbat, la fiancée était accompagnée au bain rituel : « le Mikvé » (littéralement « collection d’eau ».) Un « mahbès », un grand pot en cuivre contenait les serviettes et le nécessaire de toilette. Une « tassa », en cuivre également, servait à s’asperger.
Après une toilette très soignée dans la salle commune du bain maure et une douche, on procédait au bain de purification « la Tévilah », à l’écart, dans une petite piscine avec des marches pour une immersion progressive, pleine d’eau « collectée » (d’où le nom Mikvé) de pluie ou de source à l’origine, pure, transparente, uniquement réservée pour les Juifs à cet usage. La jeune fille, entièrement nue, sans le moindre bijou, ni vernis à ongles, doigts écartés, rien n’empêchant le contact entre le corps et l’eau purificatrice était complètement immergée, plongée 3 fois, tête comprise, comme pour un baptême chrétien, avec bénédictions et prières, et l’intercession et l’aide d’une « ballanit ».
Venait ensuite la dégustation de douceurs. On distribuait des pâtisseries orientales « maison » dégoulinant de miel et des dragées à toutes les femmes présentes indifféremment juives ou pas, apparentées ou pas, toujours avec force « Youyou » !
Puis, vestige encore de mœurs anciennes, parfois avait lieu l’exposition du trousseau, mais à la sortie de la guerre, la pénurie sévissait encore, et les mœurs évoluaient.
Pour le mariage religieux, à la synagogue, la jeune mariée était parée de blanc, tout à fait à l’occidentale, avec voile blanc à longue traine et filles d’honneur avec bouquets, rubans et dentelles. Elle entrait au bras de son père, très émue au son de la marche nuptiale. Lors de la fête qui suivait, c’est la musique moderne qui s’imposait pour les danses à la mode, avec des cavaliers qui souvent avaient retiré leurs gibus mais gardé leurs « queues de pie », dans les milieux les plus aisés.
La célébration du mariage était tout à fait caractéristique des mœurs de la population juive au carrefour de deux cultures, deux civilisations.

Mariage de mes parents
19 décembre 1932 |

Yolande fille d’honneur
9 août 1936 |
V - Ma famille paternelle à Tlemcen
• • • Mes grands-parents SICSIC.
Abraham Haiem Sicsic (né et mort à Tlemcen 28.7.1865- 30.12.1927)
Nouna Sicsic née Sicsic (Tlemcen 24.9.1876- Oran 8. 6.1946)

Mon grand-père Abraham Sicsic.
Une branche de la famille Sicsic, surtout des commerçants et des artisans semble-t-il, serait, après bien d’autres errances et étapes, originaire de Bogarhi (Beragouia) et Tlemcen et de là certains auraient essaimé à Oujda, Marnia, Turenne. Vers 1600, on signale Siksik Eliezer à Tlemcen et Sicsic Said et Abraham et Josué ses frères de Tlemcen, des notables de la communauté juive, sont cités dans l’introduction de Zevahin Chelemim de Abraham N’kaoua (un descendant du Rab de Tlemcen ?) publié à Livourne en 1862. Ce qui prouverait au moins qu’ils étaient versés dans l’étude de la Thora et du Talmud.
La présence de la famille Sicsic à Tlemcen remonterait donc à plusieurs siècles.
Notre patronyme Sicsic, avec toutes ses variantes : Checkchick, Sacksick, Sicsic, Siksik, Cixou, et même Siksük( très proche phonétiquement de l’oued Ksiksu) trouvé récemment à Gérone, au Musée Juif de cette ville, sur une liste de noms juifs d’origine marocaine etc…pourrait être un toponyme, un cours d’eau au Maroc s’appelle Ksiksu au sud de Tazetot, entre AÏn-Aougdal et Sidi Nefati, dans la région de Boujad près de Marrakech. Le nom d’une tribu fixée là ?
En arabe dialectal « saqsaq » et en Standard « zagzaga »signifie gazouillis, ce qui n’est pas incompatible avec l’eau qui coule même d’un oued. Je me plais à imaginer que notre nom serait une jolie onomatopée !
Quelle que soit son orthographe qui variait lors de la transcription sur les registres d’Etat Civil au cours du recensement par l’administration française, notre patronyme atteste de l’enracinement très ancien de notre famille sur cette terre africaine. D’ailleurs peu de juifs portaient un patronyme hébraïque ou araméen. Certains en ont fait un argument contre le sionisme, mais même si nous n’avons pas partagé la même terre il y a 2000 ans, dans la lointaine Palestine, nous avons à toutes les époques partagé le destin de ce « peuple » méprisé, rejeté, chassé, persécuté, qui comme tous les peuples dans l’histoire a besoin de s’enraciner, un jour, ce que ni les hommes ni l’Histoire ne lui ont permis de faire jusqu’en 1948.
Le patronyme Karsenti de la mère d’Abraham, Leha Bent Karsenti, est attesté au Maroc dès la 1ère moitié du XVIème siècle. Son origine est hypothétique : ethnique de nom de lieu en Espagne ? le mot portugais « crescente » croissant de lune ? référence aux originaires de la ville de Carcassonne, chef-lieu du département de l’Aude en France ? le Carcasenti serait devenu Carcenti ?
Ma grand’mère Nouna Sicsic disait que sa famille était arrivée en bateau mais elle ne savait ni quand ni d’où.
De toute façon, ces ancêtres Karsenti ne pouvaient être arrivés au Maroc qu’en bateau, d’Espagne, du Portugal ou de France lors des expulsions des juifs de ces pays au Moyen Age. Probablement des juifs en fuite d’Espagne et du Portugal au XIVème siècle, après les émeutes antijuives de 1391 ou au XVème, lors de la Reconquista, après le décret d’expulsion de 1492 de Ferdinand et Isabelle La Catholique, qui touchait aussi les Musulmans.
Et ceux-là d’où venaient-ils à l’origine ? Sont-ils arrivés avec les Phéniciens pour faire du commerce ? Ont-ils suivi ou fui les légions romaines ? D’où ont-ils été pourchassés ?
J’aime à évoquer ces ancêtres dont parlait ma grand’mère « arrivés en bateau », sans plus de précision.
On connait la légendaire équipée du rabbin de Séville qui, emprisonné et condamné à mort, dessina un bateau sur la muraille de son cachot, en implorant la miséricorde de Dieu. Avec ses 60 compagnons qui partageaient son sort, il embarqua sur le bateau qui traversa, invisible, les murs et les remparts de Séville pour gagner l’Algérie. Cela se passait en 1391, quand le dieu des juifs faisait encore des miracles !
On raconte aussi qu’en 1391, Rabbi Ephraïm Aln Kaoua, « la lumière d’Israël », que Tlemcen vénère comme un Saint, fuyant sa ville natale Tolède, traversa la Méditerranée et s’en vint en Tlemcen, monté sur un lion avec un serpent en guise de licou. La tombe du Rab était l’objet d’un pieux pèlerinage populaire (Hiloula) à la période de l’Omer (33 jours après Pâque). En foule, nos coreligionnaires venaient sur la pierre blanchie à la chaux du « tombeau du Rab », «faiseur de miracles ». Donc déjà au XIVème siècle existait une communauté juive, condamnée alors à vivre à l’extérieur des murs, dans le faubourg d’Agadir. Le Rab obtint pour les siens, à Tlemcen, grâce à ses talents de médecin « droit de cité » et 7 lieux de culte.
En 1850 les juifs étaient environ 2500 à Tlemcen. A Tlemcen donc, cinq siècles plus tard, au XIXème, Il était une fois deux frères, mon arrière-grand-père Liaou Sicsic et mon grand-père Abraham Haiem Sicsic issus d’une nombreuse famille.
J’ignore la date de naissance de leurs parents Said Sicsic « marchand » décédé le 4. 1. 1899 et Lela Bent Karsenty, décédée deux ans avant son mari, le 23 mai 1897.
Une hypothèse : Abraham Sicsic (1800-1850) époux de Rachel Sultan, serait notre aïeul et aurait eu, entre autres nombreux enfants, deux fils : Nessim 1830-1885 époux de Chabba Benkimoun et Said, mon aïeul.
La première photo de mon album souvenir est celle de mon grand-père Abraham Haiem Sicsic. Il a un beau visage noble. Un teint et des cheveux raides clairs, des yeux marron. Enfant, il fut blond. Les blonds souvent aux yeux bleus ou verts, type berbère dérivé du type européen nordique, se retrouvent dans toutes les branches de notre arbre généalogique. J’en ai connu aussi parmi mes condisciples musulmans à Tlemcen. Mon père, lui-même blond dans sa petite enfance, évoquait sa cousine Lea Sicsic, épouse Benzaken, une autre Léa Sicsic, épouse de jacob Amouyal, morte en 1939, Sarah Sicsic ainsi que son cousin germain Félix Sicsic, Ingénieur chef du cadastre marocain, brillant sujet bachelier à 16 ans, et qui avaient tous des yeux bleus. Nous ne sommes certainement pas que sémites arrivés de Palestine, d’Egypte ou de Babylonie après avoir traversé déserts et mers. Une branche de notre famille ou plusieurs, descendraient de tribus « guerim » prosélytes berbères converties au judaïsme ? ou d’unions mixtes juifs- berbères ?
Abraham est né à Tlemcen département d’Oran, le 28 juillet 1865, « juif indigène », il devient citoyen français à l’âge de 5 ans quand est promulgué le décret Crémieux le 24 Octobre1870 qui confère la qualité de « citoyen français » aux juifs d’Algérie. Ce décret qui a suscité tant de frustrations chez les musulmans et attisé la haine des antisémites si virulents déjà à cette époque.
Il était d’une famille aisée, cultivée et évoluée. Des « mécènes » pour la communauté, disait la rumeur. Mais peut-être, avec le temps et la succession des générations, une pratique plus tiède de la religion et un trop grand modernisme fit chuchoter avec humour qu’ils étaient «Emona hadacha », d’une « foi nouvelle ».
Les familles étaient très nombreuses alors, et oncles et neveux étaient souvent contemporains.
Abraham était artisan tailleur européen, à distinguer des tailleurs indigènes. Il avait une très bonne réputation. Il recevait les clients dans une grande boutique, rue Ximenes, avec une vitrine d’exposition très moderne pour les tissus. Dans l’arrière-boutique ouverte par des fenêtres sur la rue, un vaste atelier avec de nombreux ouvriers. Lui-même travaillait, selon mon père, assis sur son comptoir, les jambes croisées, pliées « en tailleur ». Mais il prenait aussi le temps de se détendre. Tous les jours, à la pause de midi, les ouvriers partis et l’atelier fermé, seul et au calme il sirotait une absinthe (elle n’était pas encore interdite) en jouant d’une très petite mandoline : la « gniby »**. Il faisait aussi de petites pauses au café qui se trouvait juste en face et commandait un « chamboro »** un café au rhum.
Une médaille en argent, en ma possession, récompensa son travail en 1912. Il avait 47 ans alors et probablement travaillait-il depuis plus de trente ans !
Superbe médaille en argent massif, gravée à son nom, datée 1912 du Ministère du Commerce et de l’Industrie, avec une plantureuse Marianne enchignonnée, les joues rebondies et un drapé à l’antique. Le ruban bleu blanc rouge et la mention « République Française »devaient remplir de fierté mon grand-père, devenu français à 5 ans. (Voir photo à la fin.)
A 27 ans en 1892, il épousa sa nièce Léah, la fille de Liaou et de Méléah Sicsic qui avait 20 ans. Leha mourut en 1899 à 27 ans. Le petit Sion, son fils, n’avait que deux ans. Deux ans plus tard, Abraham se remaria avec la sœur de Leha, son autre nièce Nouna, ma grand’ mère. Elle avait 24- 25 ans. C’était l’usage jadis dans nos familles. Ainsi le petit orphelin Sion fut élevé par la sœur de sa mère.
 La famille vivait dans un bel immeuble bourgeois de style européen 2 rue Clauzel, avec un grand balcon à l’angle de deux rues. Mes grands-parents Abraham et Nouna eurent 9 enfants entre 1903 et 1921. Seuls 4 survécurent : mon père Marcel, 1903- 1981 ; Emilie Léa, 1905- 1975 ; Berthe, 1907- 1994 et Germaine Alice née en 1914 qui mourut à l’hôpital psychiatrique de Blida, où elle s’est laissée mourir avant d’avoir trente ans après un bref mariage malheureux, pendant la guerre. La famille vivait dans un bel immeuble bourgeois de style européen 2 rue Clauzel, avec un grand balcon à l’angle de deux rues. Mes grands-parents Abraham et Nouna eurent 9 enfants entre 1903 et 1921. Seuls 4 survécurent : mon père Marcel, 1903- 1981 ; Emilie Léa, 1905- 1975 ; Berthe, 1907- 1994 et Germaine Alice née en 1914 qui mourut à l’hôpital psychiatrique de Blida, où elle s’est laissée mourir avant d’avoir trente ans après un bref mariage malheureux, pendant la guerre.
Cinq enfants donc sont morts en très bas âge, quatre à moins d’un an et une, Colette Marie, à 2 ans. La mortalité infantile était importante à l’époque, mais peut-être aussi y avait-il trop de consanguins dans cette famille ! Méléah née Sicsic, mon arrière grand’mère, la mère de Leha et Nouna, était aussi de la parentèle et toutes les deux ont épousé leur oncle Abraham Sicsic, frère de leur père Eliaou.
Je n’ai pas connu mon grand-père Abraham, mort en 1927 avant ma naissance, d’une maladie pulmonaire*. De mon grand-père Abraham Sicsic, je n’ai qu’un portrait, la précieuse boîte rouge avec son écrin de velours rouge et le ruban bleu blanc rouge qui contient la médaille sculptée par Alfred Borrel et deux photos très abîmées prises dans le très moderne et vaste atelier de la rue Ximenès en 1932 par son fils Sion.
*Je note que Sion, son fils (4 septembre 1897-31 dec.1961) fut aussi atteint d’une grave maladie pulmonaire : une pleurésie purulente, pour laquelle il fut hospitalisé à Oran pendant un an en 1939- 1940.
A la mort d’Abraham, il prit la suite de l’atelier et des ouvriers. Il céda l’atelier en 1936.
**Jacques Guy Benhamou auteur de : A la recherche d’une communauté disparue, Les juifs de Tlemcen de 1870 à 1962
a eu l’extrême gentillesse de décrypter pour moi ces mots. Je le cite :
Gniby désigne une mandoline d’une petitesse un peu ridicule, cette nuance étant implicitement suggérée par la sonorité du mot.
Chamboro : il s’agirait d’une déformation de « Chabrot » « faire chabrot » c’est mélanger du vin à sa soupe, habitude qu’avaient les paysans et à laquelle furent initiés les combattants de la guerre 14-18 et notamment les combattants juifs qui la conservèrent à leur retour dans leurs foyers.
• • •
Le 31 rue de France à Tlemcen. « Collocation à l’ancienne ».
« LA MAISON DE NOUNA ».
A Tlemcen, ma grand’mère Nouna, après la mort de son mari Abraham, en 1927, a dû quitter l’appartement d’un immeuble bourgeois 2 rue Clauzel pour un modeste appartement dans un petit immeuble à un étage de l’artère principale, 31 rue de France, où elle vécut une dizaine d’années.
En 1930 Léa et Marc Laïk partagèrent, après leur mariage, avec Nouna et ses deux filles célibataires de 16 et 23 ans, Germaine et Berthe, 3 puis 4 pièces regroupées. L’une des pièces à l’origine indépendantes, fut occupée avant eux par un marchand de tapis arabe M. Bestaoui, puis par la famille d’un adjudant.
En 1939, « la tante Haloua» Moutout, qui avait recueilli, après la mort de sa sœur Julie en 1938, à 34 ans, les deux orphelins Henri et Huguette, ses neveux, encouragea le mariage de son beau-frère veuf Gaston Sebban qui vivait à Oran, avec sa cousine germaine Berthe encore célibataire à 32 ans.
Berthe et ma grand’mère partirent alors pour Oran avec les enfants. Elles vécurent 22 rue de Wagram dans le quartier juif à la pire période, sous Vichy.
Pensionnaire à Tlemcen de 1948 à 1952, j’ai bien connu « la maison de Nouna » à Tlemcen où habitait toujours la famille Laïk.
Le propriétaire Bouali Mohamed était arabe, les locataires, arabes et juifs.
Le 31 rue de France était un petit immeuble ancien, à l’architecture hybride, composite, compliquée : deux maisons mauresques sur cour ouverte imbriquées l’une dans l’autre à deux niveaux différents (entresol et 1er étage) qui ne communiquaient pas du tout entre elles et une façade sur la rue de style européen avec balcon en fer forgé pour un appartement seulement.
Dans le corridor d’entrée, à droite, un double bassin-lavoir en pierre, point d’eau commun aux locataires. Ce long corridor vétuste étroit et sombre à l’odeur que seul Balzac pourrait définir, menait à un escalier déjeté qui débouchait, à l’entresol, sur une porte à peine visible dans l’obscurité qui donnait accès à 3 pièces sans fenêtres et cuisine autour d’une courette à ciel ouvert, sans aucune communication avec le reste de la construction ni ouverture sur la rue. Une famille Lévy, père matelassier en tenue traditionnelle, chèche et sarouel, fils mécaniciens tôliers, en étaient les seuls locataires. Le surnom Clovis de Henri l’un des trois fils* témoigne au moins qu’on apprenait à l’école l’histoire de France et « nos ancêtres les Gaulois » ! Une des sœurs, par contre, Zhari : « ma chance » avait conservé un mélodieux prénom judéo- arabe. Par désir d’assimilation et pour figurer sur les registres d’Etat Civil, les prénoms arabes étaient traduits : Johar: Perle, Perlette ; Sultana : Reine, Reinette ; Chabba : Blanche ; Haloua : Douce ; Ouardia : Rose, prénoms courants chez les femmes juives. Mais que faire de « ma chance » en français ? Fortunée !**
Au 1er étage, sur une passerelle intérieure au-dessus d’une autre cour à ciel ouvert un 2ème appartement avec une façade sur rue et balcon en fer forgé, celui de ma famille. On accédait au toit- terrasse par un escalier en bois très raide. Toute petite terrasse, aire de jeux des enfants.
La porte d’entrée de l’appartement de ma famille et deux fenêtres s’ouvraient sur la passerelle, ainsi que des W.C. turcs extérieurs. A l’intérieur de l’appartement, il n’y avait ni W.C. ni salle d’eau. Seulement un évier dans une grande cuisine.
Plus d’une fois, l’été 1948, nous avons, aux aurores, enjambé la fenêtre de la chambre d’enfants, à l’insu de Marc, et rejoint Roger HaggaÏ pour une randonnée d’une heure ou deux vers la villa Marguerite ou la villa Rivaud.
Marc voulait ses enfants à l’atelier et pas en promenade. Pour apprendre « un vrai métier », il les avait retirés de l’école prématurément malgré leurs bons résultats.
Au rez de chaussée, sur la cour intérieure avec des W.C. turcs, vivait une famille arabe dans une seule grande pièce sans fenêtre, cloisonnée avec des étoffes chamarrées et tapis qui pendaient du plafond. Marnia, la mère, avait trois garçons et une fille. L’un des garçons, Cheikh, prit deux femmes et dut quitter la cour avec son harem pour une chambre à l’étage. Parfois l’un des garçons entrait ou sortait de prison pour de petits délits, plus tard, l’aîné Mohamed militant actif du F.L.N. rejoignit le maquis et fut tué pendant ce que nous appelions « les événements».
A l’origine, de nombreuses familles vivaient souvent dans une seule pièce sans fenêtre. Le jour, on entassait les nattes, tapis et matelas de la nuit dans un coin et la cour à ciel ouvert était le lieu de vie collective. Les W.C. turcs toujours extérieurs étaient communs aux différents locataires, comme les points d’eau limités à 1 ou 2 par maison. Les toilettes se faisaient au bain maure. Les cuissons au four banal.
Dans la cour, la mère Marnia et la fille Fatiha, vêtues de gandouras bariolées comme toutes les paysannes berbères, accroupies sur leurs talons, cuisinaient sur leurs kanouns au charbon, roulaient le couscous, pétrissaient le « khobz ‘t- tadjine »*** dans des kesras en bois, lavaient le linge,
la mère coiffait sa fille longuement, la famille se disputait, le mari courait après les rats avec une matraque. Toujours en bonne entente avec la famille juive qui habitait à l’étage sur la passerelle en surplomb de leur cour.
Le mari, un militaire, avait monté une cabane adossée à un mur de la cour qui avait cédé à la pression et, par le trou béant, grossièrement dissimulé avec planches et chiffons, on pouvait apercevoir le spectacle coloré du « fondouk », en face du Collège de Slane, caravansérail qui servait au parcage des bêtes de somme des fellahs de la région. Les jours de marché, les arabes arrivaient avec leurs ânes, leurs mulets, leurs chevaux. On entendait braire les ânes désespérés. Du côté de la mosquée, les cigognes claquetaient.
A l’étage, au bout de la passerelle, un jeune homme employé à la poste B. occupa, un temps, avec sa sœur une seule grande chambre et un réduit vitré comme une serre, qui servait de cuisine. Sa mère et sa tante, une vieille fille, se chargeaient de l’entretien. Elles venaient de loin, aussi passaient-elles par les coursives des toits à tuiles romaines et terrasses et enjambaient, au niveau d’une terrasse, la fenêtre à l’autre extrémité de la chambre pour gagner du temps. On passait ainsi de maison en maison, par les toits et terrasses, comme à la Kasbah, au grand dam des habitants des cours ouvertes qui voyaient défiler toute sorte de silhouettes au-dessus de leurs têtes, des garnements surtout et hurlaient des menaces et des mises en garde : « vous allez vous tuer ! Attends ton père ! »
Une Dame Kheira, aux opulentes chairs laiteuses et nacrées, un peu cartomancienne, leur avait succédé. Kheira fumait, recevait un gras marchand arabe moustachu qui l’entretenait et qui passait très vite sur la passerelle vers l’escalier, en évitant nos regards, jaloux de sa réputation et de sa respectabilité.
L’été Kheira laissait, sur la passerelle, de l’eau chauffer au soleil dans une grande lessiveuse, puis s’immergeait complètement sous les yeux des voisins qui n’avaient plus qu’à détourner leur regard. Ses ablutions terminées, elle retournait la lessiveuse pour la laisser sécher.
 Au milieu de tapis, de tentures, de coussins chatoyants, hôtesse souriante, elle offrait thé à la menthe et loukoums parfumés en « tirant les cartes ». Au milieu de tapis, de tentures, de coussins chatoyants, hôtesse souriante, elle offrait thé à la menthe et loukoums parfumés en « tirant les cartes ».
Dame Kheira était avenante et aimait bavarder avec nous, pensionnaires en sortie, le dimanche.
Il m’est arrivé de prendre le thé dans son repaire, peint à la chaux bleue, à même le sol, sur d’épais tapis, enfoncée dans un de ses gros coussins de soie ou de satin aux couleurs criardes, d’où se dégageait une forte odeur tenace de parfum de courtisane orientale, mélange entêtant de violette, de patchouli, de musc et d’épices fortes.
Elle se pliait au rituel du thé servi trois fois, brûlant et très sucré, levant et abaissant la théière au-dessus de verres multicolores à délicats motifs berbères, pour faire monter l’écume, le « turban », dans l’odeur fraîche du thé vert à la menthe qui dominait alors.
Dupe consentante, j’ai accepté ses prédictions : amour, mariage, bonheur et voyages lointains !
Un gardien de la paix Emmanuel Esteban dont les parents tenaient une épicerie en face, lui succéda un temps dans la chambre, après son mariage avec Melle Serna, la fille d’un brigadier de police, juste avant Cheikh et ses femmes. Mes cousins Laïk se souviennent d’un couple mixte arabo-espagnol Zarga, locataires éphémères d’une pièce, dont le mari, un adjudant, avait durement, cruellement corrigé à coups de sa cravache sa fille adoptive Ginette qui avait chapardé chez eux quelques friandises exposées dans un compotier sur un buffet, en enjambant une fenêtre ouverte. La malheureuse Ginette dut en outre les restituer.
Cette maison a été modernisée et la façade avec balcon sur la rue modifiée. En 2003, j’ai reçu une photo de la façade restaurée. La légère grille en fer forgé du balcon avait été remplacée par un opaque garde-fou en béton à l’abri des regards sur lequel s’ouvraient désormais, sur toute la façade, les 4 fenêtres. La façade d’entrée de l’immeuble flambant neuf, embellie avec des parements de marbre. L’immeuble avait gardé le numéro 31.
Juillet 2009 : l’immeuble est en démolition. Il n’a pas résisté aux travaux bétonnés de transformation. Il s’est effondré !
Et aussi je pense que cette architecture n’était plus adaptée aux exigences du XXIème siècle et que, en architecte avisé, et vu la vétusté et fragilité de l’ensemble, il valait mieux tout raser.
 |
Avant travaux : petit balcon en fer forgé. |
Après travaux : balcon opaque à l’abri des regards, en béton, sur 4 fenêtres |
|

Un fondouk de Tlemcen
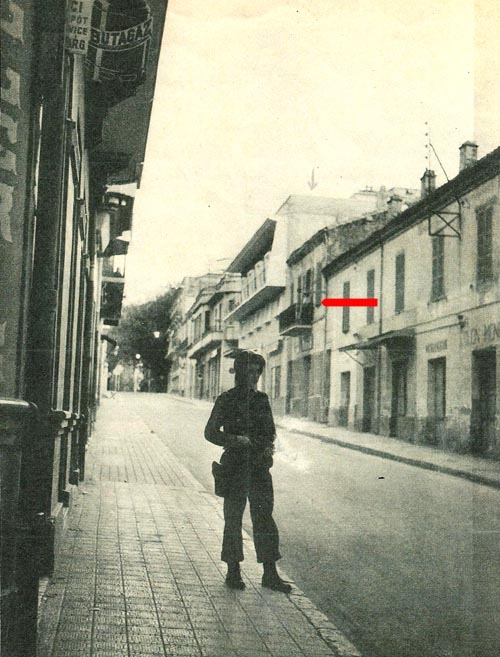
Pendant les « événements »
Photo parue dans Paris Match n° 372 du Samedi 26 mai 1956.
Sur le premier balcon en fer forgé à droite, au 31 rue de France, se trouve ma cousine Claire.
Comme la « maison de Nouna », toutes les maisons anciennes du quartier étaient de conception hybride : maison mauresque avec cour intérieure ouverte et façade à l’européenne. On peut suivre d’après la répartition de l’espace occupé et son évolution dans le temps, les changements dans les mentalités, le mode et le niveau de vie. Au moment de la construction, probablement au milieu ou fin du XIXème siècle, chaque famille ne disposait souvent que d’une pièce, puis des regroupements ont été opérés par 2 ou 3 pièces. C’est ainsi que dans les années 1930, au 31 rue de France, deux familles juives seulement occupaient des pièces qui s’articulaient plus ou moins bien et gardaient, chacune, une certaine autonomie. C’est le cas de l’appartement de Nouna (3 puis 4 pièces).
L’autre famille disposait de 3 pièces sans fenêtre, réparties autour d’une cour individuelle. Les autres locataires, souvent provisoires, s’accommodaient d’une pièce. Et sur la cour la famille de Marnia.
J’espère bien qu’on m’enverra un jour la photo de la construction moderne qui a pris la place de la « maison de Nouna. »
*Jacky et Elie prénoms des 2 autres frères ; les filles : Perlette (prénom diminutif traduit de l’arabe « Johar » : perle, très courant chez les femmes juives), Nanou et Zarhi : ma chance que la famille n’a pas traduit.
** Elie Kakou avec sa Fortunée Sarfati a rendu, plus tard, ce prénom fréquent chez les femmes juives au Maghreb, ridicule et inutilisable.
***Galettes de pain à la semoule.
Claude
Notre Babel.
Je me risque, par jeu, à un mince florilège sans prétention, à compléter avec la liste des insultes et malédictions que j’ai déjà citées.
Certains mots et expressions faisaient partie de l’usage courant chez nous : arabe, espagnol, italien, hébreu.
Menaçant : « je vais te donner une tré’ha mémorable ! » (tré’ha : raclée)
Nostalgique, avec un soupir de regret : Ya’hassra : « c’est bien fini ! Hélas ! »
Fataliste : résigné : « lé fet mèt » : le passé est mort !
Ironique avec un air entendu :zarma ! Soi-disant, je ne suis pas dupe !
Excédé, insultant : « samet ! »: « casse-pied ! Tu es lourd ! »
Joyeux, chaleureux : « Sa’ha ! »ou « Besa’ha » : bravo ! Félicitations !
mazal Tov (hébreu !)
Méprisant : « Nechafa ! » : serpillière ! C…molle ! lâche !
Méchant humiliant : « Tchato ou Tchata, » : nez épaté ! (espagnol).
« Sloughi ! » : « tu es maigre comme un sloughi ! Tas d’os ! ».
• • •
Le 44 rue Thiers

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Vers 1900

Aujourd'hui
|

•
Au premier plan, le 44 rue Thiers où nous habitions, au 4ème étage, avec ses arcades, la terrasse bien visible sur cette carte ancienne et le grand hangar blanc à côté qui abritait un cheval, une carriole et le gardien.

Une photo récente sur laquelle on distingue mieux la terrasse, son
toit et la fameuse cheminée : « notre aire de jeux ». Le hangar et son cheval a disparu, désormais on voit des autos ! Les immeubles sont beaux, tout crépis de blanc avec des volets bleus, et le paysage est toujours sublime ! 
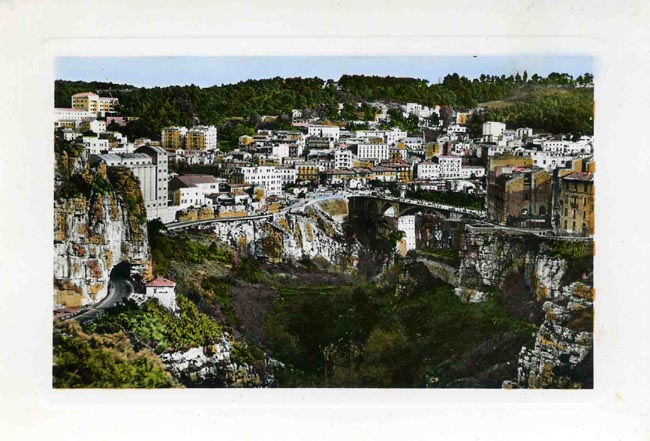

|


