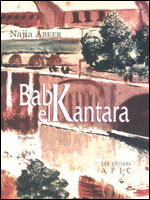Najia Abeer : ses ouvrages
• • •
21 juin 2011 : les 3 ouvrages de Najia Abeer sont disponibles sur le site de la FNAC
• • •
La carrière d'auteure de Najia Abeer aura était très courte. Entre son premier et son troisième et dernier ouvrage, il ne se sera passé que moins de trois ans. Moins de trois ans pour trois livres. Des projets elle n'en manquait pas. Ils ne seront jamais réalisés !
 Janvier 2003, parution de son premier ouvrage :
Janvier 2003, parution de son premier ouvrage :
Constantine et les moineaux de la murette
(Récit) - Éditions Barzakh, Paris, 2003
Évocation des moments d'insouciance, du temps de l'innocence sur fond de guerre d'Algérie, son récit, tissé de réminiscences, prend aussi parfois une vraie dimension documentaire, mentionnant les métiers disparus, les quartiers et traditions, la bigarrure propres à cette ville.
Cet ouvrage était la première partie de ce qui devait être une trilogie.
Dz-Lit 27 juin 2004
Recension de Max Véga-Ritter
Contantine et les moineaux de la murette se présente comme l’évocation du monde d’une petite fille à travers une suite d’anecdotes piquantes, de souvenirs chatoyants, d’incidents pittoresques ruisselants du bonheur d’une enfance trépidante. Le nid de parents cigognes sur le toit, la soupente transfigurée où dorment la narratrice enfant, sa tante et sa jeune sœur, les poupées en bout de bois qui captivent la tendresse ont la verve et la poésie de David Copperfield, des joues rouge de Peggotty, de l’arche enchantée sur la plage de Yarmouth. La maison traditionnelle constantinoise, avec sa cour centrale, son unique fenêtre soigneusement voilée sur la rue, dans la vieille ville de Constantine, la Souika, baigne dans l’atmosphère pleine d’humour d’une famille chaleureuse avec les tantes et cousines sur lesquelles président la grand-mère et le père instituteur. La rue, loin d’être un lieu étranger, prolonge et embrasse la demeure familiale avec ses métiers familiers, l’artiste avec ses figurines, le boulanger, le mozabite etc. On songe à un Dickens qui serait profondément arabo-berbère. Plus tard la scène se transporte dans l’immeuble d’une école française publique en limite de la ville européenne, cerné d’un espace impersonnel régi par des règles abstraites, les jeux et les rites d’une autre société, celle des européens.
Le roman paraît ainsi, à première vue, comme traversé par une fracture, celle du basculement d’un monde à un autre ordonné par des rites et des conventions différentes, fait de cohabitations bon enfant mais sous le coup de menaces et d’hostilités permanentes, d’une domination plus ou moins feutrée ou pesante, celle des européens sur les « indigènes ». En réalité le roman ne se borne pas à cela. Il y a là, sous-jacent, la naissance et le mûrissement de l’esprit d’une petite fille au contact des réalités cruelles mais à l’occasion chaleureuses de la colonisation et de ceux qui l’incarnent. La guerre d’Algérie est là, lancinante, taraudante ou violente dans son surgissement dramatique : la réunion secrète de conjurés, le pourchassé aux abois que l’instituteur français prend sous sa protection. La petite fille perçoit, intègre dans son imaginaire les détails qui la frappent, l’épouvantent, l’émeuvent, la bouleversent.Tout un itinéraire intérieur est ainsi saisi, évoqué, auquel le lecteur participe.
Cependant sous la chronique d’une enfance vécue dans la guerre, sous la cohabitation dans l’inégalité de deux sociétés, sous le passage douloureux d’une culture à une autre, au contact d’un monde à la fois hostile et parfois bienveillant, il y a comme une topographie souterraine, des cheminements obscurs mais irrésistibles. On sent dans les profondeurs sourdre une interrogation, celle de l’enfant mais aussi de la femme, sur l’identité de celle-dernière, sur son être, sur l’amour, sur la filiation, sur les mystères dont les adultes enveloppent les actes de la vie. La violence éclate brusquement au détour d’une scène banale pour projeter sur le devant de la scène le secret qui hante, la passion qui a été tue mais qui n’a jamais été éteinte sous le poids des coutumes et des habitudes. C’est avec pudeur et retenue que l’angoisse du cœur et de la vie est évoquée : Constantine, ses précipices et ses passages dissimulés, son passé tourmenté et ses maisons serrées autour de la zaouïa au-dessus de l’abîme, sert de masque transparent et de visage aux interrogations qui hantent le présent.
Un beau roman féminin, émouvant sous sa gaieté, subtil et complexe dans sa simplicité, profond sous son naturel.
Max Véga-Ritter
Professeur émérite
Clermont-Ferrand
• • •
Constantine au cour !
C'est par l'intermédiaire des « Amis de Constantine* » que j'ai fait la connaissance de Najia Abeer , née la même année que moi, Professeur d'anglais et Auteure, constantinoise militante, habitant actuellement Alger qui a écrit un superbe livre sur sa jeunesse à Constantine : « Constantine et les moineaux sur la murette ». Najia qui est devenue une amie, que j'ai rencontrée au mois de Mai 2004, à Constantine, avec qui j'ai passé des moments émouvants. Najia, la généreuse qui s'est mise au service de mon projet et qui s'enthousiasme autant que moi.
Najia, avec qui je peux parler de tout et avec qui j'ai à présent de plus en plus de complicité.
Najia, avec qui j'ai passé 2 jours, à travers la lecture de son très beau roman, avant d'effectuer mon retour au « Bled ».
Najia qui m'a offert Sa « Souika » en mai 2004, en me la faisant découvrir.
Comment dire ce que je ressens ? Comment traduire des sentiments enfouis et remis au jour ? Les mots n'ont pas toujours la force de la Vie et pourtant elle a si bien dit les choses !
Je me suis refais mon parcours en parallèle avec le sien, puisque nous sommes nés la même année, et tout ce que tu dis, Najia, est juste, fort et sans fard. Simplement, tu t'en doutes, en ce qui me concerne les influences étaient ailleurs et, tu le sais bien, nous n'avions pas le choix.
J'ai été très touché par la description de l'ambiance de la ville qui, au fil des années, s'est dégradée, a été empoisonnée, mais n'a jamais été tuée puisque s'il restait de bons roumis , il y avait aussi les « bons arabes » . C'est vrai qu'on en était réduit à ça et, pour nous, gamins de cette époque douloureuse, la recherche identitaire a pris des chemins dévoyés et les rigoles sur le bord de nos routes sont devenues, trop souvent, des fossés.
Dans un autre registre, j'ai beaucoup aimé les descriptions de ce que je n'ai pas vraiment connu, pour cause de guerre. J'ai, je crois enfin situé la Souika (affreusement dénommé « village arabe » sur les plans coloniaux !), si chère au cour de Najia et le quartier Sidi El Djellis. Souika est située en contrebas de la place Lamoricière, sous Sidi Rached et Ben Djellis vers le quartier juif.
En tous cas, elle a su trouver les mots pour parler de la maison familiale qu'elle a quittée pour aller à Sidi El Djellis et, si j'ai bien compris, à Sidi Mabrouk.
Cette chronique d'une enfance vécue est très touchante. D'abord parce que de très nombreux souvenirs extraordinairement précis jalonnent le récit et puis parce que l'on comprend très vite tout l'amour de la narratrice pour sa ville. On y suit la jeunesse d'une petite fille arabe que la guerre, si hypocritement appelée « évènements », sépare de plus en plus de la communauté française. Elle devient bouleversante quand le lecteur réalise que Najia est à la recherche de ce qui a pu la séparer de son Rocher (Constantine est bâtie sur un rocher, ce qui en fait tout son charme), puisqu'elle est « expatriée » sur Alger depuis de nombreuses années. C'est dans la chronique familiale que se trouve la clef.
Dans ce roman, l'Auteure part à la reconquête de l'antique Cirta, comme si la ville des ponts l'avait répudiée. Au fil des pages, le lecteur occidental trouvera un excellent guide de Ksentina et celui qui a des souvenirs à partager communiera avec cette enfant élevée pour une bonne part dans la « Souika » et ayant fréquenté les européens grâce aux différentes écoles qu'elle a fréquentées avec son pédagogue de papa, successivement instituteur, directeur et conseiller pédagogique, féru d'Histoire.
Une grande vertu de son livre est de montrer la place que doit occuper l'Histoire dans nos existences. Cette place qui a manqué à ce Peuple algérien, je l'ai constaté lors d'un voyage en 84, pour s'approprier son pays et, au-delà de la libération du joug colonial, forger une vraie identité politique. Ben Bella a vraiment fait preuve d'une naïveté coupable qui a permis le phénomène Boumédiène, qui n'a pas arrangé les méfaits subits par notre Pays, après la France.
C'est un livre attachant, sensible, premier tome d'une trilogie dont le second volume est achevé et devrait donc être édité dans les mois à venir, en 2005. On le lit d'un trait, avec les odeurs de cette ville magique et ses bruits témoins du quotidien de cette cité imprenable, certes asse z conservatrice, mais si hospitalière, aux habitants fiers et généreux. Cette générosité, on la retrouve à chaque page de livre merveilleux.
Yahia - Jean-Michel Pascal (également Constantinois et fier de l'être)
• • •
Le Soir d'Algérie 16 décembre 2003
Un voyage dans les racines du temps
Errer dans sa ville natale, croire en connaître chaque coin de rue et n'y reconnaître personne est une aventure maintes fois renouvelée et bizarrement excitante. Chaque été, je revois et dévore des yeux cet immense rocher avec la même avidité, le même plaisir et le désir intense de garder dans ma tête une vue d'ensemble que je ne suis jamais parvenue à cadrer. Constantine, tu me fais souffrir, est-ce que tu le sais ? .." C'est une fenêtre qui s'ouvre sur la vie de l'auteur, peut-être une parenthèse qui avait besoin d'être refermée, un retour aux sources, revivre l'instant d'un roman ses souvenirs d'enfance, marcher dans ces ruelles, essayer de reconnaître ces maisons, ces passants.
Seul demeure le rocher qui surplombe la ville, immuable gardien de la cité et de ses habitants. Najia Abeer, à travers son ouvrage, désire au plus profond d'elle-même redonner à son passé mêlé à l'encre de son stylo une existence réelle. Désormais, sa mémoire s'éveille et ses souvenirs sont retranscrits sur le papier. Le cour rempli de nostalgie, elle nous fait le récit d'une époque qui n'est plus, de traditions que l'on ne reconnaît plus. C'est sur un fond de guerre que son quotidien se dessine et que nous lisons entre les lignes. On a cette impression étrange d'apercevoir les vieux quartiers de Souika et de la citadelle éternelle d'où nous parviennent de temps à autres les cris d'une naissance étourdie et innocente. Lorsque revenue sur les pas de son passé à la poursuite d'une trace ou d'une empreinte de vie qui aurait marqué son passage, elle s'émerveille enfin face à un clou, qui jadis avait déchiré la m'laya de sa grand-mère. Heureuse, elle avait grandi ici, et la belle Cirta s'en souvient. De sa rencontre, un jour avec les frères, de la terreur quelle avait éprouvée, de Zazi et son irresponsable mari, qui lui a légué un gosse avant de prendre la poudre d'escampette, des maisons violées et des brusques assauts de l'armée française . Tant d'histoires à ne jamais oublier, tant de bonheur saisissant d'un voyage dans les racines du temps. Un roman fait d'une description parfaite, une autobiographie de la vie d'une femme, une Algérienne qui met à nu son existence dans une ville reconnue plus que conservatrice, d'un pays profondément ancré dans un rituel mutisme fait de tabous. Qui de nos jours n'a pas envie de se retrouver dans les bras de son enfance, plongé dans l'insouciance et la facilité à résoudre les situations les plus complexes par des mots purs, parce que en nous et au cour de nos âmes réside ce besoin de chaleur qui s'est éteint, il y a tellement de temps. Un témoignage que gardent certainement tous les expatriés dans leur mémoire, celui d'un village ou d'un pays qu'ils auraient quitté un jour sans retour puisqu'à jamais leur départ aura brisé les larmes d'une terre qui les a vu naître et surtout partir. Najia Abeer est née en 1948. Elle est professeur d'anglais. Actuellement, elle vit et travaille à Alger. Constantine et les moineaux de la murette est son premier roman.
• • •
Sam H. Le Jeune Indépendant 26 août 2003
Un cri, une mémoire
Par Belkacem Rouache
L'auteur Najia Abeer plonge dans son passé vertigineux pour évoquer sa ville natale, Constantine, qui l'a bercée, mais aussi malmenée à force d'amour qu'elle lui porte. Mais au fil des temps, on s'aperçoit qu'on ne garde que les bons souvenirs de son enfance.
Il s'agit donc là d'un roman qu'elle vient de publier aux éditions Barzakh et qui porte le titre : Constantine et les moineaux de la murette. Dans ce récit, Najia Abeer invite le lecteur à un voyage à travers cette ville bâtie sur un rocher, agrémentée par ses ponts suspendus, ses ruelles tortueuses, ses souks aux odeurs pimentées et ses murs dont chaque pierre garde un secret, une histoire lointaine.
Et à force de détours, on se perd dans les dédales de cette ville bruyante. Dans ce voyage, l'auteur entend des voix qui lui parviennent de partout : "Je voudrais crier mes liens avec ces murs, ces pavés, mais ma voix éteinte fond et coule dans ma gorge." La narratrice poursuit sa quête qui la mène sur le chemin de l'école qu'elle a fréquentée, avec cette âme innocente d'une indigène humiliée dans son propre pays.
Mais les jeux sont là pour lui faire oublier toutes les tracasseries de la vie d'une enfant encore insouciante. Nostalgie d'une ville qu'on perd, qu'on retrouve avec ses odeurs de f'tour, son architecture et ses traditions.
"La rue était notre espace, un lieu qui nous apprenait la vie dans toutes ses libertés." Dans un style simple, l'auteur s'attarde dans la description des lieux, des sensations et des odeurs qui se dégagent des ruelles et des souikas.
"J'arpente cette rue d'un pas faussement décidé et d'un air curieux, comme ce touriste en quête d'une histoire étonnante à raconter à ceux qui sont restés." Ce livre prend parfois une dimension documentaire tout en gardant son aspect autobiographique.
A travers ce récit, Najia Abeer nous fait revivre des moments pleins de douceur et d'harmonie entre les êtres. Elle est née en 1948 à Constantine. Professeur d'anglais, elle vit à Alger. Ce roman est son premier ouvrage. Rétrospective, machine à remonter le temps, Constantine et les moineaux de la murette est un livre qui nous tient en haleine : la mémoire toujours présente comme ce "cri déchirant d'un être arraché d'un autre être dans un vagissement plaintif".
B.R.
• • •
Liberté 29 mai 2003
Si mon enfance m'était contée
Par Nassira Belloula "Comme toutes les villes dont le passé se noie dans la nuit des temps, la ville porte en son sein, ce rocher, des secrets jusque-là sujets à controverses interminables".
Avec courage, avec obstination, Najia réveille sa mémoire et sonde ses pensées en traçant, sur papier, des émotions, des incertitudes, des espoirs et des contraintes aussi.
L'histoire de sa ville semble liée à sa propre histoire et elle tente d'extirper d'un rocher de pierreries, mais de vie aussi, d'effervescence et d'effluves, un quotidien que l'oubli happe au passage du temps.
Najia se souvient de sa ville, des ses quartiers ancestraux, de ses maisons, ces "éli" qui se ressemblent toutes, de l'histoire de ces artisans aux doigts habiles forgés comme le rocher de Constantine, alourdi pourtant par tant d'âme déchues, celles qui avaient fui l'enfer des campagnes bombardées par les français, celles qui s'étaient établies plus tard, à l'indépendance, mangeant de ce rocher qui s'effrite comme la mémoire. "Depuis cette ruée vers l'espace, les anciens quartiers européens du centre-ville furent assimilés par les plus vieux, les bourgs sont devenus faubourgs et ces derniers sont devenus cités", écrit Najia Abeer.
L'enfance, la souffrance, l'innocence et la femme sont au centre de cette réminiscence de la mémoire de l'auteur qui livre ici dans son premier roman paru aux éditions Barzakh, un héritage singulier, le sien. Elle n'hésite pas à aller au fond des choses, à rentrer dans l'intimité d'une écriture profonde, la sienne certes, mais parfois détachée d'elle, car elle use de ce jeu narrateur avec subtilité, nous forçant à voir dans ce récit, une autre Najia, celle qui erre dans sa ville natale, sans reconnaître chaque coin de rue, sans reconnaître les gens.
L'auteur souffre de ce qu'est devenue sa ville "Constantine, tu me fais souffrir, est-ce que tu le sais ?"
Et c'est autour de cette douleur d'une transformation incompréhensible, qui réduit tout, que l'auteur tisse son roman, et Constantine est aussi cette Algérie qui perd ses repères.
N. B.
 L'Albatros
L'Albatros
(Roman) - Éditions Marsa, Alger, 2004
Dans une petite ville non loin d'Alger, Nedjma mène une lutte acharnée contre la dépression et la mort, pendant que Haoua se fait prendre dans la toile islamiste en train de se tisser. Deux femmes, deux destins, deux chemins qui se croisent pour mieux se séparer. L'histoire déchirante d'une raison qui chavire, d'un coeur qui s'affole, d'un pays qui tremble.
Le Jeune Indépendant 2 avril 2005
Ferveur de vivre
par Belkacem Rouache
Najia Abeer vient de publier son deuxième roman, l’Albatros, aux éditions Marsa. Dans ce livre de 334 pages, elle relate l’histoire de deux femmes qui se battent chacune à sa manière pour l’existence. Elle régnera ici le temps de l’écriture avec des arrêts sur images, de souvenirs d’amies présentes ou déjà envolées, une petite ville non loin d’Alger avec son air marin, ses hommes de la terre et de la mer, ses sites historiques et ses résidences secondaires qui retrouvent leurs propriétaires chaque été.
Dans son ouvrage, Najia Abeer met en avant ces femmes combattantes, révoltées, ou tout simplement des femmes qui ont eu le courage et la volonté de briser certains tabous. Comme son amie Bariza qui a choisi le métier de pêcheur pour nourrir ses enfants.
Cette «albatros» qui brave vents et vagues, les misogynes ont mis du temps pour l’accepter, d’autant plus qu’elle était belle et portait des bottes en caoutchouc. Il s’agit donc d’un fragment d’histoire de cette femme qui a «péché» en osant pratiquer un métier réservé jusque-là au sexe masculin.
Il y a aussi Chérifa qui s’adonnait à n’importe quel travail pour nourrir ses huit enfants et son mari atteint d’une maladie chronique. Les personnages ont vingt ans, trente ans ou plus, alors on vieillit, on fuit, on abdique ou on pleure dans ce monde sauvage.
Najia Abeer développe l’éternel mal du siècle et joue avec habilité de son talent. «Pendant plusieurs années consécutives, elle avait subi des incidents étranges qui survenaient à la même période de l’année. Le feu avait emporté l’un de ses enfants et, l’année suivante, il avait détruit son atelier.» Ici, l’auteur décrit ce monde cruel où se mêlent la peine et le tragique comme des données irrécusables.
Elles sont associées à une sorte de puissance fabuleuse où se jouent l’humour et l’admiration. Puis, de fil en aiguille, l’auteur présente cette femme couturière, qui se bat elle aussi contre l’injustice, la marginalisation. Le roman raconte la condition de la femme en Algérie avec des personnages qui luttent contre la dépression et la mort, mais qui ont aussi des coups de folie et des coups de cœur.
Najia Abeer est née à Constantine en 1948. Après des études universitaires aux Etats-Unis, elle enseigne au Moyen-Orient et en Algérie. Elle est spécialisée en littérature américaine. Elle est actuellement professeur d’anglais à Alger.
Son premier roman s’intitule Constantine ou la murette. Comme on dit, «la littérature prolonge la vie, l’éclaire, la sauve» et l’écriture pour Najia Abeer est avant tout une évasion. Dans ce livre écrit dans un style fluide, elle peut déjà nous toucher par sa vive imagerie des événements, des êtres et des objets, dans ce monde terrible et merveilleux où l’homme ne connaît pas de limites.
B. R.
• • •
Liberté 8 novembre 2004
Une œuvre de résistance
Par Nassira Belloula
Najia Abeer a signé un roman très “sociologique”, puisant sa force dans le quotidien qui nous entoure.
De son retour d’un voyage à travers le passé avec “Constantine et les moineaux de la murette”, Najia Abeer nous entraîne avec “L’Albatros”, son dernier roman, dans un univers effrayant et attachant à la fois, celui de la femme qui prend corps dans plusieurs personnages déroutants, passionnants, rebelles et pathétiques, peints dans la toile de Abeer avec délicatesse et force.
Le symbolisme onirique soutenu dans l’œuvre de Camus, de Dib (Qui se souvient de la mer) lié spécifiquement au rapport passionnel de l’auteur avec la mer (Méditerranée) nourricière et inspiratrice donne la substance littéraire à Najia Abeer qui, symboliquement, prend son point de départ d’un lieu mythique, la mer, qui, souvent, est assimilée à la femme, et les deux restent intimement liés métaphoriquement parlant pour entamer son roman. El-Marsa, lieu de départ de la fiction, est une ville côtière comprimée entre la mer et le giron des femmes qui vont naître sous la plume de Najia Abeer dans une histoire déchirante d’une communauté de femmes et d’un pays aussi. Les personnages multiples sont des portraits croqués sur le vif. Il y a la narratrice Nedjma qui utilise le J pour nous entraîner dans les profondeurs de ses sentiments, d’une vie intérieure, en somme, déchirée par la maladie et la dépression, prise dans le tourbillon des vertiges et des antidépressifs.
Une situation difficile à assumer par le professeur qu’elle était et qui faisait de son métier le centre de sa vie. Pour nous, c’est évident, c’est Nedjma l’héroïne du roman, vu que c’est elle qui nous accompagne de bout en bout du roman, mais pas pour Najia Abeer qui m’avoue qu’“en vérité, la véritable héroïne du roman, c’est Haoua”. Haoua, c’est la femme libérée prise dans la toile islamique qui s’est mise à organiser des halaquate chez elle. Elle ira jusqu'à changer le nom de sa fille Sabrina contre celui de khadidja. C’est la rupture entre les deux amies élevées pourtant à la philosophie de Voltaire et de Michard et que le destin (la fatalité islamiste) va séparer.
Nedjma, patiente, va nous faire entrer petit à petit, au fil des pages, dans d’autres maisons, d’autres “coins” pour entrecroiser les pas de Bariza, une femme étonnante, forte de caractère et d’esprit, une femme pêcheuse qui brave la mer et les tabous avec courage, puis viennent Basma, l'écolo protectrice des animaux, Faouzia, la superstitieuse, Aïssa, l'exorciste, Debby, la coiffeuse, Nora, la domestique, tout un univers haut en couleur, très riche. Et Najia Abeer excelle dans la description et surtout la création de personnages non pas hors du commun mais conformes à la réalité, à une société en ballottage entre deux projets de société, le moderne et l’archaïque, le bien et le mal, la soumission et la lutte, deux concepts si bien incarnés par Haoua et Bariza. Najia Abeer sonde à sa façon cet univers féminin. En attendant, elle exorcise ces années de terreur, ces années de folie en rêvant à un monde meilleur, où les femmes ne seraient pas que des figurantes, enfermées, comme elles le sont dans son roman, dans un univers de traditions, seules à lutter contre leurs démons, emprises avec leurs quotidiens singuliers, n’évoluant que dans une sphère privée : les fêtes entre femmes, le coin des femmes à la prière du vendredi à la mosquée, l'intervention de l'exorciste. Najia Abeer a, encore une fois, signé un roman fort, très “sociologique”, puisant sa force dans le quotidien qui l’entoure, qui nous entoure en abordant tous les thèmes qui ont fait de ce pays ce qu’il est, un pays dans l’impasse face à une crise qui perdure. L’éducation, le Coran, le concept idéologique, le statut de la femme, les tabous, les traditions….
L’Albatros est un beau roman féminin, en réalité, c’est plus qu’un roman de femme, touchant par son humour, délicat et complexe dans la diversité de ses personnages et profond dans sa radioscopie de l’univers féminin et la société en général.
N. B.
• • •
Dz-Lit 3 octobre 2004
Recension de Max Véga-Ritter
Le nouveau roman de Najia Aber, L'Albatros, nous entraîne dans un monde tout aussi peuplé de personnages croqués sur le vif que celui du précédent. Haoua, la femme libérée devenue islamiste, Basma l'écolo protectrice des animaux, Faouzia la superstitieuse, Aïssa l'exorciste, Debby la coiffeuse, Nora la domestique femme de confiance, sans compter les amies de coeur qui viennent vous soutenir dans la détresse, la rebouteuse-devineresse, le psychiatre, le voisin médecin d'un trop bon secours mais finalement de conseil utile, tout un monde d'hommes et surtout de femmes hauts en couleurs, débordants de vie, truculents, qu'on sent sortis tout droits de l'Algérie d'aujourd'hui, viennent défiler sur le devant d'un théâtre à la Dickens, exécuter leurs numéros et céder la place à d'autres tout aussi savoureux.
Cependant la pantomime, si réjouissante pour le lecteur, n'est pas qu'un film distrayant Au centre de celui-ci, une narratrice, Nedjma, vit à la première personne la crise qui forme le vrai sujet de fond du récit. Dans Les Moineaux de la Murette, il y avait un secret, bien enfoui et dissimulé, qui minait la maisonnée et menaçait d'exploser soudain au grand jour. Ici la narratrice emmène avec délicatesse le lecteur aux confins de la déraison, dans les profondeurs de la souffrance qui menace de tout submerger. L'auteur mobilise à travers des figures bien familières, voire populaires, les forces obscures qui agitent un univers intérieur. La narratrice débrouille tant que bien que mal l'écheveau des fils qui s'embrouillent dans son esprit et menacent d'étrangler définitivement la vie.
Le lecteur saisit les deux versants de l'Algérie d' aujourd'hui, la moderne et l'archaïque l'Orient et l'Occident devenus frère et soeur antagonistes, l'effet mutilant de l'idéologie qui écrase l'individu et les tressaillements de la liberté dans les entrailles d'une femme qui lutte pour sa survie. Surtout cet univers éminemment, presque intrinsèquement féminin, dessine en creux l'absence par défaut de l'homme. L'Algérie ici décrite devient presque un vaste gynécée où les femmes seraient libres de circuler sans jamais ou presque rencontrer d'homme, sans jamais ou presque sortir du monde où elles sont enfermées de tradition. L'Amour et la Vie, la Chair, bannis, resurgissent au coeur même de la narratrice, de ses compagnes et compagnons sous les formes de l'aberration, sous la figure de démons intérieurs ou extérieurs, ceux de la mélancolie ou du fanatisme religieux. Dans sa lutte pour trouver l'issue à son désarroi, la narratrice aborde tous les sujets, ceux du statut de la femme et de l'amour, de la foi et de Dieu, du Coran, ou de l'éducation.
L'Albatros est plus que le roman d'une femme. Il est celui d'une crise de société, intellectuelle, mais aussi bien spirituelle qu'existentielle au centre de laquelle non seulement le témoin mais aussi l'acteur principal est sans doute la femme, même si elle y apparait comme réduite à la sphère privée. Peut-être justement parce qu'elle y a été renvoyée par des forces contraires.
Avec tout cela, L'Albatros de Najia Abeer est un roman merveilleux de fantaisie, d'humour, de délicatesse, de pudeur et de truculence tout à la fois. Les fêtes entre femmes, le coin des femmes à la prière du vendredi soir à la mosquée, l'intervention de la rebouteuse-devineresse ou de l'exorciste, on n'en finirait pas de citer les moments de gaîté franche. La langue de Najia Abeer, dans sa légèreté, est d'une précision réjouissante.
Max Véga-Ritter
Professeur émérite
Clermont-Ferrand
• • •
Ce deuxième roman de Najia Abeer ne ressemble pas au précédent. C'est une parenthèse dans la trilogie en cours d'écriture. Parenthèse importante puisque outre l'analyse politique et sociale, l'auteure, avec une précision chirurgicale, nous dévoile les combats personnels de Nedjma.
L'héroïne qui ne peut être que la copie conforme de celle qui l'a créée, se débat dans une société en crise, auprès (le plus souvent loin) d'un mari nombriliste qui ne se soucie que de sa carrière. Elle se bat contre un cancer implacable et repousse la mort avec succès, tout en élevant ses trois enfants. Belle revanche sur la vie et sur les hommes !
Mais le combat de Najia/Nedjma ne s'arrête pas là. Il lui faut surmonter une grave dépression consécutive à la terrible maladie qu'elle a provisoirement vaincue et à sa solitude. Elle puise ses forces dans sa foi en un Dieu qui n'a rien à voir avec celui des barbus et dans sa révolte face au glissement de son amie Haoua, vers les profondeurs de l'obscurantisme. Cette révolte, loin de la priver de ressources face à la déprime, lui donne une vigueur supplémentaire. De front, elle mènera la lutte contre le vide affectif et la gangrène de l'islamisme.
C'est finalement un livre optimiste, puisque ce ne sont pas les forces du mal qui tirent leur épingle du jeu. La seule héroïne de ce roman très bien écrit, Nedjma, arrive à vaincre le mal qui la ronge et celui qui envahit la société algérienne.
Ce livre est tellement vrai que, par instant, c'est carrément l'auteure qui parle, sans même se réfugier derrière Nedjma. C'est alors un véritable cri.
Il reste à Najia Abeer à achever ce qu'elle a fort bien commencé avec le parcourt de Haoua : un autre roman qui, centré sur cette femme happée par l'intégrisme, nous éclaire avec la sensibilité propre à l'auteure sur cette décennie noire et le rôle des femmes algériennes dans la lutte pour se débarrasser des fous de Dieu.
JM Pascal, Professeur des écoles retraité
Constantinois
222 pages, les éditions Apic (Alger), 2005.
Deuxième partie d'une trilogie qui restera inachevée.
Ce livre n'est pas encore paru en France
Liberté 7 décembre 2005
Le dernier retour à Constantine Longtemps après s'être consacrée à l'enseignement des langues, Najia Abeer s'est mise à l'écriture. Dans ses ouvres, poésie, romans et nouvelles, à caractère fortement autobiographique, elle revient tour à tour à son enfance, à son adolescence et, surtout, à sa ville natale, Constantine. Mais toujours apparaît sa passion, l'enseignement.
Il est de ces ouvres que le destin a rendu prémonitoire. Bab El Kantara, dernier ouvrage de Najia Abeer, décédée à 57 ans en octobre de cette année, est certainement de celles-là. Dans son ultime roman, paru un mois seulement avant son décès, la volonté ardente du retour à sa jeunesse, vécue à Constantine, et surtout d'en découdre avec certains personnages, de son entourage immédiat, se lit à chacune des pages de ce roman qui se termine, presque, par cette tirade pas très loin de la catharsis tant attendue : "Mort à Garmia, mort aux imbéciles, mort aux vieux gardiens de cette stupide virginité, à bas les lances acérées de ces traditions débiles et tous les chèches qui abritent des cervelles d'oiseau." C'est donc chose faite, et Najia Abeer a fini par dire et écrire ce qu'elle avait gardé pour elle des années durant.
Avant cet ultime retour au passé, avant que "s'arrête mon sourire dans l'agonie d'un rire trahi", comme elle semblait le craindre dans son poème Mousse rose de mon enfance. Que de signes et de retours incessants à l'enfance et à Constantine. Car, lorsque que l'on est natif de la vieille ville, Souika, de Constantine "ma chère ville natale", mille fois torturée par l'histoire, le retour aux origines s'impose de lui-même. Et ce ne sont pas ses séjours aux États-Unis et en Jordanie qui lui feront oublier le Vieux Rocher. Comme dans Constantine et les moineaux de la murette, édité par Barzakh en 2003, Najia Abber considère la ville comme un espace intimement lié à son écriture.
La narration dans ce roman, structuré en plusieurs chapitres, se construit sur la trame du film des souvenirs, rythmé par les allers et venues entre l'école normale et la maison à l'occasion des vacances. Sont alors évoqués, dans une Algérie tout juste sortie du colonialisme, des souvenirs des premières années passées à l'école normale de Bab El Kantara (d'où le titre), des premières amitiés, des premières amours, des premiers ressentiments vécus dans un univers féminin, mi-clos, celui de l'école qui forme les futures enseignantes dans un pays qui en a tant besoin. Ainsi, en arrière plan, prend naissance la prise de conscience de ses futures responsabilités d'éducatrice. Comme l'auteur l'annonce d'ailleurs dans sa dédicace : "À tous les normaliens et toutes les normaliennes qui continuent, même au-delà de leur retraite, à honorer leur profession." Roman autobiographique, Bab El Kantara l'est assurément, comme le sont aussi ses autres ouvres. Le souci de témoigner.
SAMIR BENMALEK
• • •
La chronique d'un temps révolu à la recherche de l'espoir
Ce troisième roman de Najia Abeer, second de sa trilogie qui restera malheureusement inachevée, au-delà de la chronique d'une élève de l'École Normale de Constantine des années post libération nationale est encore un cri d'amour à la « Ville des Ponts » si chère à l'auteure. C'est aussi et toujours la quête d'un amour impalpable qui marquera à jamais la vie de la narratrice.
Dans le premier tome de la trilogie (Constantine et les moineaux de la murette 2003), nous avions quitté Joumana alors qu'elle abordait l'adolescence, dans un pays tout juste libéré du colonialisme. La recherche de Louise, la maman de Joumana, était déjà une démarche douloureuse et désespérée. Elle se poursuit dans ce second tome et Joumana se livre un peu plus encore. Chaque description, chaque situation illustre la personnalité de la jeune normalienne.
Très habilement, l'auteure nous emmène presque banalement sur la vie quotidienne d'une institution très respectable qu'est l'École Normale. Tout y passe, depuis la majorité des professeurs qui sont des coopérants français jusqu'à la coexistence de deux bacs, l'un algérien, l'autre français, en passant par les premières générations d'arabophones qui marquent clairement l'indépendance de l'Algérie.
Le lecteur, porté par les aventures de Joumana et de ses compagnes, fait des incursions de plus en plus intimes dans sa vie familiale et suit le cheminement psychologique d'une jeune fille blessée par la vie, à la recherche d'une affection non exprimée. Cette intimité permet de comprendre comment s'est forgé le caractère de l'héroïne et on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec celui de la romancière.
Joumana, dans cet opus, s'affirme bien comme une citadine, issue d'une grande famille constantinoise qui fait sa fierté, malgré sa difficulté à la vivre et son incapacité à intégrer sa belle-mère dans le cercle familial. Elle développe ses relations à la fois complices avec son papa et toutes les ambiguïtés résultant de la difficulté pour ce dernier à maintenir les plateaux de la « balance » en équilibre : d'une part ses filles et de l'autre Samra, sa seconde femme et cousine, et la petite dernière.
C'est au travers de tous ces méandres que Joumana/Najia se construit, s'affirme et se dirige tout droit vers la capitale algérienne pour devenir le professeur issu de l'École Normale Supérieure, haut du pavé de l'enseignement, libre de ses actes, loin du cocon familial où elle étouffait.
Ce récit est rendu très vivant par les nombreux dialogues qui rythment les pages. L'identification est telle que nombre d'expressions sont celles de la Najia Abeer des dernières années, comme des indices nous permettant de mieux la connaître, après sa disparition récente.
Ce deuxième tome de la trilogie, se lit à plusieurs niveaux. Les intimes, ceux qui ont côtoyé de près la narratrice, la comprendront mieux, après lecture. Les autres retiendront plus un témoignage unique des premiers pas des enseignants algériens formés dans la foulée de l'Indépendance. Reste aussi pour tous un nouveau cri d'amour pour le « Vieux-Rocher » qui veut se conjuguer avec l'espoir dans l'avenir d'une Joumana/Najia rebelle et moderne qui veut trouver la quiétude dans son univers familial.
Merci Najia, pour tes écrits qui nous manquent déjà, car tu avais tellement à dire encore.
Le 24/01/2006,
Yahia (Jean-Michel Pascal), dit Jean-Michel de Constantine